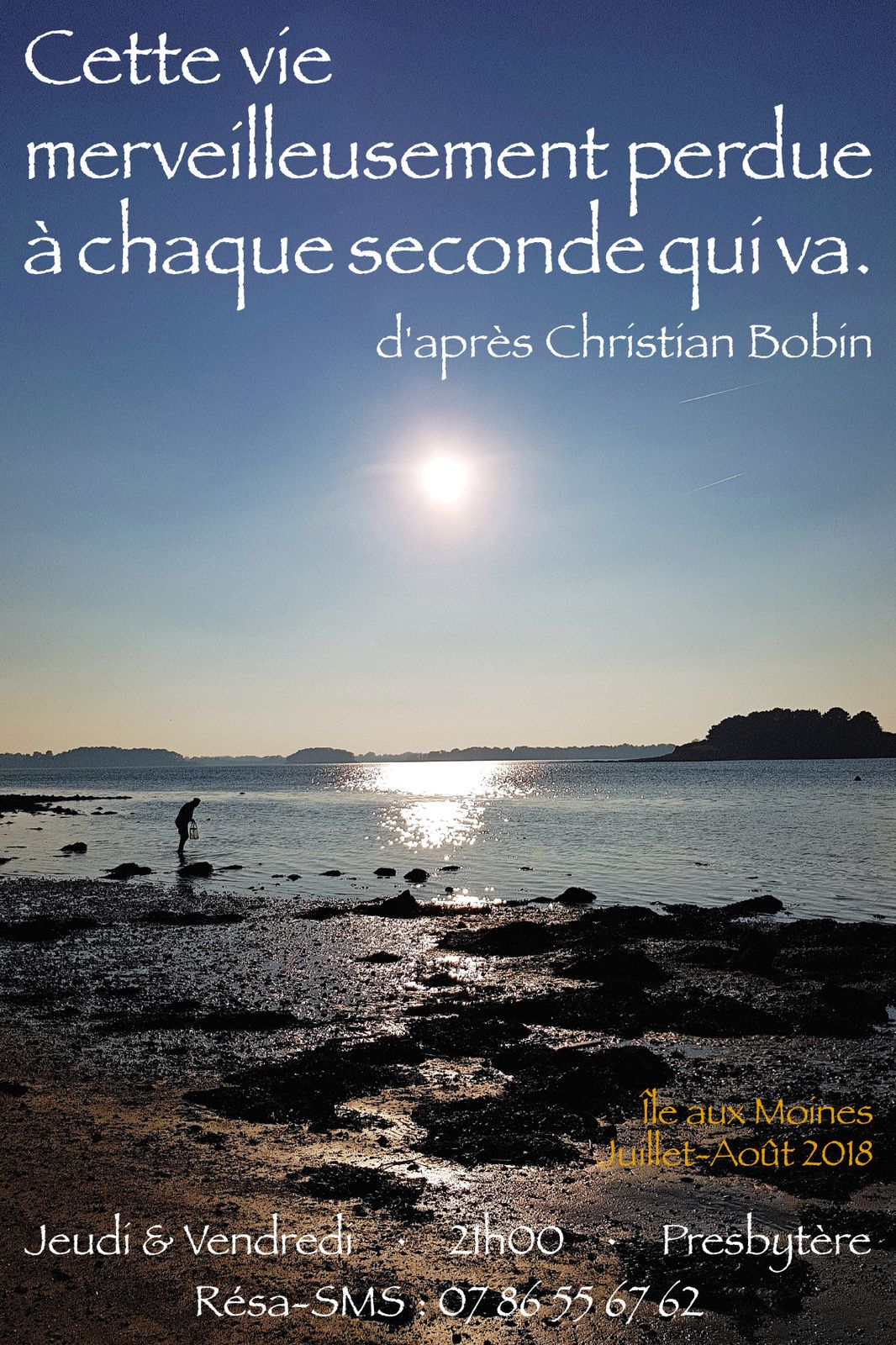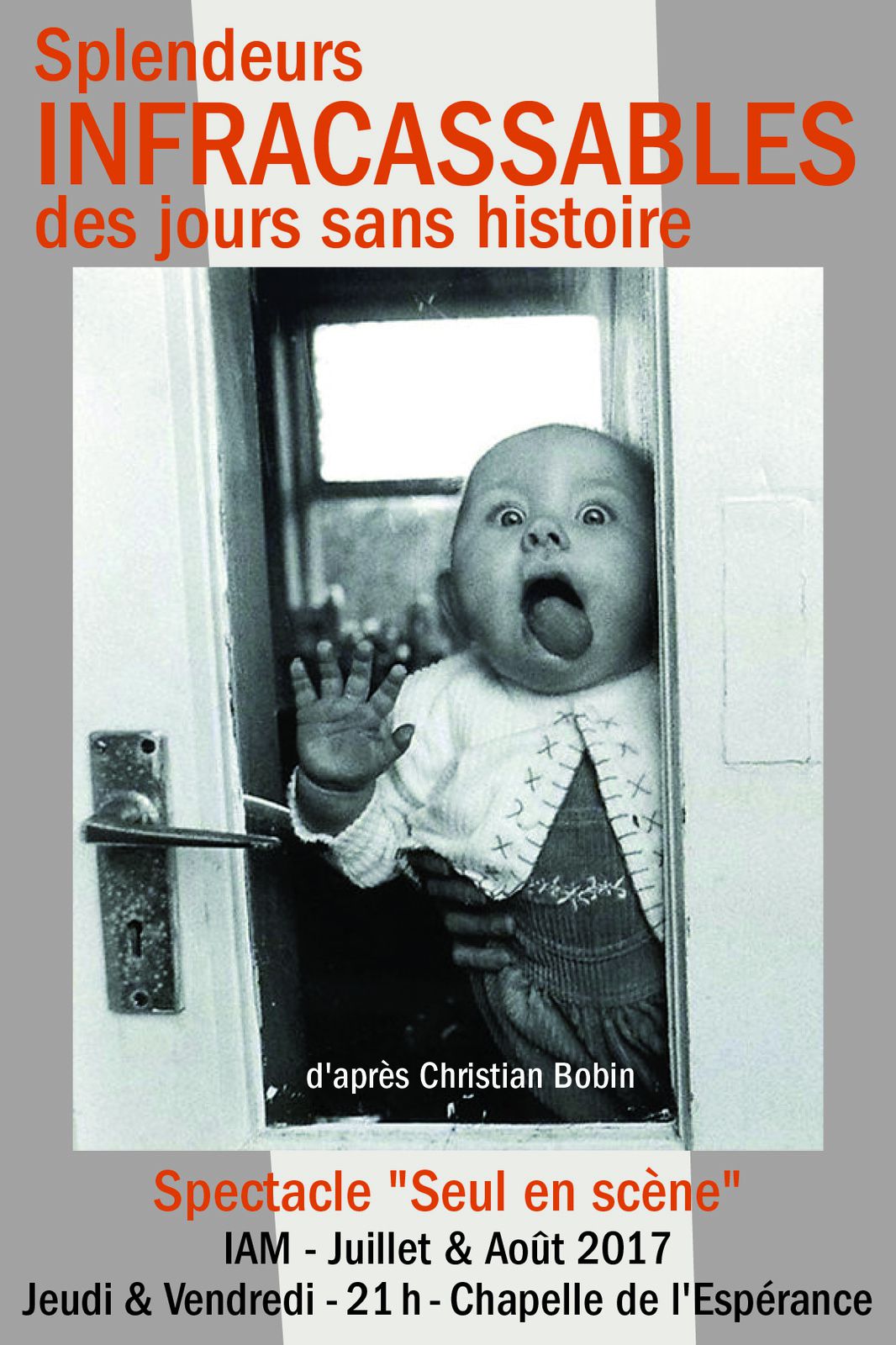Très-peu est pour moi le nom de l'abondance
"Ecrire c’est ne rien oublier de ce que le monde oublie. C’est possible qu’il y ait tout un peuple derrière moi…
J’ai toujours pensé que l’écriture était une manière de rendre quelque chose à quelqu’un à qui ça avait été volé : la parole et par la parole la vision, l’éblouissante vision de la vie, celle de chacun. Mon travail je l’ai toujours perçu comme cela. Surtout ne pas laisser la mort écrire le livre.
L’écriture est l’ange gardien de nos vies. Elle garde ce que nous ne savons pas garder. Ce qui n’est pas écrit se perd comme de l’eau qui tombe dans du sable…
Il y a un bon silence, c’est celui de la neige, c’est celui d’une bougie, c’est celui des poèmes ; Et puis il y a un mauvais silence, c’est celui qui laisse fleurir une blessure depuis longtemps faite et qui la laisse croître.
L’écriture c’est un principe de respiration et de délivrance. Mon enfance, c’était une cour, déjà presque la disposition d’une page…L’écriture, c’est toujours aller chercher dans la gueule du feu la perle de fraîcheur qui s’y trouve. L’écriture est à son zénith quand elle éclaire les sans-visages.
Ce qu’on imagine être dehors, en fait est dedans. La solitude est le lien le plus profond aux autres. La solitude est cette cour d’école en chacun où nous pouvons nous retrouver et jouer ensemble.
Le monde, c’est la salle de classe. Ça ne rigole pas. C’est l’ennui…
La solitude dont je vous parle, c’est le délassement, vous quittez l’argent, le savoir, même vos métiers, vous êtes dans la nudité interne qui est celle de l’âme. Les âmes c’est juste des enfants qui jouent.
Imaginez une cour d’école où vous n’avez plus rien à craindre. Vous n’avez que des amis. La cour d’école dont je parle, c’est une page de papier… On peut s’amuser là, on peut s’entendre, on peut se croiser et même on peut se rencontrer.
Il n’y a rien de plus beau que de se rencontrer.
Il n’y a qu’un millimètre entre le paradis et nous. Seuls, nous n’arriverions jamais à le franchir…
Je sais exactement ce que le monde détruit avec notre concours, du moins avec notre consentement…
Le monde n’est qu’efficacité. Lui obéir, c’est arracher cette divine maladresse que nous avons au fond de l’âme et qui est la pudeur même… tout ce qui est réellement précieux et maladroit, timide, hypersensible… Nous sortirons vainqueurs de cette épreuve.
C’est par distraction que nous n’entrons pas au paradis de notre vivant. La vraie force, c’est notre faiblesse, c’est notre misère.
Le mal a toujours pour l’œil le plus grand prestige. La guérison réelle de nos plaies, c’est l’amitié.
Le secret, la conversation intime, amicale, touche aux racines de la vie et les fortifie. C’est toujours quelque chose de l’invisible qui nous soigne, qui nous répare. C’est toujours quelque chose de spectaculaire qui nous abîme.
Restons dans cette vie et c’est dans cette vie qu’il y a des résurrections ! Il s’agit d’amour simplement, pas de religion… C’est un secret qu’il faut garder pour soi…
Nos armures servent à nous protéger contre la vie, pas contre la mort comme nous le croyons.
Il y a une vie qui ne s’arrête jamais et elle est impossible à exprimer… Elle fuit comme l’oiseau…
Ce qui peut être expliqué ne mérite pas d’être compris."
Christian Bobin

/image%2F0991062%2F20191125%2Fob_e0f916_thumbnail-img-8110.jpg)
/image%2F0991062%2F20180321%2Fob_e92b85_20161025-172451.jpg)