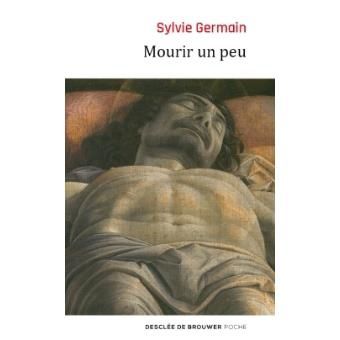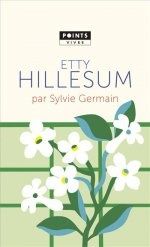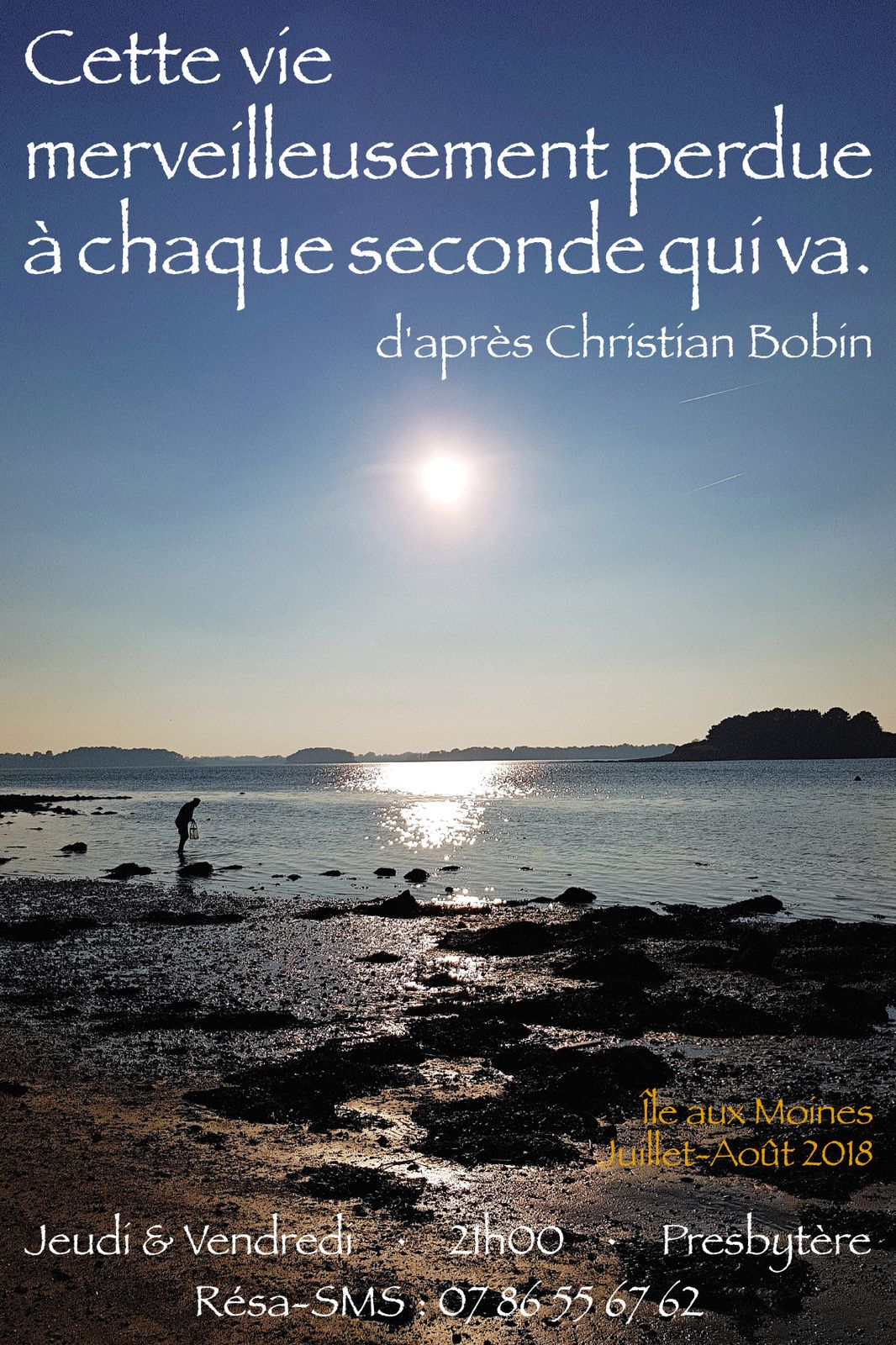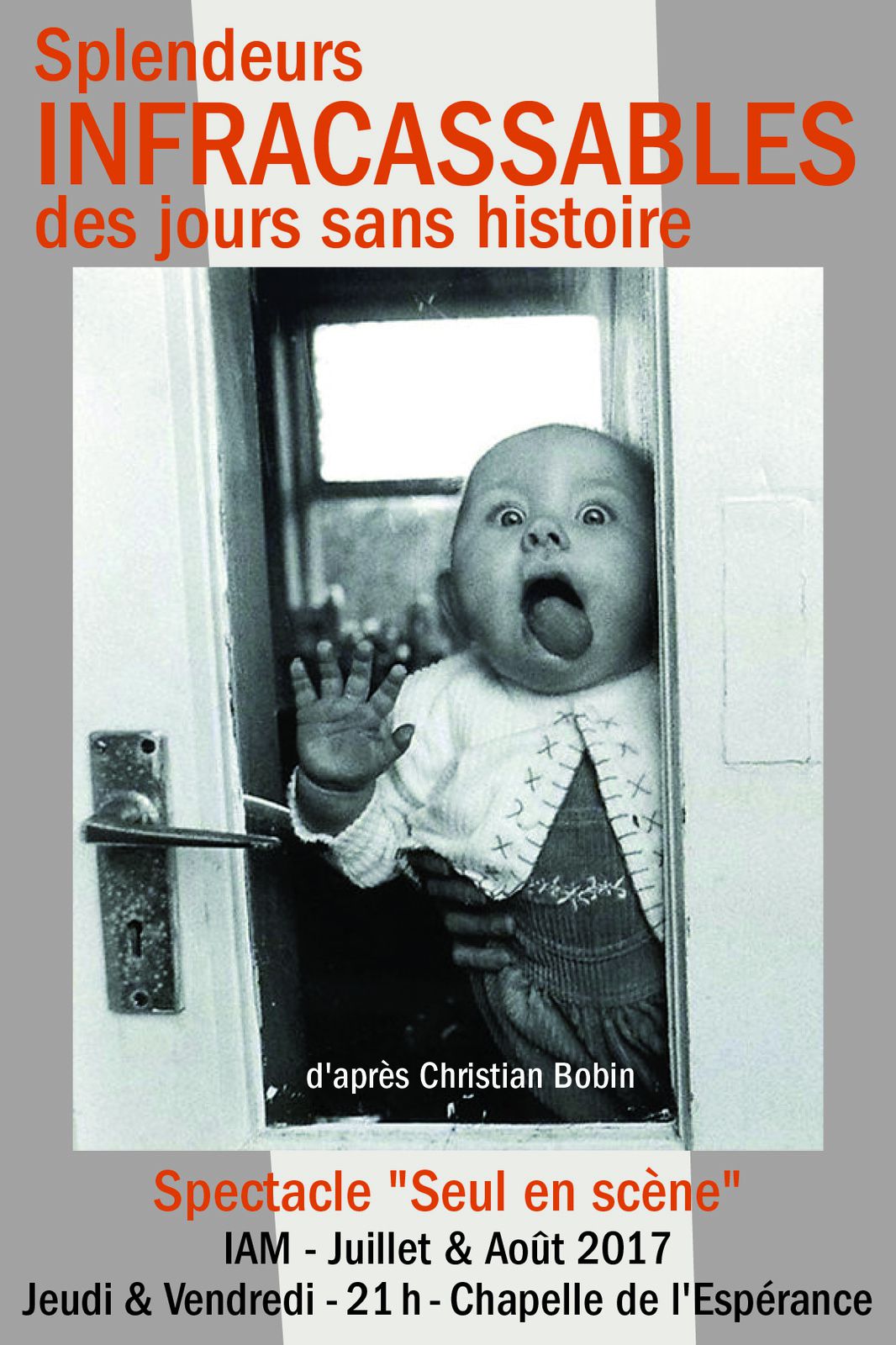L’effet des smartphones sur nos jeunes est plus qu’effrayant
Personne, je pense, n’avait anticipé la catastrophe historique provoquée par les smartphones.
La psychologue américaine Jean M. Twenge étudie depuis vingt-cinq ans le comportement social et affectif des jeunes. Elle a observé ces dernières années un séisme.
Dans un article intitulé « Les smartphones ont-ils détruit une génération ? », elle explique que tout a changé à partir de 2012.
Cette année-là, plus d’un ado sur deux était équipé d’un smartphone. Aujourd’hui, c’est quatre sur cinq.
Durant cette période, les évolutions suivantes se sont produites. Elles concernent toutes les classes de la population, riches ou pauvres :
- les symptômes dépressifs se sont accrus de 50 % chez les filles et de 21 % chez les garçons, de 2012 à 2015 ;
- le nombre de filles qui se sont suicidées a triplé entre 2007 à 2015, et celui des garçons doublé ;
- le nombre de jeunes qui voient des amis tous les jours a baissé de 40 % entre 2000 et 2015 ;
- actuellement, les jeunes de 16 ans sortent moins que ne le faisaient ceux de 12 ans en 2009. Ils sont en train de cesser progressivement de sortir et de se socialiser dans les parcs, squares, etc., et restent seuls chez eux avec leur smartphone ;
- en 2015, seuls 56 % des élèves de terminale sont « sortis » avec quelqu’un, contre 85 % des jeunes dix ans plus tôt, un chiffre qui était stable depuis les années 1960 ;
- le nombre d’enfants qui manquent de sommeil a augmenté de 57 % entre 1991 et 2015 ;
- aux États-Unis, où l’obtention du permis de conduire était le rêve de tous les jeunes autrefois, le passeport pour la liberté, on observe un désintérêt massif des adolescents, qui préfèrent rester dans leur chambre sur leur smartphone et se faire conduire par leurs parents ;
- concernant la consommation d’alcool, les rencontres amoureuses, les adolescents se comportent comme nous le faisions à 15 ans, et ceux de 15 ans comme nous le faisions à 13 ;
- s’ils sortent moins souvent, les rares fois où ils le font sont abondamment communiquées sur Snapchat, Instagram ou Facebook. Ceux qui ne sont pas invités se sentent donc cruellement exclus : le nombre de jeunes filles se sentant rejetées et isolées a augmenté de 48 % de 2010 à 2015 et le nombre de garçons de 27 %.
« J’essaye de leur parler et ils ne me regardent pas. Ils regardent leur smartphone. »
Lorsqu’ils se confrontent malgré tout aux enfants de leur âge, leur manière d’interagir est profondément dégradée.
En effet, bien que physiquement ensemble, cela n’interrompt nullement le fonctionnement des smartphones.
« J’essaye de leur parler de quelque chose, et ils ne me regardent pas droit dans les yeux. Ils regardent leur téléphone ou leur Apple Watch », témoigne une jeune fille dans l’article cité ci-dessus.
- « Et qu’est-ce que ça te fait, quand tu essayes de parler à quelqu’un en face-à-face et qu’il ne te regarde pas ? », lui demande la psychologue.
- « Cela me fait mal. Mal. Je sais que la génération de mes parents ne faisait pas ça. Je peux être en train de parler de quelque chose de super-important pour moi, et ils ne m’écoutent même pas. »
Oui, on imagine que ça fait mal, en effet…
Piégé par mon smartphone
En ce qui me concerne, j’ai tenu sans téléphone mobile jusqu’à il y a quelques mois. Pendant longtemps, je me suis débrouillé avec des « télécartes ».
Mais les cabines publiques ont peu à peu été supprimées. En cas d’urgence, j’étais obligé d’emprunter le téléphone des gens. Mais avec le smartphone, ils sont devenus de plus en plus réticents à cause de toutes les informations personnelles ; trop dangereux de laisser ça entre les mains d’un inconnu, aussi sympathique soit-il.
Mais c’est ma banque qui a eu raison de mes résistances.
Comment ma banque m’a vaincu
Au mois de février, ma banque m’a envoyé un courrier m’expliquant que tous les clients devaient désormais utiliser leur smartphone pour « scanner » un code apparaissant sur l’écran pour accéder à leur compte…
Penaud, j’ai acheté un smartphone. J’étais décidé à ne m’en servir que pour la banque mais, bien sûr, très rapidement j’ai passé mes premiers appels et il s’est mis à sonner en retour…
La chute
En juillet, je m’en servais, pour la première fois, connecté à ma voiture. En août, ma fille m’installa Whatsapp, et m’inscrivit au groupe de la famille, ce qui me valut de sentir des vibrations toutes les cinq minutes, et voir apparaître toutes sortes de « notifications » sur l’écran que ma curiosité avait le plus grand mal à ignorer…
Peu à peu, ma vie a basculé.
Il y a dix jours, je me suis retrouvé pour la première fois à me promener dans la rue en « textant ».
J’ai alors levé le nez autour de moi. Je ne regardais plus le ciel bleu. Je n’entendais plus les oiseaux chanter. Je ne souriais plus aux passants (ni aux passantes…). J’étais dans la prison psychique de mes messageries et je me suis rendu compte que la plupart des gens autour de moi étaient… pareils.
Le patron d’Apple avait interdit l’iPhone à ses enfants
Ce matin, un article explique que le grand Steve Jobs, patron d’Apple, avait interdit le smartphone à ses enfants.
De même pour Bill Gates, fondateur de Microsoft, qui ne voulait pas d’ordinateur chez lui.
Y avait-il quelque part un problème que ces « génies de l’informatique » avaient remarqué et dont leurs clients ne s’étaient pas aperçus ?
« Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître… »
Les gens sont en train d’oublier combien la vie était douce avant ces engins. Moi je m’en souviens, je vivais ainsi il y a quelques mois encore.
Je montais dans ma voiture, ou dans le train, et je partais réellement.
Je ne poursuivais pas la conversation avec les gens que je venais de quitter. Les séparations étaient plus dures, mais les retrouvailles étaient aussi beaucoup plus intenses.
En voyage, je lisais. Dans ma voiture, je rêvais. J’écoutais de la musique sans jamais être interrompu par un brutal appel téléphonique.
Quand j’arrivais chez des amis, j’étais présent, je ne poursuivais pas des échanges parallèles avec des collègues ou d’autres personnes à des centaines de kilomètres de moi. C’était plus agréable pour tout le monde.
En réunion, au travail, je me concentrais uniquement sur les problèmes discutés autour de la table. Je n’avais pas le choix. Impossible de m’évader en appuyant sur un écran pour recevoir des nouvelles de ma famille ou de mes amis, ou encore pour traiter les questions liées à d’autres collègues, autre part.
Je comprends bien l’aspect excitant de ces machines. Vous êtes tout le temps stimulé. Vous vous sentez important. Vous avez l’impression d’être dans le coup, de mener une vie trépidante. Vous êtes enivré. Le grand frisson de la vie moderne, connectée, toujours en mouvement.
Vous recevez de délicieuses décharges d’adrénaline chaque fois que ça bipe, que ça buzze, que ça sonne.
Mais si vous regardez les choses en face, vous risquez aussi beaucoup plus de devenir un zombie dépressif.
Alors, cette fois, c’est décidé : je laisse mon smartphone à la maison ! Une fois par mois, je consulterai mes comptes, et ce sera tout.
Je brise mes chaînes. Je retourne dans le monde normal. Je dis stop à la dépression, aux insomnies, aux idées suicidaires. Adieu, mon smartphone !


/image%2F0991062%2F20191125%2Fob_e0f916_thumbnail-img-8110.jpg)
/image%2F0991062%2F20180321%2Fob_e92b85_20161025-172451.jpg)






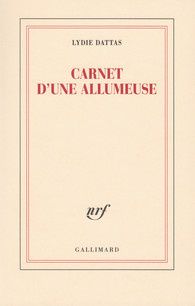



/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FEsY82oTPM9Q%2Fhqdefault.jpg)
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fayn5HEV72v8%2Fhqdefault.jpg)
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FQS5pOBC_tlc%2Fhqdefault.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.desfourmisdanslesmains.com%2Fassets%2Fimages%2F4%2FPrendre%20tes%20yeux-19431734.jpg)





/http%3A%2F%2Fzone-critique.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2Fxgrall-gplportraitquere-copie-e1478202973523.jpg)