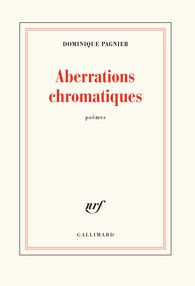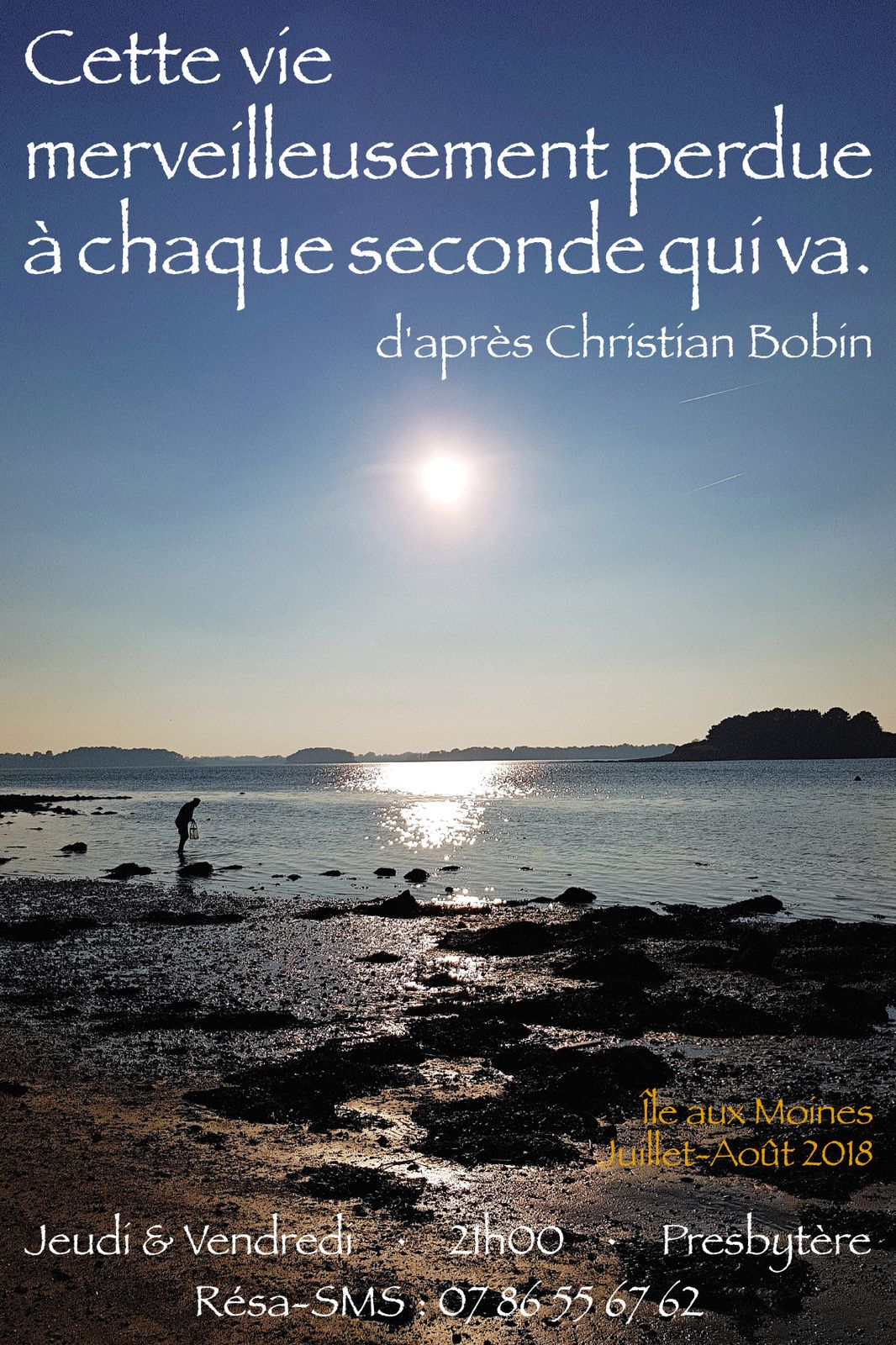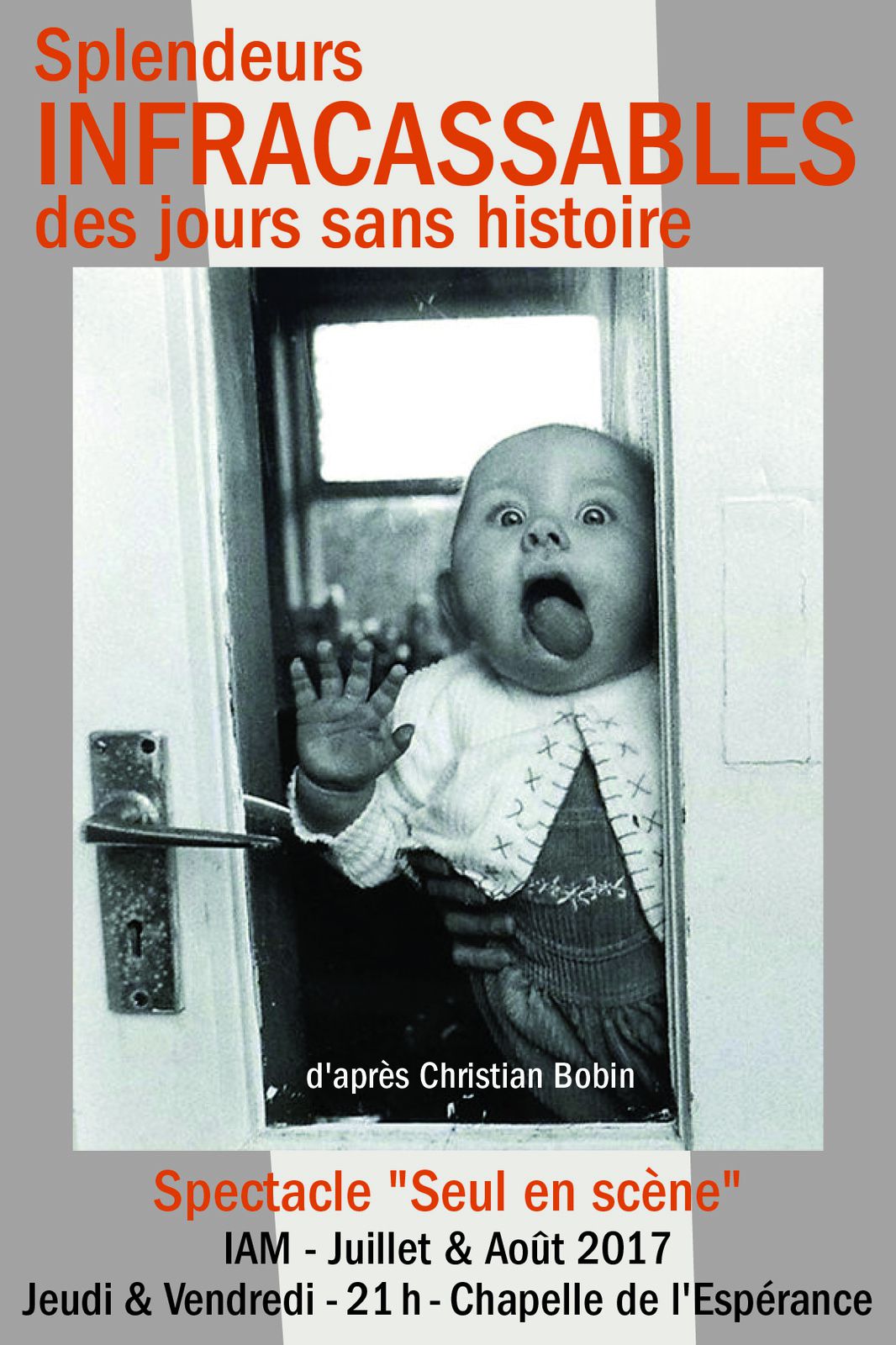"La grande facilité d’écrire des lettres doit avoir introduit dans le monde — du point de vue purement théorique — un terrible désordre des âmes : c’est un commerce avec des fantômes, non seulement avec celui du destinataire, mais encore avec le sien propre".Franz Kafka
Rien de plus honteusement fascinant que la correspondance d’un écrivain. Celle de l’auteur lui-même, comme la correspondance de Flaubert, un monument de lucidité et d’ironie, ou celle des lecteurs à l’écrivain (les fantasmes des lectrices de Balzac, les desiderata du public d’Eugène Sue, les « tes rêves se mêlent à mes rêves » de Louise Michel à Hugo). Ce type de lecture procure un plaisir particulier et paradoxal, intellectuel (découvrir obliquement une œuvre), totalement interdit (satisfaire un certain voyeurisme en découvrant la sphère privée) et gratuit (les listes de blanchisserie de Balzac…).
Et puis il y a, par-dessus tout, les Lettres à Milena de Kafka. Parcours.
La silhouette de cette femme, Milena Jesenská, « Milena de Prague », « vraiment fabuleusement belle » disait Kafka, qui fut d’abord sa traductrice puis un des grands amours de sa vie, cette silhouette fugitive et fantomatique (« Es fällt mir ein, daß ich mich an Ihr Gesicht eingentlich in keiner bestimmten Einzelheit erinnern kann… », « Je m'aperçois soudain que je ne puis me rappeler en réalité aucun détail particulier de votre visage. Seulement votre silhouette, vos vêtements, au moment où vous êtes partie entre les tables du café : cela, oui, je me souviens… »).
« Milena. Quel nom riche et lourd, presque trop plein pour être soulevé… Sa couleur, sa forme est celle, merveilleuse d’une femme, une femme que l’on transporte dans ses bras en fuyant le monde ou en fuyant l’incendie, je ne sais pas lequel des deux, et elle se presse dans vos bras avec confiance et enthousiasme, le nom semble vous échapper en bondissant ou n’est-ce que l’impression que vous cause le saut de joie que vous faites avec votre charge ?… ».
« L’éclat de vos yeux supprime la souffrance du monde » lui écrit-il le 3 juin 1920.
Et à Max Brod, l’ami de toujours, le confident, l’exécuteur testamentaire : « C’est un feu vivant, tel que je n’en ai encore jamais vu… En outre extraordinairement fine, courageuse, intelligente, et tout cela, elle le jette dans son sacrifice ou, si on veut, c’est grâce au sacrifice qu’elle l’a acquis ». « Milena est comme la mer, forte comme la mer avec ses masses d’eau ; quand elle se méprend elle se rue aussi avec la force de la mer, quand l’exige la morte lune, la lointaine lune surtout ».
Et dans son Journal, le 2 décembre 1921 : « Toujours Milena, ou peut-être pas Milena, mais un principe, une lumière dans les ténèbres. Elle est le ciel fourvoyé sur terre. »
Milena force Kafka à la voir, il veut rester dans la distance, dans son « impureté », il temporise, ironise, avant de céder : « Prends-moi dans tes bras, c’est l’abîme, accueille-moi dans l’abîme… » : On est en juillet 1920 : ils passent quatre jours à Vienne, quatre jours, « et ton visage au dessus du mien dans la forêt, et ton visage au dessous du mien dans la forêt et ma tête qui repose sur ton sein presque nu… ». « Le premier jour a été celui de l’incertitude, le deuxième celui de la trop grande certitude, le troisième celui du repentir, le quatrième a été le bon. ».
Milena accepte mal cette distance, elle veut revoir Kafka, il refuse, invoque sa maladie, son travail, son impuissance à dominer ses démons. Ils se reverront à Gmund à la frontière autrichienne. Un échec. « Ce jour là nous nous sommes parlé, nous nous sommes écoutés, souvent, longtemps, comme des étrangers. ».
« Ces lettres en zigzag doivent cesser, Milena, elles nous rendent fous. Je ne peux tout de même pas garder un ouragan dans ma chambre ! Oui, ces lettres sont la source de l’impuissance à sortir de ces lettres mêmes ».
Les lettres à Milena s'espacent et finissent par cesser.
L’ultime lettre de Franz est datée de juillet 1923 : elle annonce à Milena qu’il « a trouvé à Müritz une aide prodigieuse en son genre » : Dora Dymant, une Berlinoise de 19 ans qui sut enfin lui apporter l’apaisement et l’accompagna jusqu’à sa mort, l’année suivante le 3 juin. Dans le Narodni Listy du 7 juin 1924, Milena, sans la moindre note d’acrimonie, publie un hommage funèbre : « Il était timide, inquiet, doux et bon, mais les livres qu’il a écrits sont cruels et douloureux. Il voyait le monde plein de démons invisibles qui déchirent et anéantissent l’homme sans défense… Il a écrit les livres les plus importants de la jeune littérature allemande ; toutes les luttes de la génération d’aujourd’hui dans le monde entier y sont incluses, encore que sans esprit de doctrine. Ils sont pleins de l’ironie sèche et de la vision sensible d’un homme qui voyait le monde si clairement qu’il ne pouvait pas le supporter et qu’il lui fallait mourir s’il ne voulait pas faire de concessions comme les autres… ».
Milena rentre à Prague après des années à Vienne. Elle s’engage, poursuit son activité de traductrice et de journaliste, dénonce la montée du nazisme, entre en résistance.
Etrangement, elle écrivait, dès 1919, décrivant un rêve : Quelque part lorsque la planète tout entière a été frappée par la guerre, d’interminables trains quittaient la gare l’un après l’autre… le monde se transformait en un réseau de voies ferrées emportant des êtres affolés, des êtres qui avaient perdu leur maison et leur patrie. Enfin, les trains s’arrêtèrent au bord du vide. Contrôle ! tout le monde descend ! hurla un préposé… Un douanier s’approcha de moi. Je regardais son papier déplié. Je lus, écrit en vingt langues différentes : Condamnés à mort . Elle meurt, déportée, à Ravensbrück le 17 mai 1944.
L’amour de Milena et Kafka se nourrit du manque, de l’absence, - encore plus palpable pour nous qui ne disposons que des lettres de Kafka - totalement et volontairement destructeur (« tu es le couteau avec lequel je fouille en moi ») et construit sur ces vides et ces souffrances un somptueux édifice littéraire. Un espace aux dimensions mêmes du monde : « ou le monde est bien petit, ou nous sommes gigantesques, en tout cas, nous le remplissons ».
Milena lit à Vienne, en 1920, les premières nouvelles de Kafka. Elle décide de traduire ses textes en tchèque, en demande l’autorisation à Kafka, lui envoie ses traductions, qu’il critique…. Ils se rencontrent à Merano, lieu de cure de l’écrivain. Elle a 24 ans, lui 38. Il lui dit ses peurs, ses angoisses, sa maladie. Le ton des lettres oscille entre passion et panique, adoration et crainte. Elle est aussi gaie et passionnée qu’il est dans la retenue, la distance et la complexité. Ce « Toi qui te vis à de telles profondeurs », ce « feu », fascine et mine Franz Kafka. Ils se voient peu, s’écrivent durant deux ans. Milena est omniprésente dans le Journal aux années 1920-1922. Kafka finit par la quitter, submergé par son angoisse, condamnant Milena à ce qu’elle nommera, dans une lettre à Max Brod, le « mal d’absence ». Kafka, lui, cynique envers lui-même comme envers elle, écrit : « ce qui fut un lien brûlant est maintenant un mur, une montagne, ou, plus exactement, une tombe ».
………………………………………
« Ah ! mon dieu ! Milena, si vous êtiez ici ! (…) Et cependant je mentirais si je disais que vous me manquez car, c’est bien là la plus cruelle et la plus parfaite des magies, vous êtes là, comme moi, plus que moi ; où je suis, vous êtes, comme moi, plus que moi. Je ne plaisante pas, il m’arrive de penser que c’est moi qui vous manque ici, puisque vous y êtes ».
« Chère Madame Milena,
Que la journée est brève ! vous suffisez à la remplir, mises à part quelques bagatelles ; la voilà déjà terminée. A peine me reste-t-il une bribe de temps pour écrire à la vraie Milena, l’encore plus vraie étant restée ici toute la journée, dans la chambre, sur le balcon ou dans les nuages. »
« Puis-je recevoir encore une lettre d’ici samedi ? Qu’en pensez-vous ? ce serait possible. Mais cette rage de lettres est insensée. Une seule ne suffit-elle pas ? Ne suffit-il pas d’une certitude ? Bien sûr ! et cependant on renverse la tête, on boit les mots, on ne sait plus rien sinon qu’on ne veut pas cesser. Expliquez-moi ça, Milena ; Milena, M. le Professeur ».
« Dis-moi encore une fois – pas toujours, je ne veux pas toujours – mais dis-moi encore une fois tu ».
« Je ne trouve rien à écrire, je ne sais que flâner autour des lignes dans la lumière de vos yeux, dans l’haleine de votre bouche, comme dans une journée radieuse ».
« J’ai vu aujourd’hui un plan de Vienne ; et je suis resté un moment sans comprendre qu’on ait bâti une si grande ville alors que tu n’as besoin que d’une chambre ».
Après une rencontre de quatre jours à Prague :
« J’ai besoin pour toi de ce temps et de mille fois plus que ce temps : de tout le temps qu’il peut y avoir au monde, celui de penser à toi, de respirer en toi, (…) de ce présent qui t’appartient.
Je ne sais ce que j’ai, je ne puis plus rien t’écrire de ce qui n’est pas ce qui nous concerne seuls, nous dans la cohue de ce monde. Tout ce qui est étranger à cela m’est étranger. (…) Ou le monde est bien petit, ou nous sommes gigantesques, en tout cas, nous le remplissons ».
« Et cependant ce n’est pas toi que j’aime, c’est bien plus, c’est mon existence : elle m’est donnée à travers toi ».
« Hier je t’ai conseillé de ne pas m’écrire chaque jour ; je n’ai pas changé d’avis, ce serait très bon pour nous deux, et je te le conseille encore, et j’y insiste même encore plus ; seulement, Milena, ne m’écoute pas, je t’en prie ; écris-moi quand même tous les jours, tu n’as pas besoin d’en mettre bien long, tu peux faire bien plus bref que tes lettres d’aujourd’hui ; deux lignes à peine, un seul mot, mais de ce mot je ne puis me passer sans une effroyable souffrance ».
« Ensuite : comment évolueront les choses, ce n’est pas de quoi il est question ; ce qu’il y a de certain seulement, c’est que loin de toi je ne puis vivre qu’en donnant raison à la peur, plus raison qu’elle ne le demande, et je le fais sans contrainte, avec ravissement, je m’épanche entièrement en elle ».
« Tu veux toujours savoir, Milena, si je t’aime ; c’est une grave question à laquelle on ne saurait répondre dans une lettre (pas même ma dernière lettre dominicale). Si nous nous revoyons un jour prochain je te le dirai, sois-en certaine, à condition que ma voix ne me trahisse pas.
Tu ne devrais pas me parler de venir à Vienne ; je ne viendrai pas, mais toute allusion à un tel voyage me fait l’effet d’une petite flamme que tu me promènerais sur la peau. C’est déjà tout un incendie ; il ne s’éteint pas ; il continue de brûler aussi fort et même plus. Ce n’est pas ce que cherchais.
(…) J’ai passé hier une journée très agitée, je ne dis pas atrocement agitée, non, agitée tout simplement, je t’en parlerai peut-être prochainement. D’abord, j’avais ton télégramme dans la poche, ce qui détermine une certaine manière de marcher. (…) On se dirige par exemple vers le Cechbrücke, on sort son télégramme, on le lit, il est toujours nouveau (quand on l’a bien relu, le papier est vide, mais à peine remis en poche, il s’y réécrit à nouveau. »
« Pourrais-tu me dire quelques mots du projet Paris ? Où iras-tu ? Est-ce que c’est un endroit bien desservi par la poste ? »
« De quelque façon que je tourne et retourne ta chère lettre, si fidèle, si joyeuse, ta lettre porte-bonheur d’aujourd’hui, c’est une lettre de sauveur. Voilà donc Milena au nombre des sauveurs (si j’y figurais aussi, serait-elle déjà près de moi ? certainement non), Milena à qui la vie ne cesse cependant d’apprendre à son corps défendant qu’on ne peut jamais sauver quelqu’un que par sa présence, et par rien d’autre. Et voilà que, m’ayant sauvé par sa présence, elle essaie encore, après coup, d’autres moyens microscopiques. Tirer quelqu’un de l’eau, c’est splendide, mais lui offrir là-dessus un abonnement gratuit à l’école de natation, qu’est-ce à dire ? »
« Non je ne suis pas fort, et je ne sais pas écrire, et je ne sais rien faire du tout. Et maintenant, toi aussi tu vas te détourner de moi, pas pour longtemps, je le sais, mais un homme ne peut pas tenir longtemps sans que son cœur batte, et comment ferait-il pour battre tant que tu n’es pas tournée vers lui ? »
« C’est un rêve qui m’a donné les dernières nouvelles que j’aie de toi »
« Je t’aime, tête dure, comme la mer aime le menu gravier de ses profondeurs ; mon amour ne t’engloutit pas moins ; et puissé-je être aussi pour toi, avec la permission des cieux, ce qu’est le gravier pour la mer ! t’aimant, j’aime le monde entier ; ton épaule gauche en fait partie ; non, c’est la droite qui a été la première, et c’est pour quoi je l’embrasse s’il m’en prend fantaisie ; ton autre épaule en fait aussi partie. On renverse la tête, on boit les mots, on ne sait plus rien, sinon qu’on ne veut pas cesser… Non, rien,… me taire entre tes bras ».
« Tout le jour j’ai été occupé de tes lettres, tourmenté, amoureux, soucieux, en proie à la crainte imprécise de quelque chose d’imprécis dont l’imprécision consiste surtout à dépasser démesurément mes forces. Je n’ai pas osé relire tes lettres ; il y en a même une demi-page que je n’ai pas osé lire du tout. Pourquoi ne puis-je pas prendre mon parti du fait qu’il n’y a pas mieux à faire que de vivre dans cette tension de suicide constamment différé ? (Tu m’as dit plusieurs fois quelque chose du même genre, et j’essayais de me moquer de toi quand tu le faisais). Pourquoi est-ce que je relâche cette tension afin de m’échapper comme un animal fou (et qui pis est, pourquoi est-ce que j’aime cette folie ?), dérangeant l’électricité, l’affolant, attirant ainsi toute la décharge sur mon corps, au risque d’être foudroyé ?
Je sais exactement ce que je veux dire par là : je ne cherche qu’à capter les plaintes qui s’échappent de tes lettres, les plaintes tues, les plaintes non proférées : et je le peux, car au fond ce sont les miennes. Que nous ayons dû connaître aussi un tel accord dans le domaine des ténèbres, c’est le plus étrange de tout, et je ne puis vraiment y croire qu’une fois sur deux ».
« Il vaut beaucoup mieux maintenant ne pas s’écrire chaque jour ; tu t’en es rendue compte en secret, avant moi. Les lettres quotidiennes, au lieu de me fortifier, me dépriment ; autrefois, je buvais ta lettre d’un trait, et je devenais (…) dix fois plus fort et altéré. Mais maintenant c’est tellement triste ! je me mords les lèvres en te lisant ; rien n’est plus sûr ; sauf la petite douleur dans les tempes ».
« La douleur me guette dans les tempes. Est-ce que la flèche m’a été tirée dans les tempes au lieu de m’être tirée dans le cœur ? »
« Pourquoi me parler, Milena, d’un avenir commun qui ne sera jamais ? Est-ce précisément parce qu’il ne sera pas ? »
« Je n’ai pas encore reçu ta lettre jaune, je te la retournerai sans l’ouvrir. Je me trompe bien s’il n’est pas bon que nous cessions de nous écrire. Mais je ne me trompe pas, Milena.
(…) Ce que tu es pour moi, Milena, ce que tu es pour moi, au-delà de ce monde où nous vivons, n’est pas écrit sur les chiffons de papier que je t’ai envoyés chaque jour. Ces lettres, telles qu’elles sont ne peuvent être bonnes qu’à torturer (…). Mais ce n’est pas là la raison essentielle ; la vraie raison, c’est l’impuissance qui va s’accentuant dans nos lettres, de sortir de ces lettres mêmes, pour toi aussi bien que pour moi ; mille lettres de toi, mille désirs de moi ne changeront rien à la chose ; la grande question, c’est cette voix irrésistible, c’est ta voix, oui littéralement, qui me donne l’ordre de me taire. »
« Je ne te dis pas adieu. Ce n’est pas un adieu, à moins que la pesanteur, qui guette, ne m’entraîne complètement au fond. Mais pourrait-elle le faire puisque tu vis ? »
« Voilà déjà bien longtemps, madame Milena, que je ne vous ai plus écrit, et aujourd’hui encore je ne le fais que par suite d’un hasard. Je ne devrais pas au fond excuser mon silence, vous savez comme je hais les lettres. (…) C’est un commerce avec des fantômes, non seulement avec celui du destinataire, mais encore avec le sien propre ; le fantôme croît sous la main qui écrit, dans la lettre qu’elle rédige, à plus forte raison dans une suite de lettres où l’une corrobore l’autre et peut appeler à témoin. Comment a pu naître l’idée que des lettres donneraient aux hommes le moyen de communiquer ? ( …) Ecrire des lettres c’est ce mettre à nu devant des fantômes ; ils attendent ce geste avidement. Les baisers écrits ne parviennent pas à destination, les fantômes les boivent en route. »
« La sorcellerie épistolaire se remet en branle et recommence à ravager mes nuits, qui se ravagent déjà d’elles-mêmes. Il faut que je cesse, je ne peux plus écrire. Votre insomnie n’est pas la même que la mienne. Ne m’écrivez plus, s’il vous plait ».
Et la dernière :
« Là-dessus, malgré ce qui précède, mes amitiés. Qu’importe si elles sont destinées à tomber dès la porte de votre jardin ? Peut-être n’en sont-elles que plus fortes ».

/image%2F0991062%2F20191125%2Fob_e0f916_thumbnail-img-8110.jpg)
/image%2F0991062%2F20180321%2Fob_e92b85_20161025-172451.jpg)