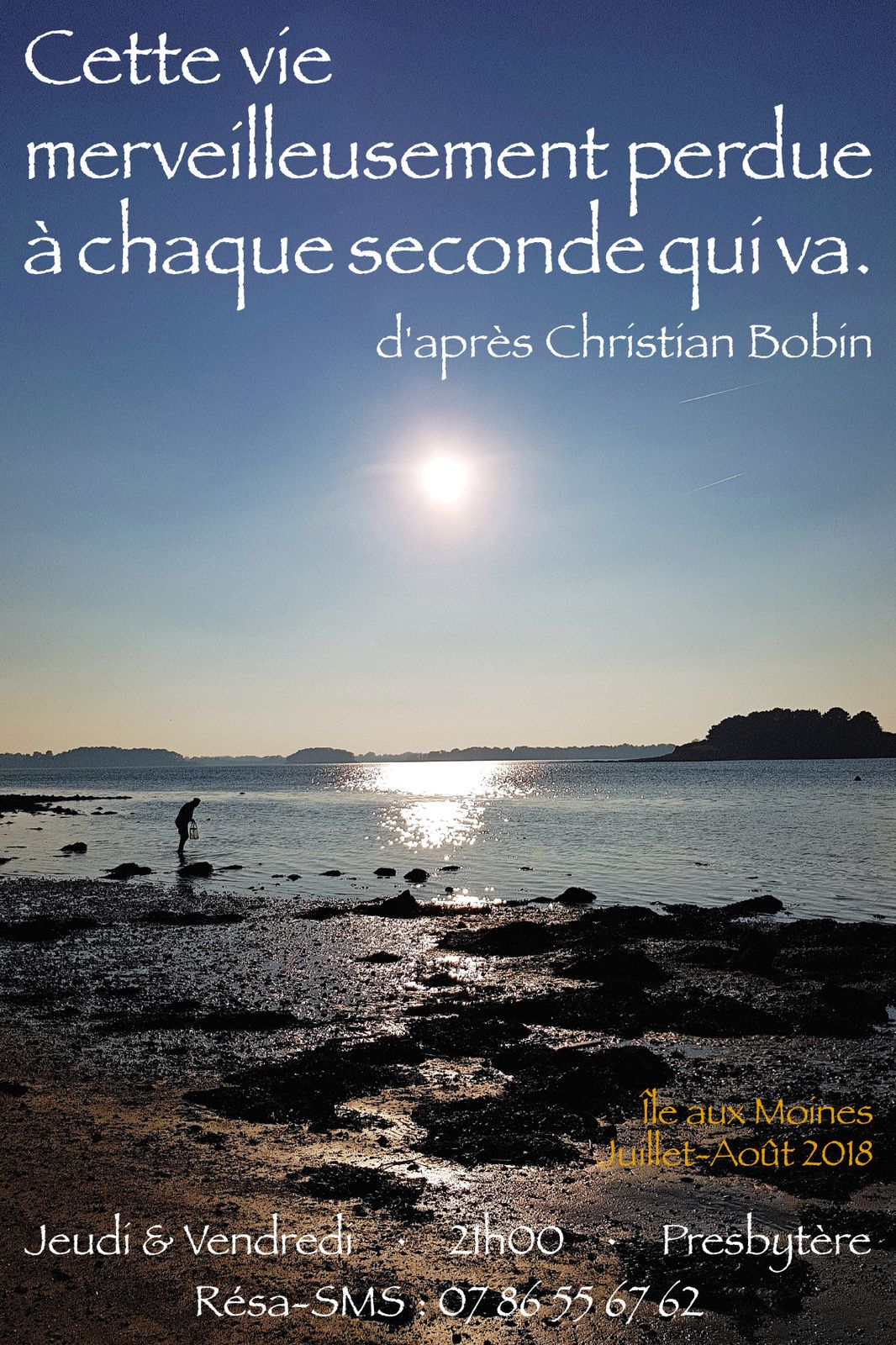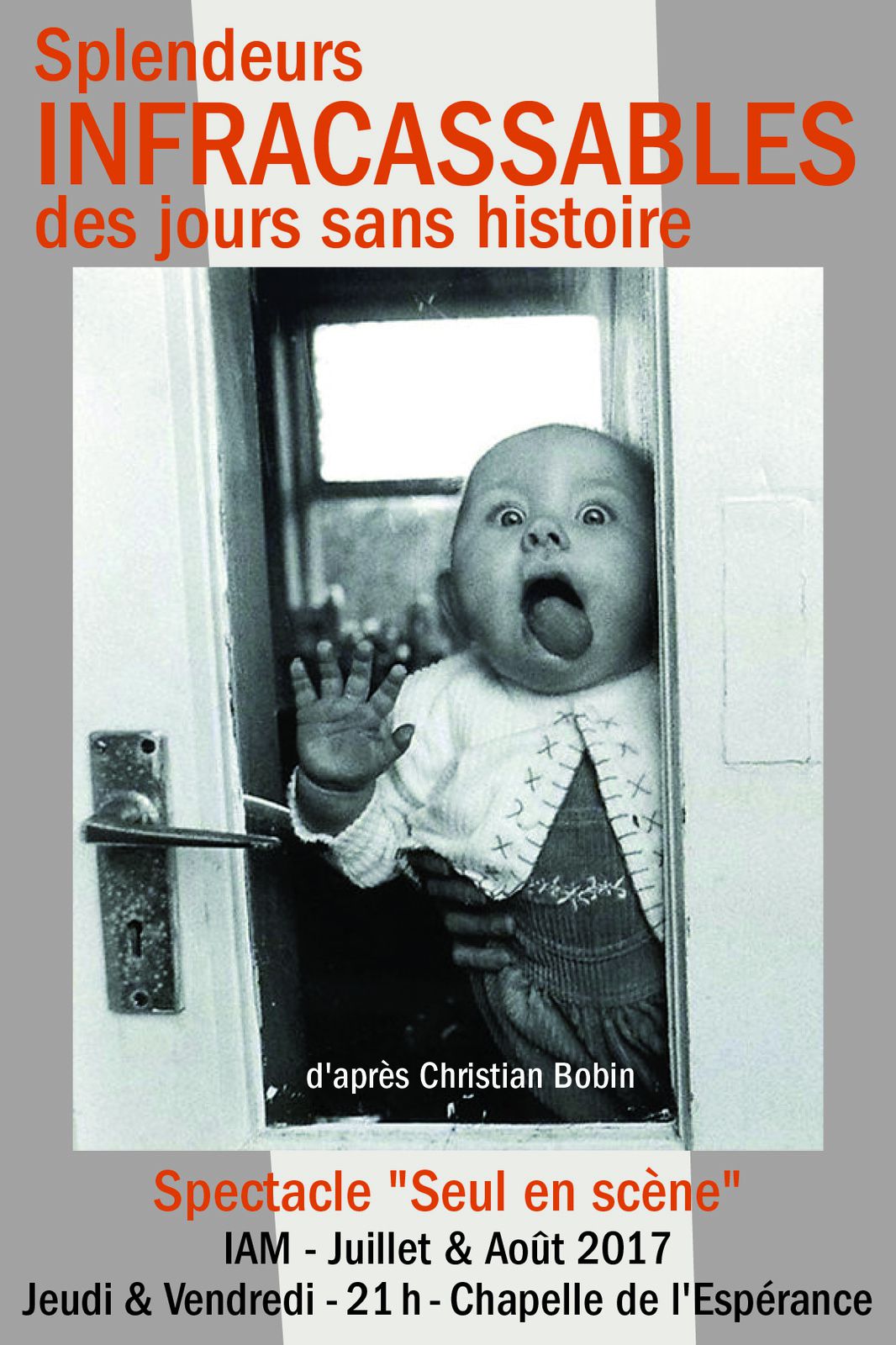Dans la trajectoire de Boris Cyrulnik, il y eut d'abord les livres d'éthologie sur l'affectivité animale. Puis toute la série humaine sur la résilience, qui explique comme un enfant maltraité peut s'en sortir, grâce au regard de l'autre. Paru fin 2006, De chair et d'âme constitue le premier livre d'une nouvelle série sur l'inséparable unité de ce qui constitue l'humain. Ce qui est frappant, c'est la précision ultrafine de ce que l'imagerie médicale est désormais capable de nous apprendre sur ce qui se passe en nous à chaque seconde, quand nous percevons, pensons, croyons, agissons - et comment cela bouleverse notre vision du monde, en décortiquant la genèse neuro-relationnelle de nos organes. Quand un singe regarde un autre singe agir, il met en branle les mêmes processus neuronaux que s'il agissait lui-même. Même processus quand il rêve qu'il se trouve dans telle ou telle situation. Chez l'humain, cette imbrication du réel et de l'imaginaire va au-delà du concevable
Nouvelles Clés : Ce qui frappe dans votre nouveau livre, c'est ce que vous dites sur le malheur. Il ne s'opposerait pas au bonheur, mais constituerait son indispensable complément. C'est leur tandem qui nous rendrait vivants...
Boris Cyrulnik : Toute vie psychique suppose une dualité bonheur-malheur. Privé de cet antagonisme, vous avez un électroencéphalogramme plat, une absence de vie psychique, autrement dit une mort cérébrale. Le couple bonheur-malheur fonctionne comme la manivelle en croix que vous utilisez pour changer les roues de votre voiture. D'un côté vous tirez vers le haut, de l'autre, vous poussez vers le bas, et un observateur étourdi pourrait s'imaginer que ces deux gestes sont contradictoires alors qu'ils constituent un seul et même mouvement. Il en va de même neurologiquement. Dans la partie antérieure de l'aire singulaire de chacun de nos hémisphères cérébraux, il existe deux renflements. Si une tumeur, un abcès ou une hémorragie altèrent le premier de ces renflements, ou si vous y introduisez une électrode, vous allez éprouver des sensations de souffrance, physique et mentale très aiguës. Si vous déplacez un tout petit peu l'électrode, pour la planter dans le second renflement, vous allez éprouver une euphorie qui peut aller jusqu'à l'extase. Le réel n'a pourtant pas changé. Vous avez juste déplacé l'électrode de quelques millimètres. Au regard de la neurologie, le bonheur et le malheur ne sont pas extérieurs au sujet. Ils sont dans le sujet.
N. C. : C'est une découverte récente ?
B. C. : En fait, on le sait depuis les expériences de James Olds et Peter Milner, en 1954. Ces chercheurs avaient placé des électrodes dans le cerveau d'un groupe de rats et montré que la zone de la douleur jouxtait celle de la jouissance. Par ailleurs, ayant équipé les rats de telle sorte qu'ils puissent électriquement auto stimuler ces zones, ils avaient constaté que les animaux n'arrêtaient pas d'appuyer sur le bouton électrifiant la zone du plaisir, sans pouvoir s'arrêter. Au point d'en mourir ! Jouir à mort est un phénomène que l'on trouve aussi dans la nature. S'ils en ont la possibilité, toutes sortes d'animaux poussent leur recherche du bonheur jusqu'à se tuer. Quand les fourmis tombent par exemple sur un certain coléoptère dont la sécrétion lactée les enivre : elles en oublient leurs tâches, vont et viennent en tout sens et la fourmilière finit en un indescriptible chaos. On pourrait citer les pigeons et les corbeaux qui vont se saouler aux vapeurs de sarments, indifférents aux vignes en flammes...
N. C. : Trop de bonheur conduirait à notre perte ?
B. C. : La réalité est paradoxale. Placez des gens dans une situation de bonheur total, où tous leurs vœux sont immédiatement exaucés, où rien ne vient contrarier leurs moindres désirs : ils se retrouvent vite malheureux. À partir d'une certaine dose, tout bonheur devient insoutenable. Par contre, mettez ces mêmes personnes dans un état de malheur, elles vont souffrir, mais aussi lutter : « Je vais me battre contre le malheur et le vaincre.» C'est dans la résistance au malheur que les humains s'associent, se protègent les uns les autres, construisent des abris, découvrent le feu, luttent contre les animaux sauvages... et connaissent finalement le bonheur d'avoir triomphé de leurs peurs.
Malheur et bonheur ne sont pas des frères ennemis. Ils sont unis comme les doigts de la main. On le constate aussi dans le rêve, l'utopie, l'espérance qui sont de grands pourvoyeurs de bonheur. On ne peut espérer que si l'on se trouve dans le mal-être.Le bonheur de vivre vient de ce que l'on a triomphé du malheur de vivre. J'ai faim. Arrive quelqu'un qui me donne son sein - qu'est-ce que je l'aime ! J'ai peur. Voilà quelqu'un qui, par sa force et ses armes, me rassure - qu'est-ce que je l'aime ! Il fait froid. Quelqu'un me réchauffe avec son corps et sa couverture - qu'est-ce que je l'aime ! C'est le paradoxe de la manivelle en croix : d'un malheur peut surgir un bonheur ; sans malheur, ce serait impossible.
N. C. : Il y a là une leçon de philosophie naturelle. Accepter la vie, ce serait accepter aussi le malheur, sans lequel il n'y aurait pas de bonheur. Ne pourrions-nous, de même, pas aimer si nous n'avions pas souffert ?
B. C. : Exactement. Seule la complémentarité entre malheur et bonheur fait que nous pouvons aimer la vie. Des chevaux ailés tirent l'attelage de l'âme dans des directions opposées pour le faire pourtant avancer sur un même chemin, écrivait déjà Platon dans Phèdre.
N. C. : Ce processus se met-il en place dès la naissance ?
B. C. : C'est même de fondement des théories de l'attachement. Après le traumatisme de la naissance, le petit humain découvre le malheur. Il ne connaît rien du monde qui l'entoure. Il a froid. Il a faim.. Il a peur. Il souffre. Il se met à brailler. Et tout d'un coup, hop ! On le prend dans les bras. On lui parle. On le nourrit. On l'essuie. Il a chaud. Il reconnaît l'odeur et les basses fréquences de la voix de sa mère. Il se dit : « Ouf ! ça va, je suis à nouveau tranquille. » Il trouve là un substitut d'utérus, et c'est le premier nœud du lien de l'attachement qui va le rendre heureux. À l'inverse, imaginons un bébé qui ne connaîtrait aucun malheur, dont l'environnement serait impeccablement organisé : température idéale, soif de lait aussitôt soulagée, couches propres dans la seconde, etc. Eh bien, ce bébé n'aurait aucune raison de s'attacher.
N. C. : C'est la vieille histoire du « too much »... L'excès nuit toujours ?
B. C. : Oui. Et il en va de même pour nous. Vous avez soif, vous buvez un verre d'eau. Quel délice ! Mais qu'éprouvez-vous au cinquantième verre d'eau ? Du dégoût. C'est un supplice. De même, si la mère entourait son enfant trop longtemps, si elle ne le laissait pas seul au bout d'un moment, il se retrouverait prisonnier d'un cocon étouffant et en viendrait à éprouver de la douleur. « Si maman ne m'entoure pas, je souffre. Mais si elle m'entoure trop, je souffre aussi. » L'être humain ne peut se construire que dans l'alternance, la respiration bonheur-malheur. Et si cette dernière doit être la plus harmonieuse possible, elle doit également suivre un certain rythme. Car, si le bonheur ne peut durer, le malheur non plus...
Si on laisse pleurer le bébé pendant une heure, ça peut aller ; deux heures, ça devient beaucoup ; au bout de trois heures, ça commence à devenir difficile. Arrive un seuil où tout bascule. Le bébé arrête de pleurer. Il commence à s'éteindre. S'il n'est pas rapidement secouru, son système nerveux va interrompre son développement. J'ai été l'un des premier à décrire les atrophies cérébrales liées à une carence affective. Au début, bon nombre de neurologues ne m'ont pas cru : « Ce n'est pas possible, vous vous trompez. » Aujourd'hui, de nombreux confrères confirment cette observation, notamment aux États-Unis. Tous les pédiatres qui travaillent dans les pays en guerre ou en misère savent que les enfants abandonnés ne pleurent pas. Ils attendent la mort en silence. Ils sont morts psychiquement avant de mourir physiquement. Leurs cellules cérébrales sont les premières à s'étioler puisqu'elles ne sont plus stimulées. Puis la base du cerveau arrête ses sécrétions hormonales. Et tout le corps dépérit. Le contre-exemple existe : mettez un enfant abandonné atteint de nanisme affectif dans une famille d'accueil, son cerveau va peu à peu reprendre son développement, c'est rigoureusement vérifié au scanner.
N. C. : Vous évoquez souvent l'image d'une « enveloppe affective sensorielle, faite à la fois de molécules que de mots », absolument vitale au développement de l'enfant. Comme l'a été l'enveloppe matricielle de sa mère...
B. C. : Absolument. Chez l'enfant, il y a d'abord une longue période d'intelligence sans parole. L'enfant décode le monde non par des mots, mais grâce à des images. Puis vient le stade de la parole maîtrisée, vers trois ans. La parole récitée, elle, c'est-à-dire la capacité à faire un récit de soi-même, n'arrive qu'à sept ans, quand les connexions du lobe préfrontal de l'anticipation se sont connectées au circuit de la mémoire - sans quoi vous ne seriez pas capable de vous faire une représentation du temps. Or, toute cette maturation neurologique et hormonale ne se fait que si vous avez cette enveloppe affective autour de vous. Une enveloppe qui, donc, respire, avec flux et reflux, inspiration et expiration, diastole et systole. La vie fonctionne ainsi : par contraste. Et nos sens aussi : pour que le concept « bleu » me vienne en tête, il faut qu'il y ait autre chose que du bleu dans mon champ de vision ; s'il n'y avait que du bleu, je ne pourrais pas le penser. Pour penser le bonheur, il faut qu'il y ait autre chose que du bonheur : le malheur est parfait pour ça.
N. C. : Autre paradoxe, vous écrivez que la parole a une fonction bien plus affective qu'informative.
B. C. : On se parle pour s'affecter. Par mes mots, je peux modifier votre état physique, vous faire pâlir, rougir, rire, bailler, hurler. Si je fais des phrases, c'est pour vous convaincre, vous amuser, vous irriter, vous insulter, vous calmer... davantage que pour vous informer. Et il est à peu près impossible de parler longtemps à quelqu'un sans affecter ses sentiments.
N. C. : Vous dites: « Quand je suis face à Véronique, j'ai une certaine chimie intérieure. Face à Marion, c'en est une autre. Je ne suis littéralement pas le même moléculairement. »
B. C. : La présence de Véronique me stimule. Tout ce qu'elle dégage - qu'elle me communique implicitement par ses formes, son odeur, ses vêtements, ses gestes, sa voix, ses mots - touche quelque chose d'inscrit au fond de ma mémoire neuronale, sans doute depuis l'âge fœtal. Tout se passe à son insu et j'en suis également inconscient, mais tout ce qui vient d'elle m'intéresse et m'amuse. Du coup, toutes mes catécholamines sont stimulées, condition biologique favorable à la mémorisation. Alors que Marion me renvoie, sans s'en rendre compte non plus, toutes sortes de messages qui ne me touchent pas et ne constituent donc pas un événement pour moi. Or, nous ne pouvons pas mettre en mémoire un non-événement.
N. C. : N'est-ce pas ce qu'en langage courant on appelle avoir des « atomes crochus » ?
B. C. : Si vous voulez. Avec des dosages et des catalyses étonnants. Les entraîneurs d'équipes sportives le savent bien, qui recrutent certains joueurs plus pour l'ambiance positive qu'ils vont mettre dans l'équipe que pour leurs qualités intrinsèques. À l'inverse, il m'est arrivé de voir une excellente équipe de scientifiques lamentablement sombrer dans le spleen, simplement parce qu'on avait recruté un chercheur qui, par sa seule présence, stérilisait ou inhibait le travail de tous les autres ! On connaît ça en éthologie animale, par exemple chez les chimpanzés, où l'arrivée d'un nouvel individu va faire que tous les autres deviennent maladroits, laissent tomber les objets qu'ils tiennent, ratent les branches qu'ils visent : ils sont crispés, leur chimie intérieure est déséquilibrée.
N. C. : N'est-ce pas aussi au sein de cette enveloppe que naît la compassion, quand un animal souffre de ce qui arrive à un autre ?
B. C. : Je le pense en effet, même si de jeunes confrères normaliens sont en désaccord avec moi. Vous faites allusion aux « neurones miroir ». Un chimpanzé voit un être signifiant (un congénère, par exemple, ou un être humain qu'il connaît) s'apprêter à manger un aliment qu'il aime (mettons une banane). Automatiquement, il allume la partie de son cerveau qui le prépare à faire le même geste, par exemple tendre la main vers la banane. En même temps, il stimule son lobe préfrontal pour bloquer ce geste, qui doit rester imaginaire - ce qui fait que le cerveau du chimpanzé qui observe dépense deux fois plus d'énergie que celui du chimpanzé qui mange réellement !
De façon similaire, que je sois homme ou singe, si un personnage signifiant de mon enveloppe affective, quelqu'un que j'aime bien, souffre, je vais allumer la partie antérieure de mon aire singulaire antérieure, celle qui déclenche des sensations de souffrance. Ce n'est pas moi qui souffre, mon organisme est impeccable, pourtant ma zone de souffrance s'allume et déclenche en moi une sensation de malaise. Alors, que c'est lui qui souffre. Mais je le vois et ça me fait entrer en résonance, parce que c'est un personnage signifiant pour moi. Sa souffrance et la mienne sont de nature différentes. Lui, il est blessé, il saigne. Moi, je souffre de la représentation que je me fais de sa souffrance.
N. C. : Dans son documentaire Shoah, Claude Lanzmann interviewe un paysan polonais qui labourait un champ près d'Auschwitz. « Alors vous labouriez à deux pas des barbelés, lui demande-t-il, ça ne vous faisait pas mal ? » Et l'autre de s'étonner : « Pourquoi auriez-vous voulu que ça me fasse mal à moi ? Si l'on vous coupe vos doigts, les miens vont bien ! »
B. C. : Cet homme est un pervers, pas au sens sexuel, mais par arrêt d'empathie. Les pervers ont, dans le développement de leur personnalité, quelque chose qui s'est déréglé dans l'empathie, soit par excès, soit par défaut. Par défaut, c'est ce que vous racontez : si vous vous coupez le doigt, c'est vous qui avez mal, pas moi - donc, si l'on brûle des milliers de personnes dans des fours, ce sont eux qui brûlent ; moi, je laboure tranquillement mon champ. Les situations de guerre pousse des masses de gens à basculer dans cette pathologie, puisque, si l'on veut gagner la guerre, il faut ignorer l'autre, le chosifier.
À l'inverse, l'excès d'empathie, c'est Leopold von Sacher-Masoch, dont on a fait l'archétype du masochiste : « Moi, je ne compte pas, je ne suis rien, quasiment mort psychiquement, je ne jouis plus. Mais si le fait de me faire souffrir fait plaisir à Wanda, la Vénus au manteau de fourrure, au moins éprouverai-je le plaisir de lui faire plaisir. Elle seule compte. En me maltraitant, en me fouettant, elle me donnera un petit sursaut de vie. »
N. C. : Et si l'on vit dans une enveloppe sensorielle « positive », peut-on user de son empathie à son propre égard ? Ce serait une façon d'expliquer que l'on puisse volontairement influencer son état physique et « reprogrammer » sa santé...
B. C. : Je ne suis pas spécialiste de la question. Mais il est clair que les êtres humains peuvent intentionnellement se « recircuiter », c'est-à-dire s'entraîner à fonctionner et à « se représenter » autrement. Je pense que la psychothérapie fonctionne de cette façon... quand ça marche ! Cela dit, je n'utiliserais pas le mot « reprogrammer », parce qu'aujourd'hui, nous savons que personne n'est programmé. Même génétiquement. L'idée que nos gènes nous déterminent a fait long feu.
Quelle est la conclusion du fameux « décryptage du génome humain » ? Vous avez entendu ce silence ! (rire) La conclusion, c'est que nous avons à peu près le même génome que les vers de terre (il paraît que les vers de terre sont vexés !) et que nous sommes comme des chimpanzés à plus de 99% ! Il y a donc moins de 1 % de différence entre un chimpanzé et un humain. Mais qui parle de « programme génétique » ? Des journalistes, des psychologues, des psychiatres, jamais des généticiens ! Attention, je ne nie pas l'existence d'un déterminant génétique. Lorsque le spermatozoïde de votre père a pénétré l'ovule de votre mère, ça ne pouvait donner qu'un être humain, pas un chat, ni un vélomoteur. Mais ça n'était en rien prédestiné à devenir vous !
Le déterminant génétique donne un être humain. Mais pour donner telle personne réelle, il faut toute la condition humaine, la mémoire, la culture, l'histoire. La moindre variation de l'environnement modifie l'expression des gènes. Mieux : à l'intérieur d'un même gène, un morceau de gène sert d'environnement à un autre morceau ! Par exemple, vous avez des déterminants génétiques du diabète, mais sans diabète, parce qu'une autre partie du même chromosome du même bonhomme induit la sécrétion d'une insuline empêchant l'expression de la maladie. Autrement dit, l'environnement commence dans le gène lui-même ! Nous sommes pétris par notre milieu autant que par nos gènes. Je crois ainsi que la distinction gène/environnement - c'est-à-dire inné/acquis - est purement idéologique et pas du tout scientifique. Le gène est aussi vital que l'environnement, ils sont inséparables. Nous sommes déterminés à 100 % par nos gènes et à 100% par notre environnement. Scientifiquement, je dois dire que cela redonne du poids à la théorie de Lamarck, jadis pourfendue par Darwin : il n'est pas forcément faux de dire que les girafes naissent avec un long cou parce que leurs ancêtres ont beaucoup tiré dessus pour manger en hauteur - alors que l'auteur de L'évolution des espèces n'y voyait que le fruit d'un hasard écologiquement favorable...
Là où Darwin continue d'avoir brillamment raison, c'est quand il dit que les espèces disparaissent par leur point fort. Les élans du Canada réussissaient à se protéger, grâce à leurs formidables bois, lourds et tranchants, qui éventraient les loups d'un simple geste de la tête. Mais les bois sont devenus de plus en plus lourds, à tel point que les grands mâles ne sont même plus parvenus à se redresser... et les loups en ont profité pour apprendre à les égorger ! Le point fort de l'humanité, par lequel nous sommes clairement menacés de disparaître, c'est notre intelligence technologique, désormais si puissante qu'elle modifie la biosphère...
N. C. : Ce qui, si l'on fait preuve d'empathie, nous plonge dans la déprime. N'est-ce pas pour cela, par sentiment d'impuissance, que tant de gens prennent des antidépresseurs ? À ce propos, pourquoi selon vous les Français en consomment-ils tant ?
B. C. : Actuellement, le plus grand consommateur est l'Iran. Mais il faut se méfier de ces comparaisons, culturellement biaisées, car chaque pays gère la dépression à sa manière. Les gens se suicident, somatisent, consomment de la fausse médecine, passent de faux examens, parce que le problème n'est pas posé. Il est clair que l'on compense par la chimie une défaillance culturelle. On prend des molécules pour se sentir moins mal, alors que normalement, c'est la relation humaine qui devrait jouer ce rôle. Relation familiale, amicale, villageoise, professionnelle, confessionnelle, politique, artistique... peu importe. Si nous vivions comme jadis dans des structures affectives, nous n'aurions que rarement besoin de psychotropes et d'antidépresseurs. Mais notre culture a détruit ça.
Pour bien se porter, il faut participer à la vie sociale. Je suis convaincu que c'est fondamental. Ici, dans le Var, il y a beaucoup de retraités espagnols, ex-réfugiés, républicains comme franquistes. Ils prennent des antidépresseurs, comme tout le monde. Mais dès qu'ils vont voir leurs familles en Espagne, ils arrêtent d'en prendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a là-bas une vie sociale beaucoup plus intense que chez nous, avec notamment des fêtes incessantes. Quand vous êtes tout le temps en cuisine, en train de vous maquiller ou de vous entraîner pour le lâcher de taureaux, vous vous couchez à trois heures du matin, et vous n'avez plus besoin de psychotropes. Mais dès qu'ils reviennent ici, hop ! ils reprennent des psychotropes.
N. C. : Pourquoi certains pays, la France en particulier, ont-ils une vitalité locale si molle ?
B. C. : Norman Sartorius, l'un des directeurs de l'OMS avec qui j'ai travaillé, a dirigé un énorme travail sur ce thème dans plusieurs pays. Sa conclusion est tragique : plus la solidarité est administrative (sécurité sociale, RMI, indemnités de chômage, etc),moins elle est affective et moins elle joue son rôle de tranquillisant naturel, qui est la base du sentiment de sécurité. « Je te connais ; quand je suis avec toi, on se raconte des histoires qui nous sécurisent ; tu as de l'expérience, je te fais confiance ; tu auras des solutions, parce que je t'attribue un pouvoir. » C'est incontestable : plus la solidarité est administrative, plus le désert affectif se développe.
Si nous ajoutons à ça le fait que l'amélioration de la technologie s'accompagne partout d'une augmentation de l'isolement, de l'angoisse et des dépressions, nous nous retrouvons avec un joli casse-tête. Parce que, bien sûr, il n'est pas question d'arrêter le progrès technologique, ni celui des systèmes sociaux de solidarité. C'est donc à chacun de savoir augmenter la communication affective dans sa vie - prendre le temps de cuisiner lentement, de recevoir des amis, de rire en faisant les andouilles... Il faut multiplier les rituels de rencontres, les fêtes de quartiers, les retrouvailles de toutes sortes, les chorales, les associations de pétanque, les tables d'hôte... Dès que vous rencontrez des gens et que vous buvez un verre avec eux, vos fantasmes agressifs baissent. Ça ne règle pas tout, mais vous mettez en place un rituel d'interactions affectives qui a un grand effet tranquillisant. C'est juste vital pour l'humanité.
http://www.cles.com/debats-entretiens/article/pour-etre-heureux-il-faut-avoir-souffert
A lire
- De chair et d'âme, Boris Cyrulnik, éd. Odile Jacob.
- La fabuleuse aventure des hommes et des animaux, Boris Cyrulnik, Karine lou Matigon. éd. Le Chêne.
- Les nourritures affectives, Boris Cyrulnik. éd. Odile Jacob.
- Le murmure des fantômes, Boris cyrulnik. éd. Odile Jacob.
 : les fées etles diables font bon ménage. Il y a des pierres, de l’eau, du ciel et des visages – et ton nom partout chantant dessous le nom des pierres, de l’eau et des visages.
: les fées etles diables font bon ménage. Il y a des pierres, de l’eau, du ciel et des visages – et ton nom partout chantant dessous le nom des pierres, de l’eau et des visages.
/image%2F0991062%2F20191125%2Fob_e0f916_thumbnail-img-8110.jpg)
/image%2F0991062%2F20180321%2Fob_e92b85_20161025-172451.jpg)












/http%3A%2F%2Fculturebox.francetvinfo.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffilefield_paths%2Fdamnes_culturebox_4.jpg)