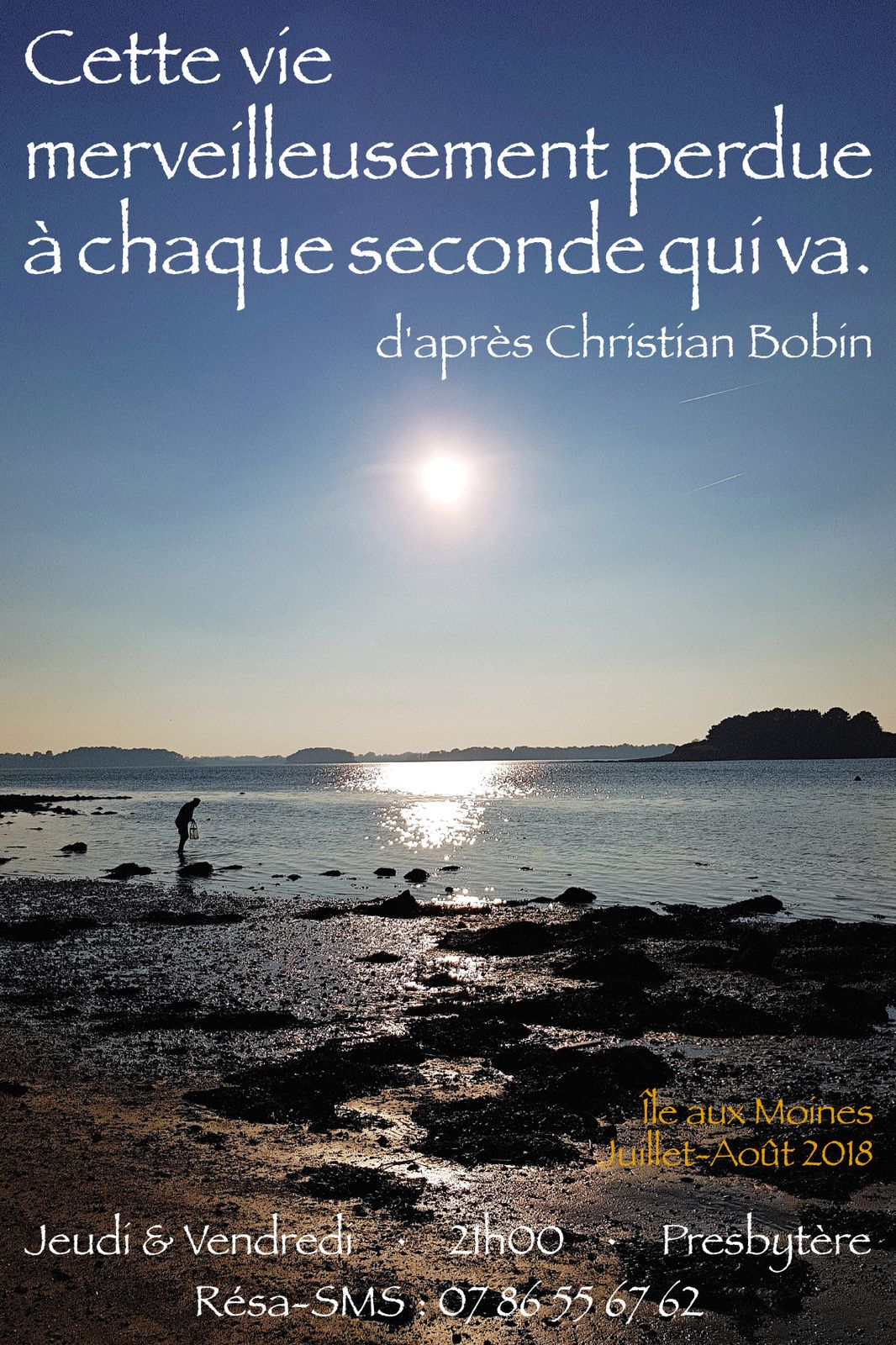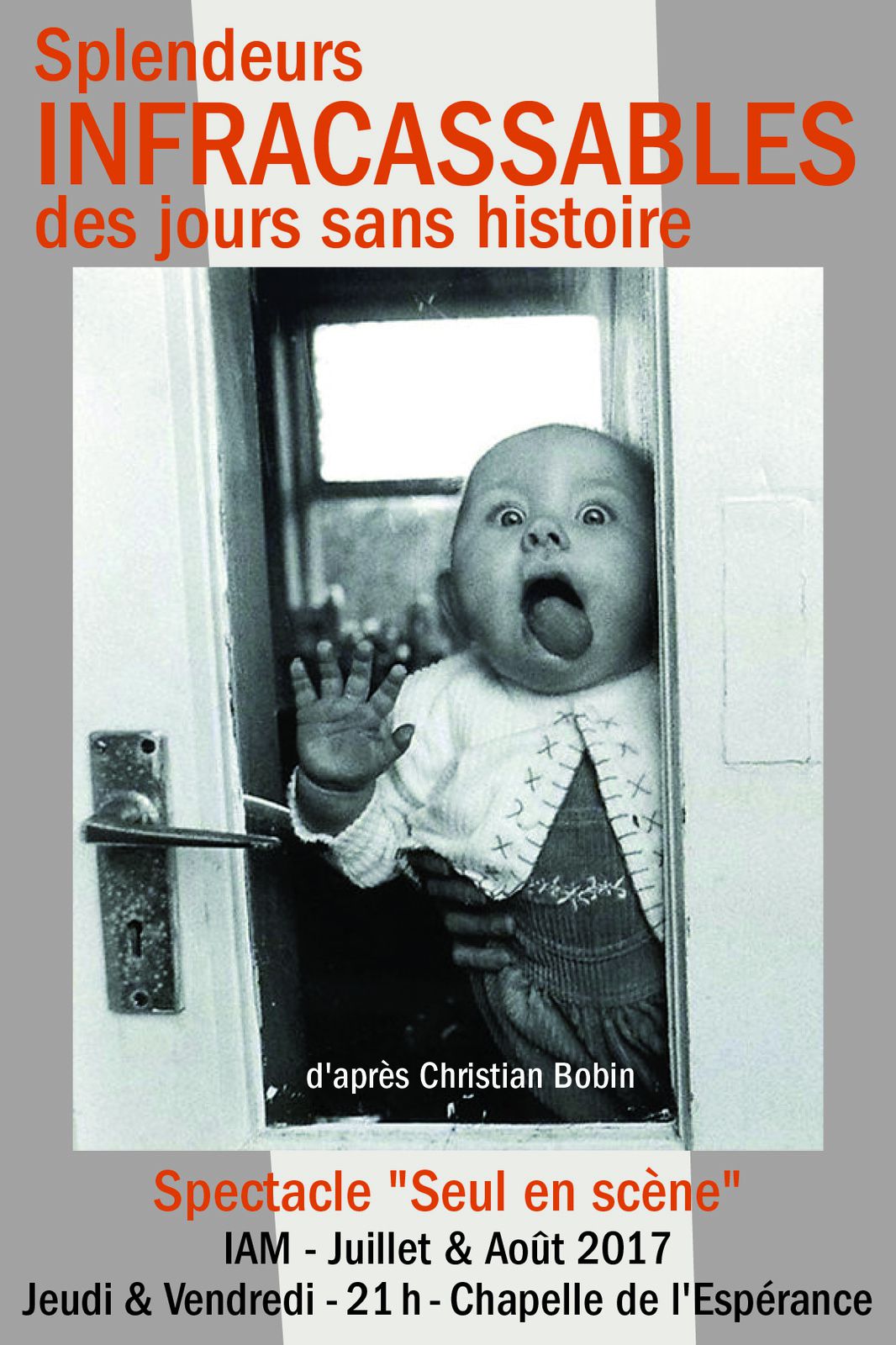Sens et décence du travail...

Laissons un début célèbre débuter notre propos. N’y a-t-il pas, en effet, introduction plus appropriée que l’incipit de La Peste d’Albert Camus[1] où le narrateur, encore anonyme, présente ainsi la petite société d’Oran, un narrateur [2] qui insiste à chaque page sur la vie en communauté menée avec ses « concitoyens »?
« Une manière commode de faire la connaissance d’une ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre petite ville - est-ce l’effet du climat - tout cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent. C’est-à-dire qu’on s’y ennuie et qu’on s’y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours pour s’enrichir. Ils s’intéressent surtout au commerce et ils s’occupent d’abord, selon leur expression, de faire des affaires. Naturellement, ils ont du goût aussi pour les joies simples, ils aiment les femmes, le cinéma et les bains de mer. Mais, très raisonnablement, ils réservent les plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant, les autres jours de la semaine, de gagner beaucoup d’argent. »
Dans sa déclamation actuelle au théâtre des Mathurins à Paris, Francis Huster qui fait vivre cette « chronique imaginaire » sur les planches prononce les expressions « pour s’enrichir », « gagner beaucoup d’argent » et « faire des affaires » de manière spécifique et appuyée, avec agacement. Joignant le geste à la parole, l’acteur dessine de la main son dégoût, dans l’air, donnant un relief péjoratif aux préoccupations vénales et peu élevées de la population d’Oran livrée à l’habitude et à l’ennui. Les leitmotive de l’œuvre sont lancés, travail, amour, mort. Et quelques chapitres plus loin, l’un des personnages du roman, Joseph Grand, explique au Docteur Rieux pourquoi sa femme est partie sans crier gare :
« Le reste de l’histoire … était très simple. Il en est ainsi pour tout le monde : on se marie, on aime encore un peu, on travaille. On travaille tant qu’on en oublie d’aimer ».
Qu’est-ce qu’un travail humain ?
Notre romancier est également philosophe et c’est en philosophe que le romancier lance les bases de sa fiction humaniste nommant en premier l’une des dimensions fondamentales de l’homme, son travail, mais pour la mettre tout de suite en concurrence avec une deuxième dimension fondamentale, l’amour. Quand l’auteur du Mythe de Sisyphe stigmatise les habitants d’Oran travaillant, aimant, mourant, « faisant tout cela ensemble du même air frénétique et absent », il leur reproche de ne pas trouver, de ne pas donner de sens à leur travail, à leur amour, à leur mort ; il reproche aux concitoyens de Rieux de vivre en anesthésiés, de vivre dans l’absurde sans but qui puisse éclairer le chemin. Tel Sisyphe poussant son rocher, les citoyens d’Oran traînent leur travail dans une répétition égoïste sans sens, condamnés à une réduplication réductrice car sans finalité, se condamnant à une routine d’autant plus mortifère qu’elle est méthodique et raisonnable. Particulièrement révélateurs, les adjectifs « frénétique » et « absent » qualifiant « l’air » des membres de cette société. Synonymes de « fou », de et de « sans conscience », ils révèlent ni plus ni moins l’absence d’humanité de vies d’automates, vidées de toute liberté, de vies dégradées.
La question est brûlante. Les habitants d’Oran tels que Camus les dépeint nous ressemblent plus que jamais. Le roman, quoique écrit en 1947, n’est finalement pas si daté et continue à interroger les convulsions de notre société postmoderne en crise. Qu’est-ce qui donne sens au travail ? Comment faire pour qu’un travail soit véritablement humain ? C’est notre question avec celle de la décence qu’il implique pour être véritablement travail digne de l’homme, travail rendant l’homme digne de lui-même.
Le travail, un bien pour l’homme
Travailler est le propre de l’homme, occupe le temps de l’homme. C’est dans sa nature de travailler. Les diverses activités qui remplissent sa vie disent un statut de son corps, puisqu’avec ce corps il domine alors la matière qu’il ennoblit en transformant le monde. L’homme travaille de ses mains, utilise pour cela sa force vitale, se sert de son esprit. Il développe des talents, exerce son génie pour produire et faire. Il aboutit à une œuvre, dans laquelle il se reconnaît, de laquelle il se nourrit. C’est cette œuvre qui le réjouit, qui le satisfait, œuvre fruit de son travail, œuvre également qui justifie le salaire. Dimension individuelle bien sûr du travail. Mais dimension collective également : l’homme en travaillant accroît le bien commun d’une société et par là peut la rendre plus libre.
On m’objectera que travailler n’est pas souvent perçu comme cela, avec son angle de peine et d’effort rude. Le mot « travail » n’a-t-il pas à voir avec un instrument de torture d’esclave, ce tripaliumantique composé de trois pieux ? Le récit judéo-chrétien de la chute originelle n’a-t-il pas d’ailleurs gauchi notre vision du travail quand l’interprétation insiste autant sur le châtiment d’Adam transmis à toute l’humanité, sur ce « tu travailleras à la sueur de ton front[3] » retenu comme une seule obligation pénible, et comme séparation de Dieu ? (« Tu travailleras à la sueur de ton front », mot à mot « tu mangeras ton pain à la sueur de ton front » où l’on voit qu’on doit travailler en vue de son pain quotidien, de sa subsistance, ce qui fera dire à saint Paul : « que celui qui ne travaille pas qu’il ne mange pas non plus !…) Sans aucun doute l’assimilation du monde, son appropriation après la chute est difficile. Mais chacun en a fait l’expérience, quand l’homme travaille en voyant le sens de ce qu’il fait, même au prix de fatigues physiques, cela l’épanouit. Preuve donc que le travail n’est pas que peine. Quand il n’est pas simple instrument mais partie prenante d’une œuvre à faire, l’homme aime travailler, c’est un bien pour lui ; encore faut-il qu’il soit un bien utile, un bien digne. C’est un gage de son développement, de la croissance de sa personne, de son élévation spirituelle. En travaillant l’homme devient ce qu’il est et grandit en humanité. Tout homme a le droit de vivre cela.
Ne pas travailler, un mal
À l’inverse, ne pas travailler est un mal, plus qu’un préjudice, une profonde souffrance, une injustice. La plaie du chômage ne nous le rappelle que trop en inversant les choses : travailler n’est plus obligation ; avec les subventions, l’on mange sans travailler ; on enlève au travailleur la possibilité de se réaliser en tant qu’homme. Plaie également d’une certaine mécanisation, des machines supplantant parfois l’homme ou le rendant esclave.
Éloquent à ce titre, le film récent Ma part du gâteau (Cédric Klapisch, 2011). Il s’ouvre sur la tentative de suicide d’une salariée de Dunkerque. Cette mère de famille divorcée, élevant seule ses trois enfants, voit soudain sa vie basculer quand les licenciements la touchent elle aussi après avoir travaillé vingt ans pour la même entreprise. C’était toute sa vie. « Elle était possédée par son histoire » dirait Florence Aubenas[4]. Le sentiment de gâchis et d’injustice atteint son paroxysme. D’où son désespoir. Et c’est bien compréhensible. La nature du travail n’est pas seulement liée à l’objet exécuté, mais aussi à celui qui l’exécute, c’est-à-dire à une personne libre. Se séparer de travailleurs comme de vulgaires choses - « on n’est rien » dit l’héroïne dans le film – est strictement contre nature, indécent. Les chômeurs, des laissés-pour-compte, voilà ce que produit notre société au lieu d’en faire des partenaires, d’en mesurer le profit potentiel, d’utiliser leur capacité de travail. Nul doute que les économistes auraient là de bonnes pistes de réflexion.[5]
Importance de la dimension subjective du travail
Dans Laborem exercens, la troisième des quatorze encycliques écrites en vingt-sept ans de pontificat, Jean-Paul II, l’ex-mineur d’une Pologne broyée par un communisme dépersonnalisant, rappelle ce distinguo traditionnel que l’Église a toujours fait et ne cesse d’affirmer à temps et à contretemps dans notre âge de fer, rappelle que l’homme ne saurait être traité comme un instrument de production, en « force anonyme », ne saurait être « traité de la même façon que l’ensemble des moyens matériels de production », et non selon la vraie dignité de son travail :
« Les sources de la dignité du travail doivent être cherchées surtout, non pas dans sa dimension objective mais dans sa dimension subjective… Le premier fondement de la valeur du travail est l’homme lui-même, son sujet. Ici vient tout de suite une conclusion très importante de nature éthique : bien qu’il soit vrai que l’homme est destiné et est appelé au travail, le travail est avant tout « pour l’homme » et non l’homme « pour le travail ». … Le but du travail, de tout travail exécuté par l’homme – fût-ce le plus humble service, le travail le plus monotone selon l’échelle commune d’évaluation, voire le plus marginalisant – reste toujours l’homme lui-même. » (n.6)
Le pape slave connaissait la dure réalité du travail en Union soviétique et dans ses pays satellites. Tous ceux qui ont connu les camps de travail dans des systèmes totalitaires savent à quel point le travail forcé peut nier l’homme, lui extorquant sa liberté et sa dignité. J’ai en tête l’épisode que rapporte Soljenitsyne dans Une journée d’Ivan Denissovitch, l’épisode des énormes numéros usés par la pluie et le vent qu’on était obligé de repeindre à la peinture blanche sur les dos des zek : le travailleur, un numéro. Quand on nous donne en modèle actuellement les pays asiatiques qui, euxsavent travailler – combien de fois n’entend-on pas cela – je me demande si l’on n’est pas prêt à retomber dans les pires travers qu’une Histoire proche pourtant a stigmatisés, croyant que les sorties de crise passent par leurs façons de tout sacrifier au travail.
Travail et repos : une alternance de décence
Mais l’homme est l’homme. Et ce qui est un bien pour l’homme occidental l’est également pour l’homme oriental, pour tout homme : aspiration à la liberté, à une compatibilité de la vie personnelle avec la vie professionnelle, compatibilité de la vie professionnelle avec la vie familiale. Jouissance d’un repos le dimanche bon pour tous, bien loin d’être « une stupidité économique »[6]. Dans les lignes liminaires du roman de Camus le lecteur note que même les habitants d’Oran ne font pas de commerce le samedi soir et le dimanche ; ils les réservent aux plaisirs, à des « joies simples ».
« Jour des liens », comme l’ont appelé certains. Jour où, comme le dit notre ami Joseph Thouvenel de la CFTC, « l’on met entre parenthèses la consommation et la production pour autre chose ». Jour où l’on « fait société » comme le dit le Docteur en droit Daniel Perron, jour pour Dieu surtout où les catholiques célèbrent l’Eucharistie qui forme l’Église.
Notre Constitution garantit en son article premier une République « sociale ». N’est-il donc pas incohérent le Gouvernement qui touche au jour censé créer le lien social qui se délite un peu plus chaque jour ? Le dimanche est jour d’un travail « invisible », du travail bénévole[7], gratuit. Jour d’une « véritable valeur ajoutée de la cohésion sociale ». Le moteur, on le voit, n’est plus alors l’argent mais le don. C’est ainsi que le sens du travail se révèle paradoxalement lorsqu’on ne travaille pas, quand l’homme prend ce repos, quand l’homme prend conscience de ce qu’il a fait, de ce pour quoi il est fait. Il est alors décent de donner ce jour à tous.
DÉCENT, mot que l’Organisation International du Travail met à l’honneur dans ses codes. Décence selon le dictionnaire historique d’Alain Rey (Bordas) vient de « decens et est employé au sens moral de « convenable » « séant » ». Venant « du participe présent de decere, décent est surtout employé en construction impersonnelle. Decet, il convient. » « Mot spécialisé sur le plan de l’acceptabilité selon les normes sociales et signifie correct, acceptable. » Actuellement, travailler le dimanche et les jours fériés, travailler la nuit n’est toujours pas du travail décent. Jusques à quand ? Une dérégulation puissante est en marche.
Au niveau chrétien, le travail sanctifie le temps
Revenons encore à ce portail de La Peste. Les habitants d’Oran ne travaillent « que pour s’enrichir ». N’y aurait-il pas un autre but plus humain au travail ? Ce que nous révèlent les Écritures nous invite, en effet, à penser plus haut encore. Surtout nous, qui ne sommes plus les hommes d’après la chute mais les hommes de la Nouvelle Alliance, les hommes d’après la Croix, la grande œuvre de Dieu. Le travail, malgré son statut très rude depuis le jardin d’Eden, est une grâce donnée à l’homme pour sanctifier le temps. C’est même par le travail que l’homme va sanctifier le temps. L’amour ne se mesure pas, on n’aime pas trente-cinq heures par semaine ; quand on aime quelqu’un, on l’aime tout le temps même quand on n’y pense pas et même après sa mort. Le temps mesure le travail : on travaille deux heures et en sanctifiant son travail, on sanctifie le temps. Dans cette lumière on se rend encore mieux compte à quel point le travail doit être humain car la grâce ne peut s’enraciner que dans ce qui est humain. Alors plus le lieu de la grâce atteindra sa finalité naturelle, plus la grâce s’épanouira pleinement. N’est-ce pas normal d’offrir à Dieu, de rendre sacré, ce que l’homme a de meilleur ? Peut-on rendre sacré un travail inhumain ? C’est donc impératif pour un chrétien de faire un travail humain et d’offrir aux autres un travail qui respecte toute leur personne. Accomplir un travail humain, c’est se rendre justice à soi-même ; offrir un travail humain quand on est patron, c’est rendre justice aux autres ; et n’est-ce pas justice que d’offrir à Dieu un travail digne de ce nom ?
Dieu laisse à l’homme rien moins que de coopérer à sa création qui n’est pas achevée. Il lui laisse ainsi de se sanctifier par son travail, lui laisse un jour particulier sans travail, de repos, pour qu’il pense aux fins de son corps mortel promis à autre chose qu’à la putréfaction. Le jour sans travail, le repos hebdomadaire, une fois par semaine, donné le dimanche, a un visage, il ne ressemble pas aux autres jours. Il porte une valeur prophétique, celle que ce corps qui a travaillé, aimé et qui va mourir, pour reprendre la trilogie camusienne de tout à l’heure, est appelé à la vie qui dure toujours, à la vie éternelle, à être corps glorieux. Le dimanche ? Un jour vital pour ne pas s’aliéner aux choses matérielles donnant sens au travail des six autres jours. Un jour pour tous, pas un luxe pour un petit nombre. Est grandement responsable l’employeur qui fait main basse sur un tel jour et qui pour un profit « maximal » accapare ce qui ne lui appartient pas, oublie un principe énorme, la destination universelle des biens, droit commun de tous à utiliser les biens de la création.
Dans trois jours, ce 7 octobre, se déroulera la Journée Mondiale du Travail Décent (JMTD). Pourquoi ne pas participer à cet événement chacun à sa manière en se posant cette question simple : pour qui est-ce que je travaille ? Pour moi ? pour ma famille ? pour la société à laquelle j’appartiens ? et dans quelle proportion ? À quel bien commun est-ce que je participe ? Relisons aussi, pourquoi pas, Laborem exercens, première encyclique sociale de Jean-Paul II, pape qui a travaillé à son travail de pape avec une ardeur peu commune. Bel anniversaire en effet que ce jour de 1981 où cette encyclique a été écrite pour le monde entier[8], il y a tout juste trente ans. Non l’argent vulgaire ne peut être la clé du travail de l’homme avec comme seul moteur la cupidité pourrissant le cœur d’hommes qui « s’appliquent » à ne posséder que pour posséder. Ce « faire des affaires » que critique Camus via son narrateur concernant les habitants d’Oran.
Travailler, aimer, mourir. Travailler et pouvoir aimer encore. Travailler pour ne pas mourir comme une bête. Travailler, aimer, mourir. Non plus avec un air frénétique et absent. Travailler avec ardeur et avec conscience. Mettre au cœur de nos économies « capitalistes rigides »[9] un peu moins de cupidité, un peu plus de don et de gratuité. Pour que Sisyphe, levant les yeux sur des « choses nouvelles »[10], sorte de son destin tragique et maîtrise, enfin libre, son rocher.
Hélène Bodenez
[1] Roman écrit en 1947 et qui valut par la suite à Camus le Prix Nobel.
[2] L’anonymat est levé à la fin du roman : il s’agit du Docteur Rieux.
[3] Gn. 3,19.
[4] Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham, p. 24, Éditions de l’Olivier, Points, 2011, P2679.
[5] Robert Lutz et Giles Decock, Réflexions sur le travail, « Pour un nouveau protocole anti-chômage », Éditions Grégoriennes, Le Guetteur, 2011.
[6] Echange rapide sur Radio Notre-Dame le vendredi 30 septembre 2011 entre Jean-Pierre Denis (La Vie) et Jean-Luc Mouton (Réforme).
[7] S’organise une conférence le 17 octobre 2011 au Comité économique et social européen à Bruxelles en l’année européenne du bénévolat : L’apport du « travail invisible » à la création de richesse – valeur ajoutée de la cohésion sociale.
[8] L’attentat du 13 mai en a retardé la publication qui eut lieu le 14 septembre, jour de la Croix glorieuse. Tout un symbole quand on lit la fin de l’encyclique : « Dans le travail de l’homme, le chrétien retrouve une petite part de la croix du Christ et l’accepte dans l’esprit de rédemption avec lequel le Christ a accepté sa croix pour nous. Dans le travail, grâce à la lumière dont nous pénètre la résurrection du Christ, nous trouvons toujours une lueur de la vie nouvelle, du bien nouveau, nous trouvons comme une annonce des « cieux nouveaux et de la terre nouvelle » auxquels participent l'homme et le monde précisément par la peine au travail. Par la peine, et jamais sans elle. D'une part, cela confirme que la croix est indispensable dans la spiritualité du travail ; mais, d'autre part, un bien nouveau se révèle dans cette croix qu’est la peine, un bien nouveau qui débute par le travail lui-même, par le travail entendu dans toute sa profondeur et tous ses aspects, et jamais sans lui. » (n.27)
[9] Jean-Paul II, Laborem exercens,
[10] Rerum Novarum, titre de l’encyclique de Léon XIII que tous les papes après lui n’ont cessé de reprendre et d’en approfondir le sens.

/image%2F0991062%2F20191125%2Fob_e0f916_thumbnail-img-8110.jpg)
/image%2F0991062%2F20180321%2Fob_e92b85_20161025-172451.jpg)