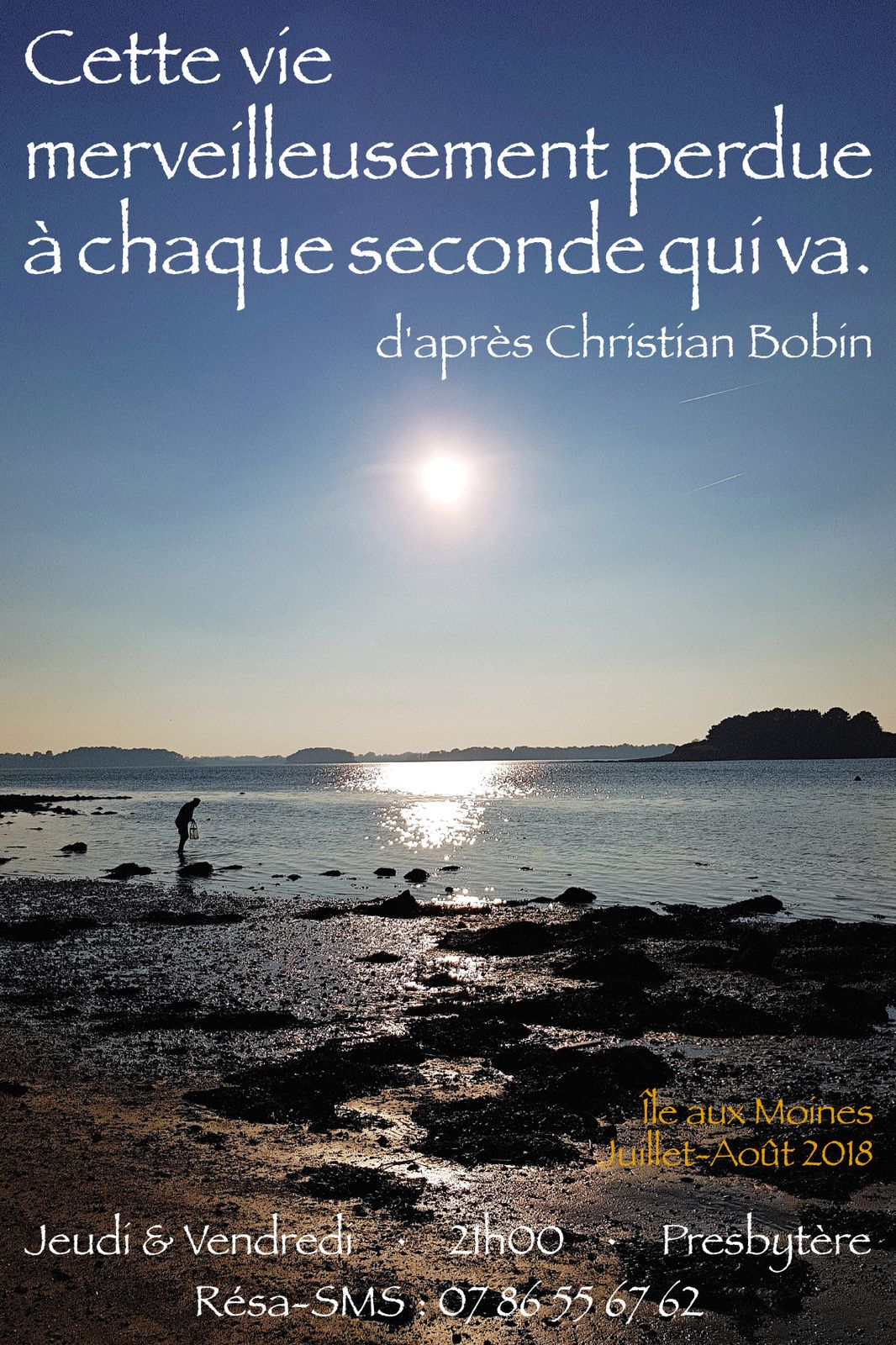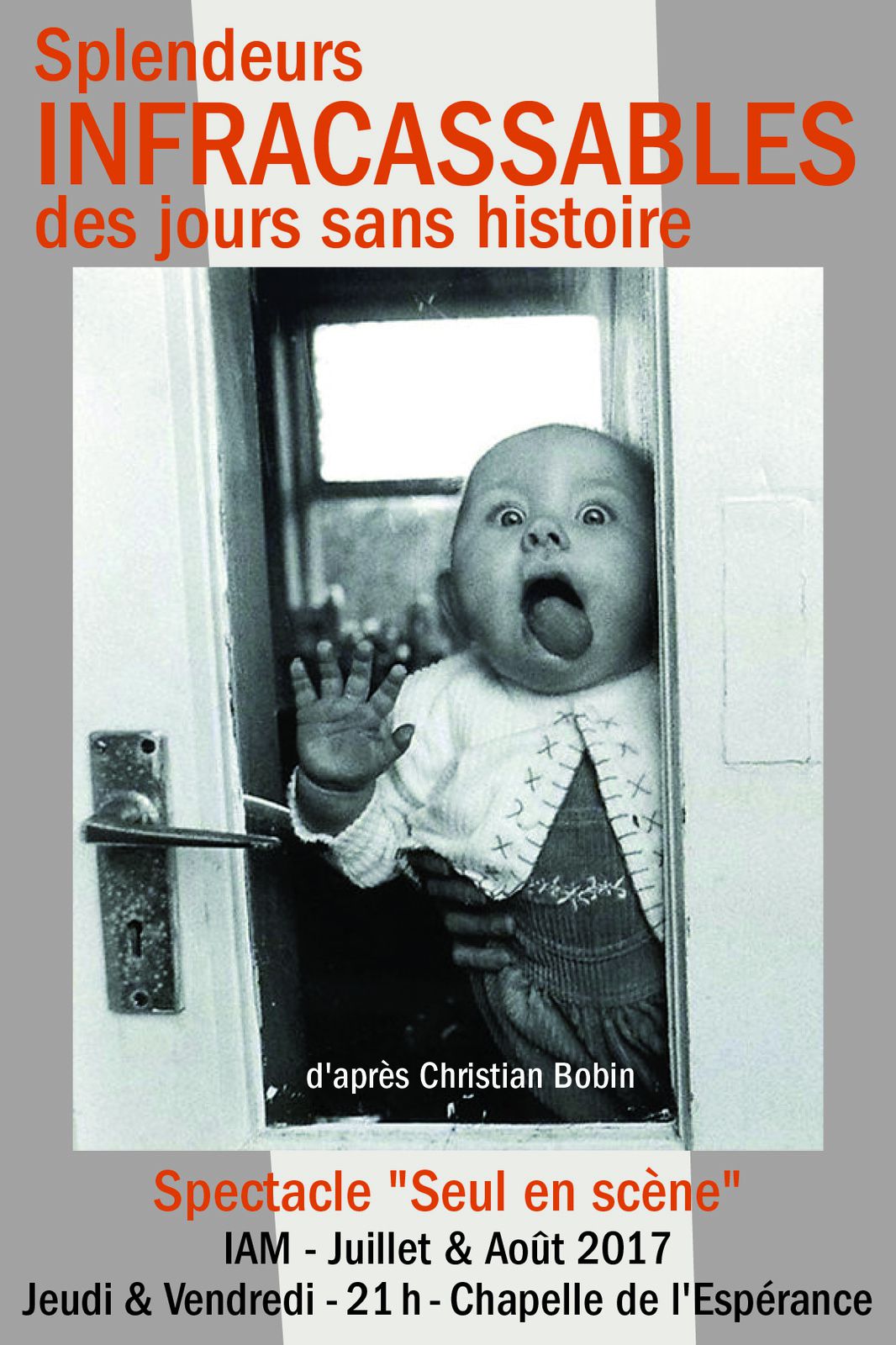Fléchis tes branches, arbre géant, relâche un
peu la tension des viscères,
Et que ta rigueur naturelle s’alentisse,
N’écartèle pas si rudement les membres du Roi
supérieur…
Fortunat
(traduction Remy de Gourmont, Le Latin Mystique.)
Seigneur, c’est aujourd’hui le jour de votre Nom,
J’ai lu dans un vieux livre la geste de votre Passion,
Et votre angoisse et vos efforts et vos bonnes paroles
Qui pleurent dans le livre, doucement monotones.
Un moine d’un vieux temps me parle de votre mort.
Il traçait votre histoire avec des lettres d’or
Dans un missel, posé sur ses genoux.
Il travaillait pieusement en s’inspirant de Vous.
À l’abri de l’autel, assis dans sa robe blanche,
il travaillait lentement du lundi au dimanche.
Les heures s’arrêtaient au seuil de son retrait.
Lui, s’oubliait, penché sur votre portrait.
À vêpres, quand les cloches psalmodiaient dans la tour,
Le bon frère ne savait si c’était son amour
Ou si c’était le Vôtre, Seigneur, ou votre Père
Qui battait à grands coups les portes du monastère.
Je suis comme ce bon moine, ce soir, je suis inquiet.
Dans la chambre à côté, un être triste et muet
Attend derrière la porte, attend que je l’appelle!
C’est Vous, c’est Dieu, c’est moi, — c’est l’Éternel.
Je ne Vous ai pas connu alors, — ni maintenant.
Je n’ai jamais prié quand j’étais un petit enfant.
Ce soir pourtant je pense à Vous avec effroi.
Mon âme est une veuve en deuil au pied de votre Croix;
Mon âme est une veuve en noir, — c’est votre Mère
Sans larme et sans espoir, comme l’a peinte Carrière.
Je connais tous les Christs qui pendent dans les musées;
Mais Vous marchez, Seigneur, ce soir à mes côtés.
Je descends à grands pas vers le bas de la ville,
Le dos voûté, le coeur ridé, l’esprit fébrile.
Votre flanc grand-ouvert est comme un grand soleil
Et vos mains tout autour palpitent d’étincelles.
Les vitres des maisons sont toutes pleines de sang
Et les femmes, derrière, sont comme des fleurs de sang,
D’étranges mauvaises fleurs flétries, des orchidées,
Calices renversés ouverts sous vos trois plaies.
Votre sang recueilli, elles ne l’ont jamais bu.
Elles ont du rouge aux lèvres et des dentelles au cul.
Les fleurs de la Passion sont blanches, comme des cierges,
Ce sont les plus douces fleurs au Jardin de la Bonne Vierge.
C’est à cette heure-ci, c’est vers la neuvième heure,
Que votre Tête, Seigneur, tomba sur votre Coeur.
Je suis assis au bord de l’océan
Et je me remémore un cantique allemand,
Où il est dit, avec des mots très doux, très simples, très purs,
La beauté de votre Face dans la torture.
Dans une église, à Sienne, dans un caveau,
J’ai vu la même Face, au mur, sous un rideau.
Et dans un ermitage, à Bourrié-Wladislasz,
Elle est bossuée d’or dans une châsse.
De troubles cabochons sont à la place des yeux
Et des paysans baisent à genoux Vos yeux.
Sur le mouchoir de Véronique Elle est empreinte
Et c’est pourquoi Sainte Véronique est Votre sainte.
C’est la meilleure relique promenée par les champs,
Elle guérit tous les malades, tous les méchants.
Elle fait encore mille et mille autres miracles,
Mais je n’ai jamais assisté à ce spectacle.
Peut-être que la foi me manque, Seigneur, et la bonté
Pour voir ce rayonnement de votre Beauté.
Pourtant, Seigneur, j’ai fait un périlleux voyage
Pour contempler dans un béryl l’intaille de votre image.
Faites, Seigneur, que mon visage appuyé dans les mains
Y laisse tomber le masque d’angoisse qui m’étreint.
Faites, Seigneur, que mes deux mains appuyées sur ma bouche
N’y lèchent pas l’écume d’un désespoir farouche.
Je suis triste et malade. Peut-être à cause de Vous,
Peut-être à cause d’un autre. Peut-être à cause de Vous.
Seigneur, la foule des pauvres pour qui vous fîtes le Sacrifice
Est ici, parquée, tassée, comme du bétail, dans les hospices.
D’immenses bateaux noirs viennent des horizons
Et les débarquent, pêle-mêle, sur les pontons.
Il y a des Italiens, des Grecs, des Espagnols,
Des Russes, des Bulgares, des Persans, des Mongols.
Ce sont des bêtes de cirque qui sautent les méridiens.
On leur jette un morceau de viande noire, comme à des chiens.
C’est leur bonheur à eux que cette sale pitance.
Seigneur, ayez pitié des peuples en souffrance.
Seigneur dans les ghettos grouille la tourbe des Juifs
Ils viennent de Pologne et sont tous fugitifs.
Je le sais bien, ils t’ont fait ton Procès;
Mais je t’assure, ils ne sont pas tout à fait mauvais.
Ils sont dans des boutiques sous des lampes de cuivre,
Vendent des vieux habits, des armes et des livres.
Rembrandt aimait beaucoup les peindre dans leurs défroques.
Moi, j’ai, ce soir, marchandé un microscope.
Hélas! Seigneur, Vous ne serez plus là, après Pâques!
Seigneur, ayez pitié des Juifs dans les baraques.
Seigneur, les humbles femmes qui vous accompagnèrent à Golgotha,
Se cachent. Au fond des bouges, sur d’immondes sophas,
Elles sont polluées par la misère des hommes.
Des chiens leur ont rongé les os, et dans le rhum
Elles cachent leur vice endurci qui s’écaille.
Seigneur, quand une de ces femmes me parle, je défaille.
Je voudrais être Vous pour aimer les prostituées.
Seigneur, ayez pitié des prostituées.
Seigneur, je suis dans le quartier des bons voleurs,
Des vagabonds, des va-nu-pieds, des recéleurs.
Je pense aux deux larrons qui étaient avec vous à la Potence,
Je sais que vous daignez sourire à leur malchance.
Seigneur, l’un voudrait une corde avec un noeud au bout,
Mais ça n’est pas gratis, la corde, ça coûte vingt sous.
Il raisonnait comme un philosophe, ce vieux bandit.
Je lui ai donné de l’opium pour qu’il aille plus vite en paradis.
Je pense aussi aux musiciens des rues,
Au violoniste aveugle, au manchot qui tourne l’orgue de Barbarie,
À la chanteuse au chapeau de paille avec des roses de papier;
Je sais que ce sont eux qui chantent durant l’éternité.
Seigneur, faites-leur l’aumône, autre que de la lueur des becs de gaz,
Seigneur, faites-leur l’aumône de gros sous ici-bas.
Seigneur, quand vous mourûtes, le rideau se fendit,
Ce que l’on vit derrière, personne ne l’a dit.
La rue est dans la nuit comme une déchirure,
Pleine d’or et de sang, de feu et d’épluchures.
Ceux que vous aviez chassés du temple avec votre fouet,
Flagellent les passants d’une poignée de méfaits.
L’Étoile qui disparut alors du tabernacle,
Brûle sur les murs dans la lumière crue des spectacles.
Seigneur, la Banque illuminée est comme un coffre-fort,
Où s’est coagulé le Sang de votre mort.
Les rues se font désertes et deviennent plus noires.
Je chancelle comme un homme ivre sur les trottoirs.
J’ai peur des grands pans d’ombre que les maisons projettent.
J’ai peur. Quelqu’un me suit. Je n’ose tourner la tête.
Un pas clopin-clopant saute de plus en plus près.
J’ai peur. J’ai le vertige. Et je m’arrête exprès.
Un effroyable drôle m’a jeté un regard
Aigu, puis a passé, mauvais, comme un poignard.
Seigneur, rien n’a changé depuis que vous n’êtes plus Roi.
Le Mal s’est fait une béquille de votre Croix.
Je descends les mauvaises marches d’un café
Et me voici, assis, devant un verre de thé.
Je suis chez des Chinois, qui comme avec le dos
Sourient, se penchent et sont polis comme des magots.
La boutique est petite, badigeonnée de rouge
Et de curieux chromos sont encadrés dans du bambou.
Ho-Kousaï a peint les cent aspects d’une montagne.
Que serait votre Face peinte par un Chinois ? ..
Cette dernière idée, Seigneur, m’a d’abord fait sourire.
Je vous voyais en raccourci dans votre martyre.
Mais le peintre, pourtant, aurait peint votre tourment
Avec plus de cruauté que nos peintres d’Occident.
Des lames contournées auraient scié vos chairs,
Des pinces et des peignes auraient strié vos nerfs,
On vous aurait passé le col dans un carcan,
On vous aurait arraché les ongles et les dents,
D’immenses dragons noirs se seraient jetés sur Vous,
Et vous auraient soufflé des flammes dans le cou,
On vous aurait arraché la langue et les yeux,
On vous aurait empalé sur un pieu.
Ainsi, Seigneur, vous auriez souffert toute l’infamie,
Car il n’y a pas de plus cruelle posture.
Ensuite, on vous aurait forjeté aux pourceaux
Qui vous auraient rongé le ventre et les boyaux.
Je suis seul à présent, les autres sont sortis,
Je me suis étendu sur un banc contre le mur.
J’aurais voulu entrer, Seigneur, dans une église;
Mais il n’y a pas de cloches, Seigneur, dans cette ville.
Je pense aux cloches tues: — où sont les cloches anciennes?
Où sont les litanies et les douces antiennes?
Où sont les longs offices et où les beaux cantiques?
Où sont les liturgies et les musiques?
Où sont tes fiers prélats, Seigneur, où tes nonnains?
Où l’aube blanche, l’amict des Saintes et des Saints?
La joie du Paradis se noie dans la poussière,
Les feux mystiques ne rutilent plus dans les verrières.
L’aube tarde à venir, et dans le bouge étroit
Des ombres crucifiées agonisent aux parois.
C’est comme un Golgotha de nuit dans un miroir
Que l’on voit trembloter en rouge sur du noir.
La fumée, sous la lampe, est comme un linge déteint
Qui tourne, entortillé, tout autour de vos reins.
Par au-dessus, la lampe pâle est suspendue,
Comme votre Tête, triste et morte et exsangue.
Des reflets insolites palpitent sur les vitres…
J’ai peur, — et je suis triste, Seigneur, d’être si triste.
« Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? »
– La lumière frissonner, humble dans le matin.
« Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? »
– Des blancheurs éperdues palpiter comme des mains.
« Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? »
– L’augure du printemps tressaillir dans mon sein.
Seigneur, l’aube a glissé froide comme un suaire
Et a mis tout à nu les gratte-ciel dans les airs.
Déjà un bruit immense retentit sur la ville.
Déjà les trains bondissent, grondent et défilent.
Les métropolitains roulent et tonnent sous terre.
Les ponts sont secoués par les chemins de fer.
La cité tremble. Des cris, du feu et des fumées,
Des sirènes à vapeur rauques comme des huées.
Une foule enfiévrée par les sueurs de l’or
Se bouscule et s’engouffre dans de longs corridors.
Trouble, dans le fouillis empanaché des toits,
Le soleil, c’est votre Face souillée par les crachats.
Seigneur, je rentre fatigué, seul et très morne …
Ma chambre est nue comme un tombeau …
Seigneur, je suis tout seul et j’ai la fièvre …
Mon lit est froid comme un cercueil …
Seigneur, je ferme les yeux et je claque des dents …
Je suis trop seul. J’ai froid. Je vous appelle …
Cent mille toupies tournoient devant mes yeux …
Non, cent mille femmes … Non, cent mille violoncelles …
Je pense, Seigneur, à mes heures malheureuses …
Je pense, Seigneur, à mes heures en allées …
Je ne pense plus à vous. Je ne pense plus à vous.
Blaise Cendrars, New York, avril 1912

/image%2F0991062%2F20191125%2Fob_e0f916_thumbnail-img-8110.jpg)
/image%2F0991062%2F20180321%2Fob_e92b85_20161025-172451.jpg)