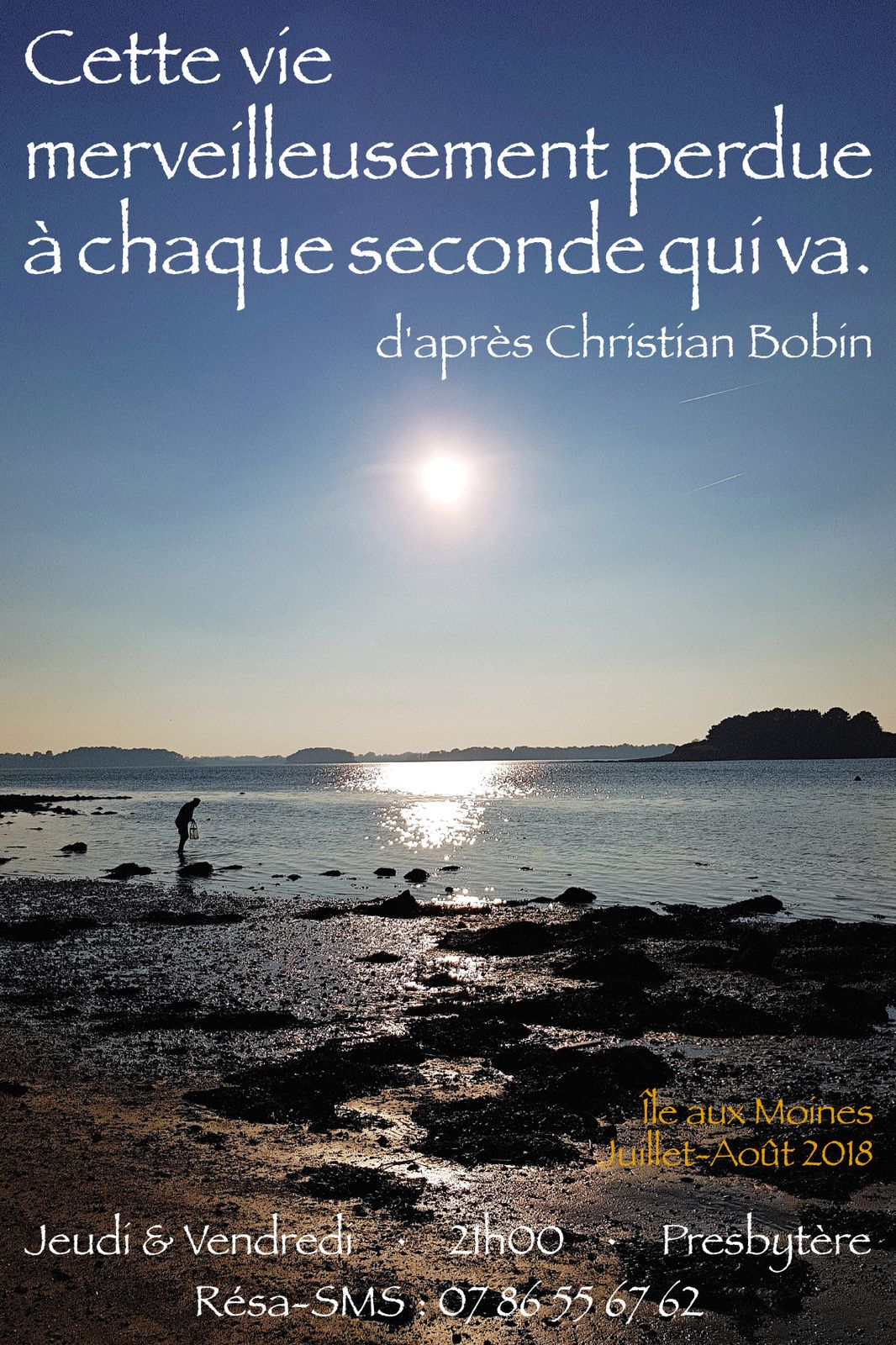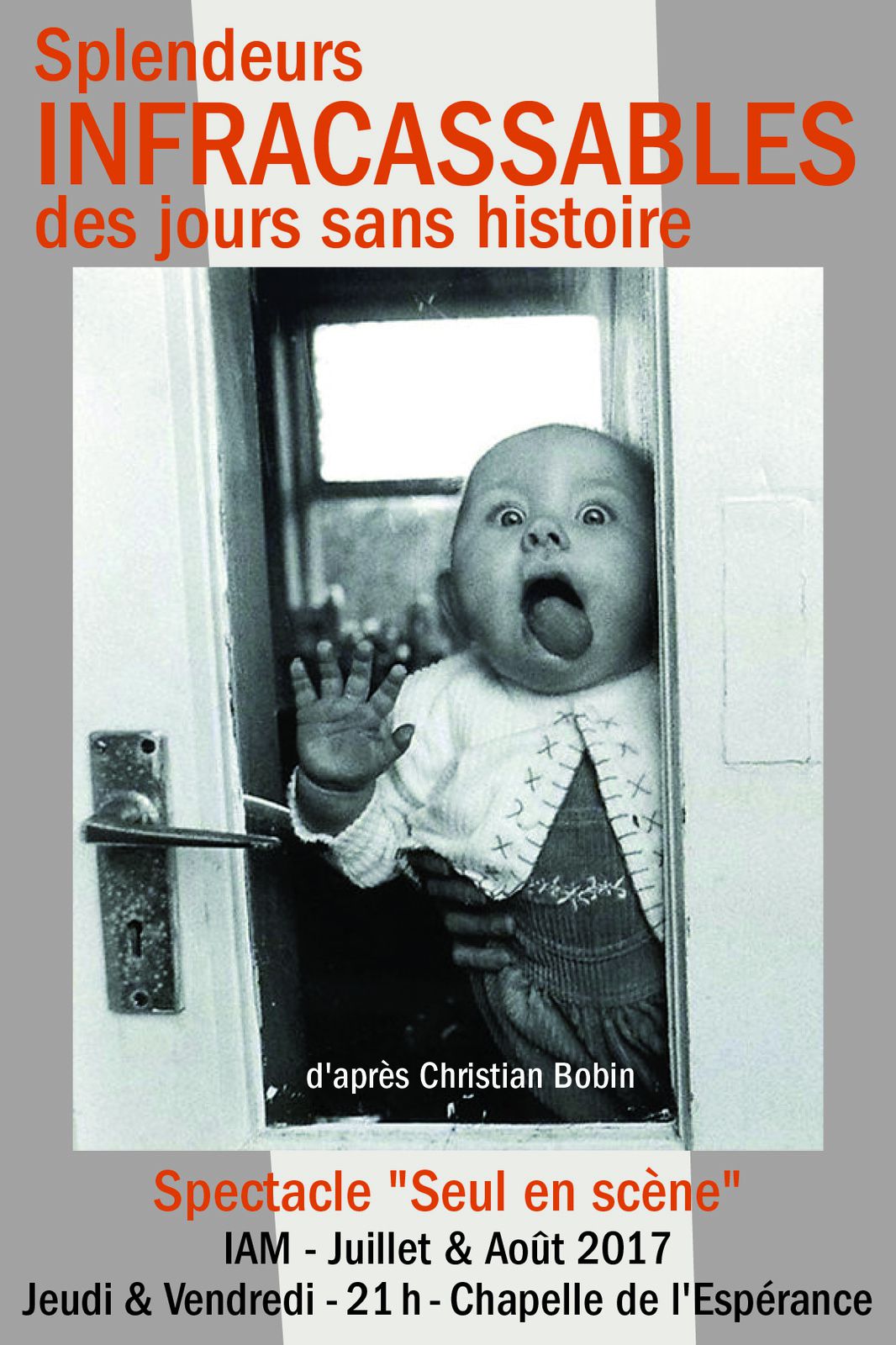Œuvre de génie ? La carrière tortueuse de John Huston, marquée par des chefs-d’œuvres et de cuisants échecs, en déconcerte plus d’un. Grand amateur de livres, Huston a toujours puisé son inspiration dans la littérature et adapte bon nombre d’auteurs à succès, parmi lesquels Dashiell Hammett, Rudyard Kipling et Herman Melville. Il réalise en 1964 La Nuit de l’iguane d’après une pièce de Tennessee Williams. Ce dernier avait trouvé en Elia Kazan un cinéaste idéal, capable de transposer visuellement les déchirements de ses personnages égarés (Un tramway nommé Désir, Baby Doll). John Huston, quant à lui, met son grain de sable dans les rouages d’un univers tragique et désamorce par l’humour la dimension très symbolique de l’écriture de Williams en y installant une pointe de discordance. Il nous plonge ainsi avec trouble et délice dans l’ambiance faussement exotique d’un Mexique, où chaque gorgée de rhum évoque le goût nostalgique d’une innocence perdue.
Suspendu pour « fornication et conduite indigne », le révérend Lawrence Shannon (Richard Burton) est contraint de quitter l’Église. Répudié de l’autel, il se réfugie tout naturellement dans un... hôtel tenu par Maxine Faulk (Ava Gardner), la veuve d’un de ses amis. Devenu guide touristique (« Visitez le monde de Dieu avec un homme de Dieu »... clame l’annonce publicitaire du voyage organisé !), notre séduisant révérend fait découvrir les joies et les bienfaits de la jungle mexicaine à un groupe de vieilles Américaines. Une lolita délurée (Sue Lyon, la Lolita de Stanley Kubrick), chaperonnée par une vieille fille frustrée (Miss Fellowes), ne reste pas insensible aux charmes du pasteur et tente de le corrompre. Tandis que Shannon subit les menaces et insultes de Miss Fellowes, la vieille puritaine, deux clients atypiques et fauchés – une peintre spirituelle et éthérée (Deborah Kerr) accompagnée de son grand-père, poète nonagénaire – s’installent pour une nuit à l’hôtel.
Les tentations d’un anti-héros
Entre les vapeurs de l’alcool et la moiteur de l’atmosphère de Puerto Vallarta, Shannon est aveuglé. Tout comme le vieux poète Nonno dont les vers scandent et rythment le film jusqu’à l’achèvement de l’ultime élégie : il ressasse, « tel un aveugle qui monte un escalier ne menant à rien ». Et Shannon, que l’on voit dans les premières images du film monter en chaire afin de prêcher, est constamment écartelé entre ce mouvement d’ascension et de chute. Tandis que les yeux du Révérend se détournent sans cesse pour « jeter un regard sur le monde perdu de l’innocence », ceux de la nymphette Charlotte Goodall (Sue Lyon), tentatrice bien peu ingénue pour son jeune âge, se penchent du haut d’un escalier en direction du pasteur : la caméra, en plongée, fixe et guette Shannon. Car Charlotte ne descendra pas pour le rejoindre. Tel l’iguane, elle se glisse dans la chambre du pasteur et attend tapie dans l’ombre qu’il vienne, forcé par son destin, jusqu’à elle. Après être monté en chaire dans les premiers plans du film, Shannon gravit les escaliers, qui le mènent cette fois-ci à la chambre : il y commettra le péché de chair. « Je peux descendre mais remonter, je n’en suis pas si sûr » confesse-t-il à la fin du film, à Maxine (Ava Gardner). Car l’hôtel tenu par Maxine surplombe très symboliquement la jungle mexicaine et domine l’océan. N’en déplaise aux jambes des vieilles touristes américaines, il faut grimper pour y accéder. Maxine, entourée de deux beach boys qui s’agitent au son des maracas, gère cet hôtel aux faux airs de paradis terrestre d’où s’échappent d’enivrants effluves de rhum coco. Dans de telles contrées, le mot « mort » est un exil, c’est un grand plongeon vers la Chine. Et c’est dans ce lieu clos, égaré, presque au bout du monde, que les nœuds du drame se resserrent et que les tensions s’exacerbent.
Entre tragédie et parodie
Bien sûr, les personnages créés par Tennessee Williams sont des êtres esseulés, tiraillés entre leurs questionnements et un Destin qui leur échappe : les conflits à l’œuvre sont passionnels et existentiels, l’espace se restreint, le temps paraît suspendu, les unités de temps et de lieu enchaînent les personnages l’un à l’autre. Il y a bien une série de rouages tragiques qui se mettent en place, car tout est guidé vers un cheminement. « C’est la définition de la tragédie : l’inéluctabilité de la mort. La tragédie, ce n’est pas que le héros meure ou que l’on éprouve de la pitié pour lui ; car cela arrive aussi dans la comédie. La comédie est gouvernée par les accidents qui peuvent faire dériver le cours de l’histoire. Dans la tragédie au contraire, on n’a qu’une conclusion possible » déclare Huston, dans un entretien [1]. Néanmoins, l’art astucieux de Huston s’ancre dans la répétition presque parodique de scènes, d’actes ou de paroles. Le malaise, tout comme la libération que provoque le rire, naissent de l’exacerbation et de l’alternance de tensions hystériques, d’instants de latence : l’on pressent l’inéluctabilité mais l’on ne sait si, le plan suivant, la prochaine ligne de dialogue, vont précipiter l’action dans un basculement dramatique ou provoquer un effet comique. Les deux premières séquences du film illustrent ce phénomène parodique. En un mouvement de caméra, on découvre l’extérieur d’une église. Puis on pénètre à l’intérieur et l’on assiste au sermon du pasteur (celui-ci se trahit pour un « délit » qu’il a commis et accuse les fidèles d’être venus le juger). Secouée par les propos du Révérend, l’assemblée quitte l’église, laissant le pasteur en proie à ses délires de persécution. Puis le générique du film commence. La séquence suivante, située juste après le générique, présente le même mouvement de caméra et détaille de l’extérieur une église. Mais l’appareil s’immobilise sur un homme allongé, dont le visage est recouvert par un journal : le pasteur Shannon, devenu guide, attend les touristes qui visitent le lieu de culte. Une répétition de plans suffit à introduire un personnage complexe, dramatique et profondément cynique. Plus loin, l’une des plus belles séquences du film démontre, elle aussi, ce procédé parodique : dans une paillote sur la plage, la provocante Sue Lyon, cernée par les beach boys, se déhanche sur les rythmes endiablés des maracas, puis se fait sermonner par le gérant qui refuse de la servir et éteint subitement la musique. Hank, le chauffeur du car qui croit gagner les faveurs de la fille en la protégeant, se lance dans un combat effréné contre les deux Mexicains : le gérant rallume le poste, et la lutte devient une sorte de danse burlesque cadencée par les tintements des bouteilles et les frottements de verres. Les déhanchements séducteurs de l’aguicheuse laissent place à un combat qui n’est autre qu’une parodie de danse.

L’érotisme et la mise en scène du corps
On a souvent relevé le caractère misogyne de l’univers et du discours de Tennessee Williams. Lors de cette fameuse nuit, Shannon, ivre, à demi-fou, se retrouve attaché à un hamac. « Je vous croyais asexuée, mais vous êtes devenue une femme parce que vous prenez plaisir à me voir ligoté » dit-il à Hannah. S’ensuit tout un long discours de Shannon sur la femme et son besoin vital d’enchaîner l’homme. À ces propos, Huston réplique par une mise en scène des corps qui traverse certaines séquences, paradoxalement brillantes par leur absence de dialogues. Face au discours cynique d’un Shannon qui définit un détournement de mineur comme le détournement d’un adulte par une mineure, Huston filme avec brio, sans pudeur ni décence le corps de Sue Lyon : se succèdent ainsi, dans la scène de séduction sur la plage, un travelling avant, un gros plan en plongée de son postérieur suivi d’un travelling arrière, puis le plan en contrechamp d’un Mexicain assis à une table. Où se situe l’obscénité alors ? Serait-ce le gros plan d’une paire de fesses ou le contrechamp de l’homme et d’un regard clairement dirigé sur ce qui est à présent hors champ ? Et l’on se prend à admirer Huston dans ces séquences où il met si habilement en scène les corps : à l’image de cette furtive et silencieuse scène dans laquelle une Ava Gardner, férue de ses beach boys vigoureux, mais sensible au charme vénéneux de Richard Burton, s’adonne au bain de minuit ; l’obscurité lumineuse de la mer éclaire les corps qui s’étreignent. Maxine, sur le point d’être engloutie par les ténèbres, rejette subitement ses amants et son corps réapparaît. L’étreinte est filmée comme une lutte, et l’érotisme de la scène se dévoile dans un jeu d’ombre et de lumière, dans le montage de plans filmés en contre-jour enfin, dans le travail de la bande-son : la scène n’est plus scandée par les dialogues mais par les vagues et les bruissements des percussions mexicaines. Sous le malaise et le mal-être, demeure l’émotion au sens étymologique du terme, c’est-à-dire, le mouvement et l’agitation, la vie des êtres bercés par le frémissement des maracas.

/image%2F0991062%2F20191125%2Fob_e0f916_thumbnail-img-8110.jpg)
/image%2F0991062%2F20180321%2Fob_e92b85_20161025-172451.jpg)