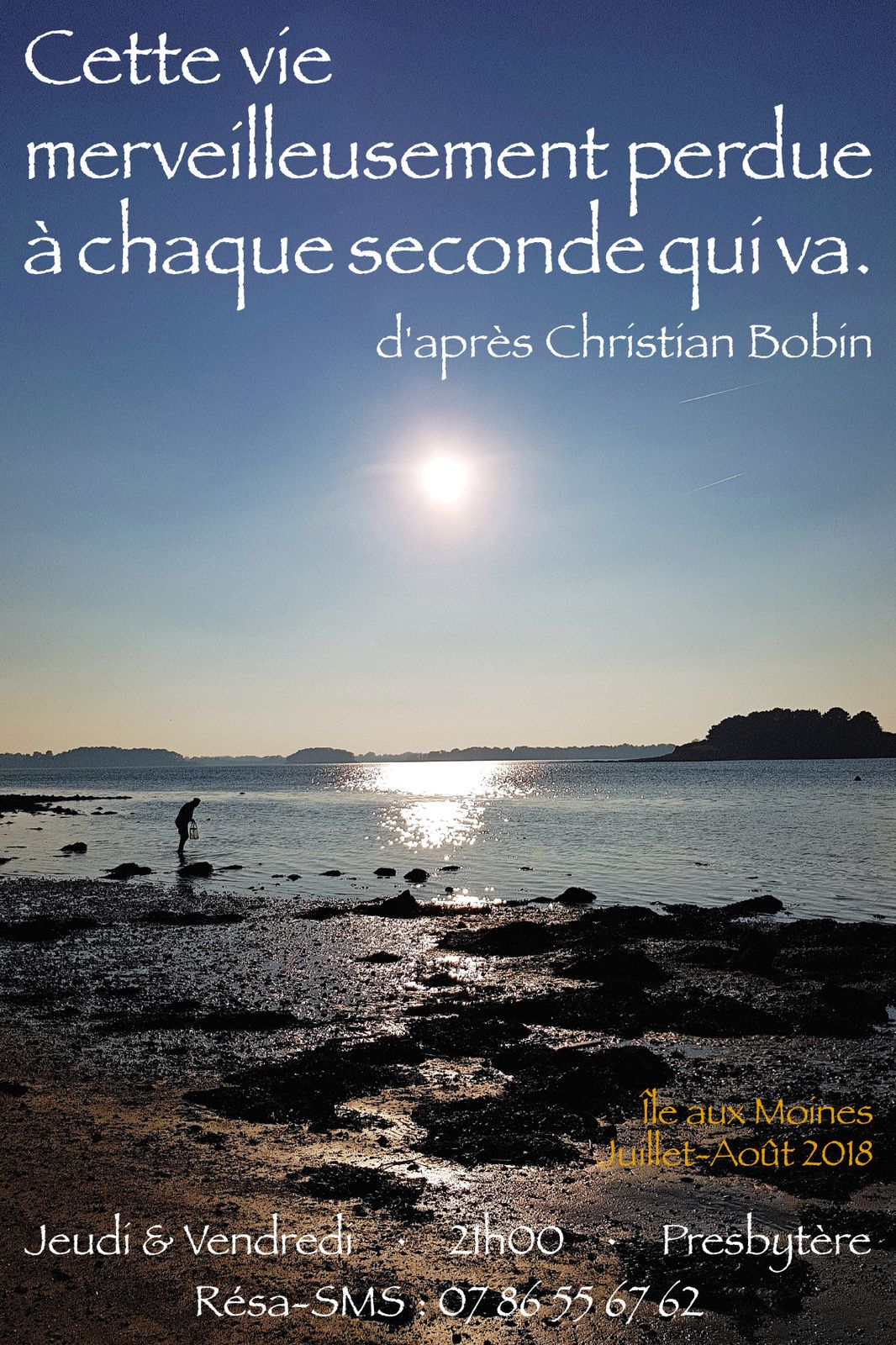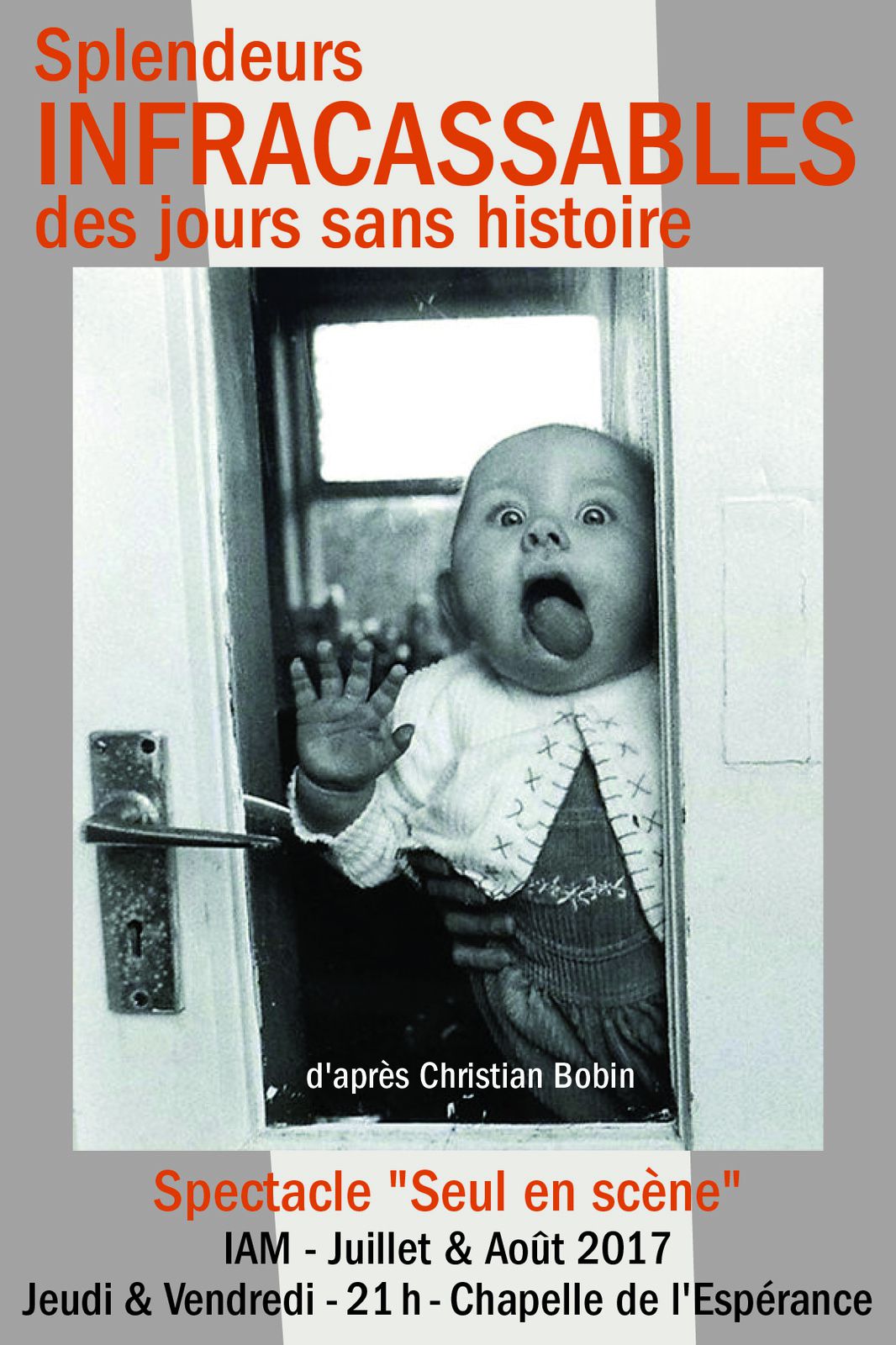Touiavii, chef de tribu sur une île de Samoa, a visité l’Europe, entre 1915 et 1920, et en a rapporté des notes à l’intention de ses frères des îles, qui ont été publiées en 1920 par Erich Scheuermann. Le regard qu’il porte sur le Papalagui, autrement dit le Blanc, est celui d’un Éveillé qui n’a manifestement jamais eu à passer par les affres de l’enfermement en soi. Tout ce qui nous enferme, nous les “civilisés”, et nous coupe de la réalité vivante, et qui nous semble tellement naturel – bien à tort, suscite en Touiavii un étonnement sans fin, mêlé de pitié et d’inquiétude; il voyait en effet la fascination que les réalisations du Papalagui pouvaient exercer sur ses frères, et les notes qu’il a écrites avaient avant tout pour but de les mettre en garde contre cette fascination.
«C’est une chose embrouillée que je n’ai jamais vraiment complètement comprise, parce que cela m’ennuie de réfléchir plus longtemps que nécessaire à ces choses aussi puériles. Mais c’est une connaissance très importante pour le Papalagui. Les hommes, les femmes et même les enfants qui tiennent à peine sur les jambes, portent dans le pagne une petite machine plate et ronde sur laquelle ils peuvent lire le temps. Soit elle est attachée à une grosse chaîne métallique et pend autour du cou, soit elle est serrée autour du poignet avec une bande de cuir. Cette lecture du temps n’est pas facile. On y exerce les enfants en leur tenant la machine près de l’oreille pour leur faire plaisir.
Ces machines, que l’on porte facilement sur le plat de deux doigts, ressemblent dans leur ventre aux machines qui sont dans les ventre des bateaux, que vous connaissez tous. Mais il y a aussi de grandes et lourdes machines à temps à l’intérieur des huttes, ou sur les plus hautes façades pour qu’on puisse les voir de loin. Et quand une tranche de temps est passée, de petits doigts le montrent sur la face externe de la machine et en même temps elle se met à crier, un esprit cogne contre le fer dans son coeur. Oui, un puissant grondement s’élève dans une ville européenne quand une tranche de temps s’est écoulée.
Quand ce bruit du temps retentit, le Papalagui se plaint: Oh! là! là! encore une heure de passée!” Et il fait le plus souvent une triste figure, comme un homme portant un lourd chagrin, alors qu’aussitôt une heure toute fraîche s’approche. Je n’ai jamais compris cela, si ce n’est en supposant qu’il s’agit d’une grave maladie. Le Papalagui se plaint de cette façon: ”Le temps me manque!... Le temps galope comme un cheval!... Laissez-moi encore un peu de temps!...” (...)
En Europe, il n’y a que peu de gens qui ont véritablement le temps. Peut-être pas du tout. C’est pourquoi ils courent presque tous, traversant la vie comme une flèche. Presque tous regardent le sol en marchant et balancent haut les bras pour avancer le plus vite possible. Quand on les arrête, ils s’écrient de mauvaise humeur: ”Pourquoi faut-il que tu me déranges? Je n’ai pas le temps, et toi, regarde comme tu perds le tien!” Ils se comportent comme si celui qui va vite était plus digne et plus brave que celui qui va lentement.
Le Papalagui oriente toue son énergie et toutes ses pensées vers cette question: comment rendre le temps le plus dense possible? Il utilise l’eau, le feu, l’orage et les éclairs du ciel pour retenir le temps. Il met des roues de fer sous ses pieds et donne des ailes à ses paroles, pour avoir plus de temps. Et dans quel but tous ces grands efforts?
Que fait le Papalagui avec son temps? Je n’ai jamais découvert la vérité, bien qu’il parle sans cesse et gesticule comme si le Grand-Esprit l’avait invité à un fono. Je crois que le temps lui échappe comme un serpent dans une main mouillée, justement parce qu’il le retient trop. Il ne le laisse pas venir à lui. Il le poursuit toujours, les mains tendues, sans lui accorder jamais la détente nécessaire pour s’étendre au soleil. Le temps doit toujours être très près, en traint de parler ou de lui chanter un air. Mais le temps est calme et paisible, il aime le repos et il aime s’étendre de tout son long sur la natte. Le Papalagui n’a pas reconnu le temps, il ne le comprend pas et c’est pour cela qu’il le maltraite avec ses coutumes de barbare.
Mes chers frères, nous ne nous sommes jamais plaints du temps, nous l’avons aimé comme il venait, nous n’avons jamais couru après lui, nous n’avons jamais voulu le trancher ni l’épaissir. Jamais il ne devint pour nous une charge ni une contrainte.
Que s’avance celui d’entre nous qui n’a pas le temps! Chacun de nous a le temps en abondance, et en est content; nous n’avons pas besoin de plus de temps que nous en avons, et nous en avons assez. Nous savons que nous parvenons toujours assez tôt à notre destination, et que le Grand-Esprit nous appelle quand il veut, même si nous ne connaissons pas le nombre de nos lunes.
Nous devons libérer de sa folie ce pauvre Papalagui perdu, nous devons l’aider à retrouver son temps. Il faut mettre en pièces pour lui sa petite machine à temps ronde, et lui annoncer que du lever au coucher du soleil, il y a plus de temps que l’homme en aura jamais besoin.»
«Quand le mot esprit vient dans la bouche du Papalagui, ses yeux s’agrandissent, s’arrondissent et deviennent fixes, il soulève sa poitrine, respire profondément et se dresse comme un guerrier qui a battu son ennemi, car l’esprit est quelque chose dont il est particulièrement fier. Il n’est pas question-là du grand et puissant Esprit que le missionnaire appelle Dieu, et dont nous ne sommes qu’une image chétive, mais du petit esprit qui est au service de l’homme et produit ses pensées.
Quand d’ici je regarde le manguier derrière l’église de la mission, ce n’est pas de l’esprit, parce que je ne fais que regarder. Mais dès que je me rends compte que le manguier dépasse l’église, c’est de l’esprit. Donc il ne faut pas seulement regarder, mais aussi réfléchir sur ce que l’on voit. Ce savoir, le Papalagui l’applique du lever au coucher du soleil. Son esprit est toujours comme un tube à feu chargé ou comme une canne à pêche prête au lancer. Il a de la compassion pour nous, peuple des nombreuses îles, qui ne pratiquons pas ce savoir-réfléchir-sur-tout. D’après lui, nous serions pauvres d’esprit et bêtes comme les animaux des contrées désertiques.
C’est vrai que nous exerçons peu le savoir que le Papalagui nomme penser. Mais la question se pose si est bête celui que ne pense pas beaucoup, ou celui qui pense beaucoup trop. Le Papalagui pense constamment: ”Ma hutte est plus petite que le palmier... Le palmier se plie sous l’orage... L’orage parle avec une grosse vois...” Il pense ainsi, à sa manière naturellement. Et il réfléchit aussi sur lui-même: Je suis resté de petite taille... Mon coeur bondit de joie à la vue d’une jolie fille... J’aime beaucoup partir en mélaga...» Et ainsi de suite...
C’est bon et joyeux, et peut même présenter un intérêt insoupçonné pour celui qui aime ce jeu dans sa tête. Cependant, le Papalagui pense tant que penser lui est devenu une habitude, une nécessité et même une obligation. Il faut qu’il pense sans arrêt. Il parvient difficilement à ne pas penser, en laissant vivre son corps. Il ne vit souvent qu’avec sa tête, pendant que tous ses sens reposent dans un sommeil profond, bien qu’il marche, parle, manger et rie.
Les pensées qui sont le fruit du penser, le retiennent prisonnier. Il aune sorte d’ivresse de ses propres pensées. Quand le soleil brille, il pense aussitôt: ”Comme il fait beau maintenant!” Et il ne s’arrête pas de penser: ”Qu’il fait beau maintenant!” C’est faux. Fondamentalement faux. Fou. Parce qu’il vaut mieux ne pas penser du tout quand le soleil brille.
Un Samoan intelligent étend ses membres sous la chaude lumière et ne pense à rien. Il ne prend pas seulement le soleil avec sa tête, mais aussi avec les mains, les pieds, les cuisses, le ventre et tous les membres. Il laisse sa peau et ses membres penser pour lui. Et ils pensent certainement aussi, même si c’est d’une autre façon que la tête. Mais pour le Papalagui l’habitude de penser est souvent sur le chemin comme un gros bloc de lave dont il ne peut se débarrasser. Il pense à des choses gaies, mais n’en rit pas, à des choses tristes, mais n’en pleure pas. Il a faim, mais ne prend pas de taro ni de palousami. C’est un homme dont les sens vivent en conflit avec l’esprit, un homme divisé en deux parties.»
Erich Scheurmann, Le Papalagui, Présence Images éditions, 2001, pour la trad française, coll. Pocket,

/image%2F0991062%2F20191125%2Fob_e0f916_thumbnail-img-8110.jpg)
/image%2F0991062%2F20180321%2Fob_e92b85_20161025-172451.jpg)