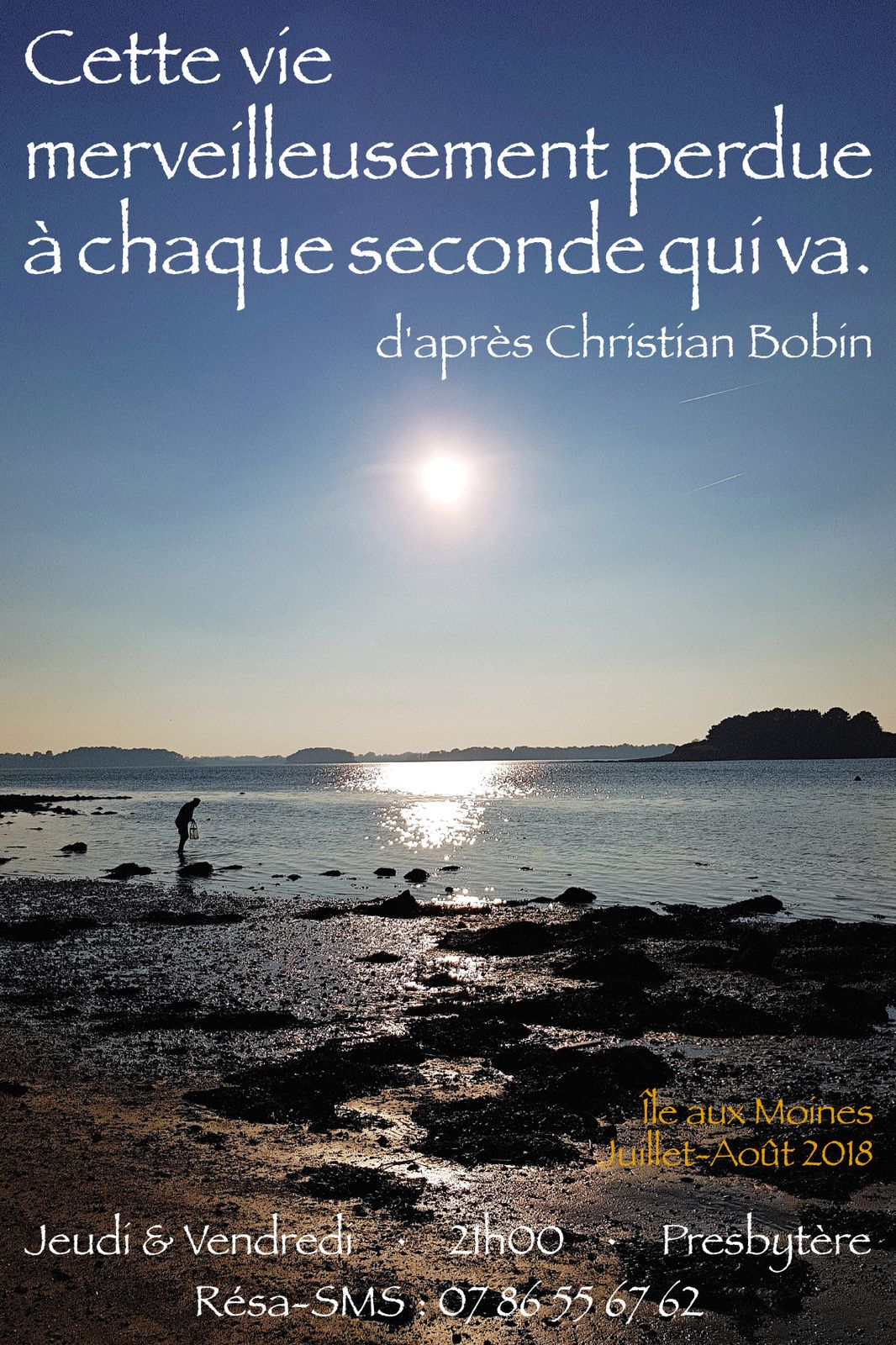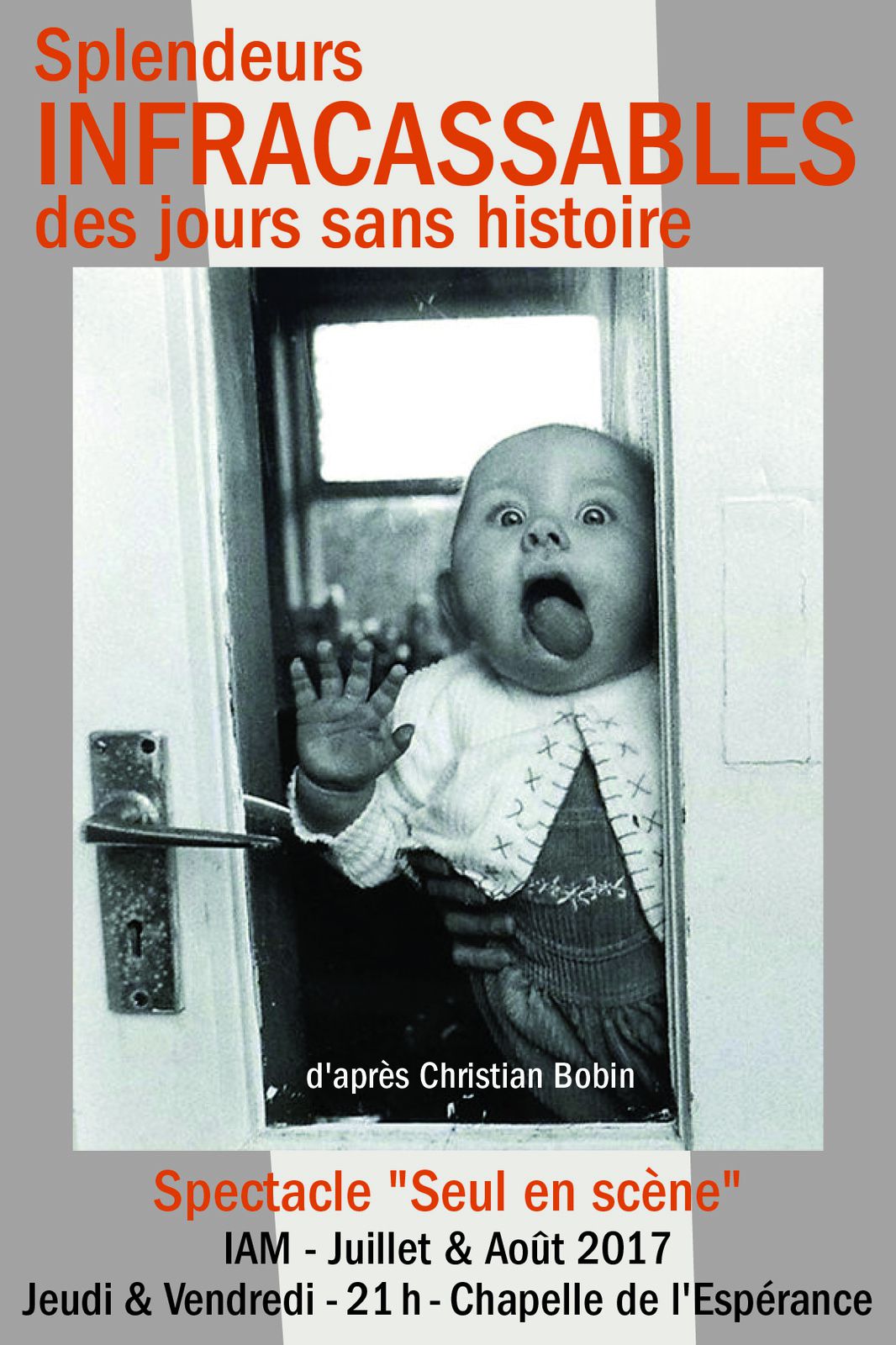Quand Christian Bobin parle, c’est avec une immense douceur, en choisissant et polissant chaque mot, et son regard ne lâche pas le vôtre avant d’être certain de s’être bien fait comprendre. Mais quand il rit, c’est d’un rire énorme, jaillissant, libératoire qui emplit tout l’espace. Et l’un répond parfaitement à l’autre dans l’oeuvre singulière qu’il poursuit depuis trente ans.
TC : Vous venez de publier un livre poétique, Noireclaire, et La prière silencieuse, un superbe recueil de photographies de religieux et religieuses que vous commentez. Ce dernier est plein de lumière et de silence et, d’une certaine façon, on regrette que vous-même n’y figuriez pas.
Christian Bobin : C’est que moi, je ne suis pas un moine. Si je devais me définir, ce que j’évite de faire, mais ce sera une exception, je suis juste, du moins, j’espère être, un passage entre une chose et une autre, pas plus que ça. Il y a quelques jours, dans le bureau où parfois j’écris, qui donne sur un pré, j’ai vu un daim. À ce moment-là, dans ce bureau, j’étais debout et, à la main, j’avais un livre d’une poétesse russe, Anna Akhmatova, une amie de Mandelstam (1). Ce sont des poètes des années 1930, 1940, 1950. Je connaissais la puissance de cette poétesse, ma main droite était comme enflammée par le livre que je tenais et mes yeux ont aussi été enflammés par la vision de cette bête sauvage et délicate que je voyais dans le pré, en train de mâcher quelques touffes d’herbes. J’ai eu le sentiment, difficilement explicable, que je n’étais que le point de rencontre entre une poétesse, morte dans les années 1960, et cet animal sauvage dans le pré. Pour moi, ce lien, ce passage, c’est le travail même de l’écriture. Il est difficilement nommable.
Ce que vous dites est pourtant l’une des étymologies du mot « religieux » : religere, « qui relie ».
Oui, effectivement, je n’y avais pas pensé.
Vous dites que vous êtes un « passage » et non un « passeur », ce n’est pas la même chose.
Le passage est toujours provisoire et je me ressens comme une sorte d’architecture de chair et d’os, et de nerfs et de songes. Dans la rencontre entre cet animal et cet autre être sauvage, la poétesse, j’avais l’impression, moi, radieuse – l’adjectif est important – de n’être rien que cette rencontre, que celui qui avait favorisé la rencontre. Vous voyez ? Il est possible que l’écriture soit, telle que je l’éprouve, toujours de cet ordre-là. J’écris beaucoup par images.
Je vis et je perçois par métaphores, par associations, par images, c’est comme une maladie que j’ai, c’est ma maladie et c’est ma santé. À la seconde où je vois une chose qui me touche, elle fait venir, dans mon cerveau, une autre chose d’un autre domaine, qui l’éclaire. Puisque nous sommes en automne, je vais vous donner un exemple un peu banal, mais je n’en trouve pas d’autre, pour
l’instant. Un marron, la bogue d’un marron, cette sorte de porc-épic, voyez, il y a déjà une image, facile, qu’on peut tous avoir, cette sorte de porcépic contient le bijou brun doré, à l’intérieur de la bogue du marron, c’est velouté, lisse, l’oeil le voit et la main, le doigt qui passe dessus, l’éprouve aussi et le marron lui-même, quand il est sorti, tout neuf après sa chute sur le sol, il a le brillant d’un petit soulier d’enfant ou de poupée. Vous voyez ? Et je vois ça comme ça. Je ne cherche pas les images, elles viennent à moi, moi je suis juste le rassembleur, leur assembleur. C’est plus fort que moi.
Souvent, je ne vois rien, distraction, absence… mais quand une vision vient, ce n’est pas moi qui en décide, je n’invente rien, il y a un domaine qui vient. Je crois beaucoup à ces échanges. Et, de même entre les vivants et les morts, et de même entre les absents et les présents et pourquoi pas, les anges et les diables, qui sont de même espèce, d’ailleurs, comme on le sait, théologiquement…
Dans un entretien, vous dites une chose un peu étrange. Vous parlez d’une chambre secrète, dans laquelle il ne faut laisser entrer personne. Vous ajoutez, pas même soi-même. De quoi s’agit-il ?
Ça, c’est la grande force que je me souhaite, que je vous souhaite et que je souhaite à chacun et chacune. Parce que c’est la source d’une grande force, les épreuves viennent à nous, les trahisons s’approchent, les manques, les fins, beaucoup de choses viennent nous heurter et, parfois, nous mettre à bas. Or, il y a une chose qui, dans le grand effondrement, qu’il est inévitable de connaître, doit demeurer intacte, au milieu, comme une chambre d’or au milieu des décombres de toute la maison. Il est à souhaiter que les murs soient inébranlables.
À l’intérieur de cette chambre, il n’y aurait exactement rien, mais ce rien est plus précieux que tout. Ce rien, pour moi, c’est le visage même du Christ, c’est le visage de Dieu, c’est aussi ce que je peux entrevoir dans l’extrême délicatesse d’un feuillage d’arbre. Ce rien, c’est la chose la plus faible de la vie, de cette vie, qui, parce qu’elle est la plus faible, est invincible. On peut, si vous voulez, convenir d’appeler ça « Dieu ». Mais il me semble que, y compris nos amours, nos passions, n’y ont pas accès. On ne doit pas les laisser entrer, dans cette chambre forte. Nous-mêmes, peut-être, n’avons-nous pas à y entrer, simplement à la garder intacte, comme font, je crois, certaines religions, comme la religion orthodoxe, où un voile sépare les fidèles de l’essentiel, c’était aussi le cas avec le voile du Temple dans le judaïsme. Il faut qu’il y ait un espace intérieur en chacun, dans son coeur où, même ses émois, ses émotions, ses attachements n’entrent pas.
C’est une pensée qui m’est venue de la fréquentation des livres, et aussi un peu de sa personne, de Jean Grosjean. Jean Grosjean est un poète radical et extrêmement doux, comme tous les gens radicaux. C’est aussi un penseur, et c’est un merveilleux lecteur. Pour moi, c’est le plus grand lecteur des évangiles, et notamment de celui de saint Jean, dont il a fait une lecture pas à pas, verset à verset, dans L’ironie christique, parue chez Gallimard [1991]. C’est un livre que je redécouvre à chaque fois, inépuisable, extrêmement dur vis-à-vis du monde, mais cette dureté n’a d’autre sens que de préserver un amour très délicat. Appelons-le, si vous voulez, l’amour de Dieu. Mais je n’y tiens pas particulièrement.
Cette chose, dont je parle, qui est à l’intérieur de cette chambre, interne, si je répugne à la nommer, c’est parce que, me semble-t-il, les mots risquent de la faire s’envoler ou disparaître.
Ce que vous dites fait écho à un passage assez mystérieux du livre de Tobie : « Il est bon de tenir caché le secret du roi (2) » (Tb 12,7.11).
C’est magnifique, c’est tout à fait cela. Ça me va très bien, je ne connaissais pas cette phrase, mais ça me va très bien. Elle est bienvenue, aujourd’hui, cette phrase.
Et ce lieu, cette chambre secrète, n’est-ce pas la source de la joie ?
Je pense, parce que c’est la certitude inexplicable d’être sauvé, que le naufrage ne sera jamais total et qu’il n’y aura pas un engloutissement, de tout, de tout ce qu’on a aimé, de tout ce qu’on a été, de tout ce qu’on a espéré, c’est cette réserve, ce retrait intime. Peut-être est-ce, à l’instant de la mort, dans ce lieu que nous nous réfugions, que nous entrons. Ernst Jünger a une très belle image pour parler de la mort, il parle des Portes de la gloire, du passage des Portes de la gloire. C’est assez magnifique à lire cette phrase. Et la joie, c’est le sentiment que ce que vous avez aimé n’est pas perdu, que ce que vous avez espéré va être encore plus grand que tout ce que vous pouviez imaginer et va arriver, et même est déjà là au fond, et même a toujours été là. La joie, c’est de sentir que ce qu’on attend a toujours été à notre côté.
Ça s’apparente beaucoup à la foi, ce que vous dites là…
Le mot « foi », j’évite de l’employer, parce que, dans le domaine dit « spirituel », il y a une coulée de conventions qui arrive très vite. Il me semble que les discours religieux, je les connais avant même qu’on ait fini de me parler et, en vérité, j’entends qu’on ne me parle pas, parce que, me parler, c’est me réveiller, me sortir de ma torpeur, de la vie routinière, de la vie somnambule, celle qu’il est inévitable, à un certain moment, de connaître. Me parler, c’est m’arrêter, comme un agent de police peut m’arrêter, comme le Christ, j’imagine, arrêtait tel ou tel qu’il désignait du doigt, ou plus violemment encore, juste d’un regard.
Beaucoup de discours estampillés religieux me font penser à des étals de fruits, des pommes rutilantes pleines de chimie. Moi, je préfère aller voler une pomme dans un jardin, ces pommes cabossées, étranges, singulières qui ne ressemblent à rien, parce qu’elles n’ont pas subi de traitement industriel. Il y a une industrie du religieux et du spirituel qui est éprouvante et qui, peut-être, peut expliquer les intégrismes, qui explique aussi l’éloignement de très braves gens, quand je dis « les braves gens », c’est les gens qui sont plus hauts que moi, qui sont plus forts, il n’y a pas mieux qu’une personne « brave » au sens d’ailleurs de courageuse et il y a un éloignement des gens, du religieux, dont le religieux est la cause. Voilà, ce n’est pas les gens qui sont en cause, c’est le religieux. Il me semble que c’est ce que dit le pape actuel, qui est un penseur très profond et qui n’a rien de conventionnel.
Le problème de l’Église, c’est que le serviteur s’est bouclé sur son service, s’est assuré de sa place. Le majordome a pris pour lui toutes les chambres du château… Ça pose un petit problème. Le pape, lui, est un poète. Il n’y a qu’un poète pour rendre le langage aussi vivant. Il restaure un langage qui était devenu un filet d’eau grise, sale, perdue au fond du bénitier où aucune main ne plongeait plus. Parler du bien, parler de la bonté, parler de la lumière, parler de la résurrection, parler de l’amour, ce sont des paroles qui, si elles ne sont pas effilées, aiguisées, vont devenir fades, banales, plus pauvres qu’une chanson de quatre sous. Or cet homme, ce pape, relance – comme on lance des dés – il relance la pauvreté des évangiles, la pauvreté bienheureuse des évangiles, et le langage, qui est le nerf de cette vie. Il le fait avec la matière de l’Évangile, qui est une matière pauvre, mais heureusement pauvre. C’est le cri très violent du Christ : « Je te remercie Père d’avoir caché cela aux lettrés et de ne l’avoir montré qu’aux tout petits. »
Vous qui avez écrit Le très-bas sur François d’Assise, vous avez été touché qu’il choisisse de s’appeler François ?
Ce qui m’a le plus frappé, c’est cette sorte de bienveillance amusée, quand il s’est avancé sur le balcon, le soir de son élection et a imposé silence aux médias du monde entier et à la foule. J’ai compris que toutes les télévisions du monde se taisaient. Leur bruit nous empêche tellement de réfléchir et d’aimer et de vivre ; il faut être très fort pour obtenir ce silence-là. Et, pour les besoins d’une prière, dans le tissu noir qui couvre nos sociétés, il a donné un premier coup de dague. Le tissu s’est déchiré et il y a eu de la lumière qui est venue pendant une minute. La minute de ce silence, c’est le début, c’est le début de sa parole, c’est un coup de tonnerre de silence, il fait taire tout, tout le reste. Il nous fait taire nous aussi.
C’est le début de son pontificat, c’est-à-dire du déploiement de sa parole et je pense que c’est ça une vraie parole. Parce que, si on veut nous ressusciter, il faut commencer par nous tuer, il n’y a pas d’autre moyen, parce que nous vivons d’une façon tellement horrible qu’il faut commencer d’abord par tuer les pauvres bêtes que nous sommes – je parle ici, évidemment par images. Je le précise tout de suite, parce que je sais que, dans des pays, pas si loin, il y a des gens qui pourraient dire la même chose, mais à la lettre. Je parle en esprit. J’essaye.
Vous citez l’Évangile. Sans doute lisez-vous la Bible. Avez-vous des préférences ?
Les psaumes, les évangiles et, là, je passe assez souvent par un intermédiaire. Ma petite église portative à moi, s’appelle Jean Grosjean. J’aime sa liberté de vif-argent. Et comme lui-même se penche sur la Bible, je me penche par-dessus son épaule, pour voir. Parfois aussi, j’ouvre le livre… J’aime beaucoup la traduction « du Maistre de Sacy », celle qu’avait connue Rimbaud. C’est un très beau français, celui de l’époque de Port-Royal, un français qui atteint une forme cristalline. À cette époque, la langue française arrive à maturité.
La Bible pour moi, est comme un livre de poèmes, c’est une fenêtre que j’ouvre, je regarde par la fenêtre, je regarde ce qui est en train de passer.
À propos de l’écriture, la vôtre, vous racontez une forme de possession. Vous êtes possédé par l’écriture ?
Oui, et par les livres, par la lecture. Je distingue à peine la lecture de l’écriture. Pour moi, ce sont deux électricités, d’intensité égale et qui passent par les mêmes circuits. La lecture est venue avant l’écriture, évidemment, mais, dès que la lecture est venue, quand j’étais enfant, l’histoire, sans doute, était close, pliée, c’est ce chemin-là que j’allais prendre. J’étais captif, j’étais un enfant captif des livres et puis les choses se sont poursuivies et, comme toute bonne vraie maladie, aggravées.
Vous avez écrit : « Peu de livres changent une vie, quand ils la changent, c’est pour toujours. » Quels livres ont changé votre vie ?
Bien avant Jean Grosjean, dans ma jeunesse, deux livres, l’un d’Alexandre Dumas, l’autre de Balzac. Le premier n’a pas la même qualité littéraire que le second mais ce n’est pas ça qui comptait. Celui d’Alexandre Dumas, c’est Le chevalier de Maison-Rouge. L’histoire m’a aimanté. Il s’agit des dernières semaines de la reine Marie-Antoinette avant la mort qui lui est promise. Un chevalier essaye de la sauver et n’y arrive pas. C’est aussi simple que ça. Moi, j’ai quoi ? J’ai 12 ou 13 ans quand je lis ça et je crois comprendre dans cette lecture que le sens de la vie, c’est de sauver une reine de la mort. Le chevalier a échoué, mais moi, je n’ai pas renoncé à y arriver.
Eh bien, dites donc, quel programme, garder le secret du roi et sauver la reine !
Oui, je vous invite au château ! Et on mettra le majordome à la porte! Le deuxième livre est assez voisin mais mieux écrit, c’est Le lys dans la vallée. Là aussi, c’est l’histoire d’un dévouement, d’une dévotion. Je n’ai pas rouvert ce livre depuis mon adolescence mais, dans mon souvenir, c’est un jeune arriviste qui s’éprend d’une femme qui a des enfants. Il y a une histoire entre eux, mais cette femme s’efface à un moment, pour que ce jeune homme prenne son envol, pour qu’il aille là où il doit aller, dans la capitale. C’est le sacrifice de cette femme qui m’a bouleversé. Cette passion m’éclairait plus que tout ce qu’on pouvait me dire à propos de cette vie.
Vous écrivez en pensant être publié. Est-ce aussi pour créer un lien d’intimité avec vos lecteurs ?
Quand j’écris, ce n’est pas que je pense à vous, ou à telle personne ou à tel lecteur en particulier, pas du tout. Mais je voudrais que mon langage contienne assez de silences pour que quelqu’un d’autre y vienne et s’en nourrisse. Pour Noireclaire, quand je l’écris, au départ, il est trois ou quatre fois plus grand. Ensuite, je taille dedans, je coupe, j’enlève le plus possible, parce que, il me semble, que « en disant le moins, vous faites entendre le plus ». Le fait d’écrire en pensant qu’on sera publié, ça vous met en état juste d’éveil. Ça vous incite à ne pas bavarder et à faire en sorte que votre langage, votre langue soit tenue, serrée, de façon à ce que le premier ou la première venue puisse y entrer, et partager et connaître la vision que vous avez eue. L’écriture est une manière étrange de prendre soin des gens que vous ne connaissez pas, et même d’une partie de vous que vous ne connaissez pas. Vous voyez, c’est une façon de prendre soin.
|
Christian Bobin
Né en 1951 au Creusot en Saône-et-Loire où il demeure, il est un écrivain et poète. Il a récemment publié Un assassin blanc comme neige (2012),L’homme-joie (2013), La grande vie (2014), L’épuisement (2015)...
Lire :
- Noireclaire, Gallimard, octobre 2015, 88 p., 11 €
- La prière silencieuse, avec Frédéric Dupont, Gallimard, octobre 2015, 136 p., 70 ill., 24,90 €
|
(1) Ossip Mandelstam est un poète et essayiste russe du XXe siècle.
(2) La citation exacte est : « Il est bon de tenir caché le secret d’un roi, [...] tandis qu’il convient de révéler et de publier les oeuvres de Dieu. »
Photos Christian Adnin

/image%2F0991062%2F20191125%2Fob_e0f916_thumbnail-img-8110.jpg)
/image%2F0991062%2F20180321%2Fob_e92b85_20161025-172451.jpg)