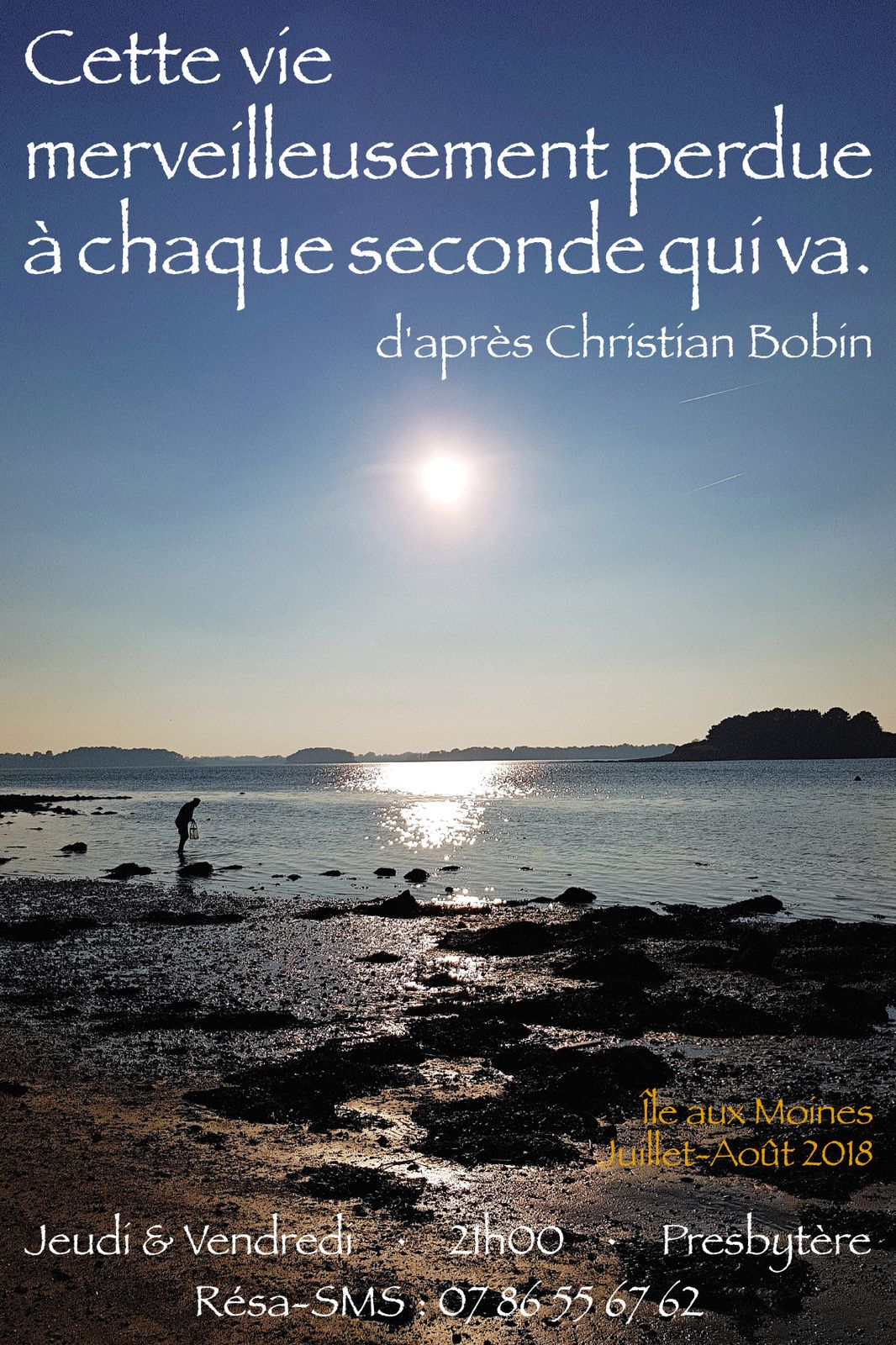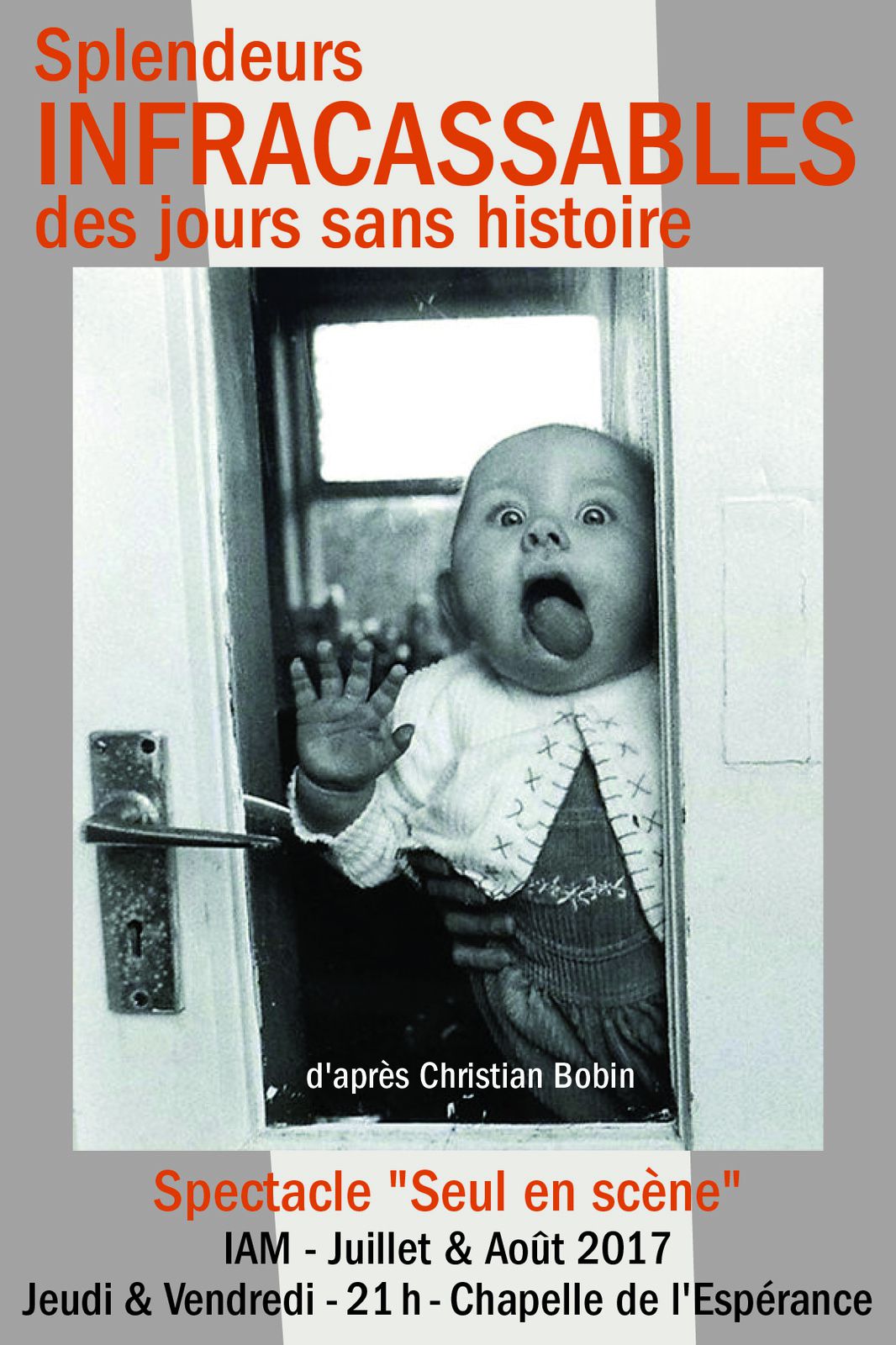Le premier miracle de Jésus fut œnologique, quand, poussé par sa mère à la fin d’un repas de mariage déjà visiblement bien arrosé, il changea l’eau en vin, avant de multiplier pains et poissons pour une foule affamée au cours d’un pique-nique géant. Des noces de Cana à l’auberge des pèlerins d’Emmaüs, sa vie est une succession de repas, avant que, né dans une mangeoire, il ne devienne repas lui-même pour ses disciples, et leur propose de manger son corps et de boire son sang, sous forme de pain et de vin. À première vue, malgré quelques allusions au veau gras et à l’agneau pascal, le christianisme semble avoir davantage contribué à alimenter l’étal des poissonniers, des boulangers et des viticulteurs que celui des bouchers. Cependant il fit aussi leur fortune – et, parfois même, leur infortune…
Si Jésus a multiplié les poissons en son temps, il contribue plutôt à multiplier les brochettes aujourd’hui. Car le christianisme, contrairement au judaïsme dont il est issu, et à l’islam, plus récent, demeure la seule des trois religions monothéistes à ne faire référence ni au pur ni à l’impur, et à ne comporter, à l’origine en tout cas, ni interdit alimentaire ni instructions sur la façon d’abattre les animaux. Sans Jésus, on ignorerait tout du chateaubriand-béarnaise dans le 11e arrondissement et des rillettes en Pays-de-la-Loire.
Pourtant lui-même n’y touchait pas. Jésus était juif, comme sa mère et comme ses disciples, et respectait la loi juive en matière de nourriture. Il mangeait cachère. Et de si bon appétit que ses adversaires le traitèrent un jour de glouton… Il utilise un âne comme chauffage d’appoint pour son berceau, ou comme monture plus tard, mais il ne lui viendrait jamais à l’idée d’en faire du saucisson, et s’il peut envoyer quelques démons migrer dans des pourceaux, il n’en fait jamais griller. Son entourage non plus. Malgré quelques relations contestables pour un bon Juif, comme avec une hérétique, la Samaritaine, un collabo collecteur d’impôts et même un centurion de l’armée d’occupation romaine, ou encore ce malfaiteur, crucifié avec lui, auquel il promet le paradis, la plupart du temps il s’exprime dans des synagogues et affirme qu’il ne veut pas abolir la Torah mais l’accomplir.
À sa façon. Que ses copains ne comprennent pas toujours. Et même très rarement. Jésus passe son temps à faire et à dire des trucs bizarres, qui les laissent pantois. Il tient cela de son Père. Quand on lui reproche, par exemple, de ne pas respecter la tradition en ne se lavant pas les mains avant les repas, il répond : « Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche de l’homme qui le souille, mais seulement ce qui en sort ». Phrase étrange, qui introduit le verset préféré des enfants dans tous les évangiles (mais que leurs mères s’obstinent, depuis deux mille ans, à ne pas entendre) : « Manger sans s’être lavé les mains ne rend pas l’homme impur. »
Et comme Pierre, qui a tendance à mettre les pieds dans le plat, demande, au nom des autres, des explications, Jésus les traite tous d’andouilles : « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que ce qui entre par la bouche passe dans les entrailles et aboutit aux lieux d’aisance ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c’est cela qui souille l’homme. C’est du cœur que viennent pensées mauvaises, meurtres, adultères, fornications, vols, faux témoignages, blasphèmes. C’est tout cela qui souille l’homme ; mais manger sans se laver les mains, cela ne souille pas l’homme. »
En affirmant que ce qu’il mangeait ne rendait pas l’homme impur, Jésus venait de faire passer les lois alimentaires juives à la casserole, mais à l’époque personne ne le comprit davantage que nos mères, qui nous obligeaient toujours à nous laver les mains avant le déjeuner… Ses disciples, qui étaient juifs, continuèrent à observer les prescriptions alimentaires juives, et cette révolution passa inaperçue de son vivant.
Quinze ans après sa mort, au contraire, elle se retrouva au centre du débat, provoquant la tenue du tout premier concile, à Jérusalem, en 49. Question : les nombreux croyants d’origine non-juive qui rejoignaient les disciples de Jésus et suivaient leur enseignement devaient-ils aussi suivre les six cent treize lois juives ? Et, en tout premier lieu, la plus douloureuse, qui n’a rien de culinaire, se faire circoncire, perspective peu réjouissante pour des adultes, malgré l’exemple encourageant d’Abraham, qui le fut à l’âge de quatre-vingt-dix ans… Pierre, l’apôtre des Juifs, et Paul, l’apôtre des non-juifs, soutinrent tous les deux que non.
Pierre, parce qu’il avait fait un songe peu ragoûtant : il avait vu une nappe couvrant la terre où grouillaient toutes sortes d’animaux impurs, à poils, plumes et écailles, et avait entendu une voix tonner : « Mange ! ». Alors qu’il protestait qu’il n’avait jamais rien mangé d’infect ni d’impur, la voix lui répondit : « Ce que Dieu a fait pur, ce n’est pas toi qui vas le déclarer impur ! » La scène se reproduisant trois fois, Pierre comprit que la table du paradis était ouverte à tous… Et Paul, rabbin, intellectuel, et apôtre des païens, éleva et clôtura le débat pour la raison que Jésus était venu sauver tous les hommes – d’abord les Juifs, certes, mais pas seulement eux –, et que désormais il n’y avait plus « ni Juif ni païen, ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, c’est vous qui êtes la descendance d’Abraham ; l’héritage que Dieu lui a promis, c’est à vous qu’il revient. » Exit la circoncision, vive un seul et même baptême pour tous ! La « circoncision du cœur ». Paul inaugure une religion « catholique », c’est-à-dire universelle, ou la foi remplace la Loi. « Le Christ nous a libérés pour que nous restions libres. » Vive la liberté, donc !
Le deuxième épisode est le célèbre incident d’Antioche, en Syrie, qui concerne directement la nourriture et « révèle combien la distinction entre les aliments purs et impurs était cruciale, et divisait profondément Juifs et païens aux premiers temps du christianisme », commente le pape Benoît XVI. Pierre, qui prenait ses repas indifféremment avec les uns ou avec les autres, à l’arrivée d’amis de Jacques, le « frère » de Jésus, se mit soudain à fuir les tables des païens… Fayotage ? Hypocrisie ? Paul lui vola dans les plumes : « Toi, tout juif que tu es, il t’arrive de suivre les coutumes des païens et non celles des Juifs ; alors, pourquoi forces-tu les païens à faire comme les Juifs ? » Pierre cherchait juste à ne pas les choquer, mais, pour Paul, son attitude constituait un risque grave de mauvaise interprétation du salut universel, offert aux uns comme aux autres.
Ils mettront chacun de l’eau dans leur vin, et Benoît xvi s’amuse à rappeler qu’en écrivant aux chrétiens de Rome, quelques années plus tard, Paul lui-même, se trouvant face à une situation analogue, demandera aux forts de ne pas manger de nourriture impure pour ne pas perdre ou scandaliser les faibles… « Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l’édification mutuelle. Pour une question de nourriture, ne détruis pas l’œuvre de Dieu. Tout est pur, certes, mais il est mal de manger quelque chose lorsqu’on est ainsi cause de chute. En effet, le Royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson ; il est justice, paix et joie dans l’Esprit saint. » Liberté et courtoisie seront donc notre devise. Plus tard on adopta le fameux dicton de saint Ambroise : « À Rome, fais comme les Romains. »
Au départ, tous les plats et toutes les recettes étaient donc autorisés… mais pas tout le temps ! Assez vite, les chrétiens, dont l’année liturgique se calait sur la vie de Jésus, pour en revivre les différentes étapes au cours de chaque année (gestation en automne, naissance en hiver, mort et résurrection au printemps, pentecôte en été), et en communion avec lui, par mortification et pour s’élever l’âme, jeûnèrent… Dès le concile de Nicée, en 325, on voit apparaître le terme de carême, signifiant les quarante jours où Jésus jeûna dans le désert, avant de commencer sa vie publique, comme autrefois les Hébreux de Moïse pendant quarante ans. L’idée et l’habitude s’en répandirent dans toute la chrétienté, variant selon les régions, certains orthodoxes renonçant même à toute nourriture d’origine animale pendant ce temps-là. Comme le vendredi, en commémoration du jour où Jésus était mort.
Jeûne et abstinence, ces termes nous sont encore familiers, même si nous en avons perdu l’habitude ; le jeûne consiste à ne faire qu’un repas par jour, au maximum, et l’abstinence porte sur la nature des aliments, la viande et les graisses animales étant interdites. Pendant les longs siècles où la séparation des pouvoirs était inconnue, cette institution fut fatale non seulement à quelques contrevenants, comme Clément Marot, qui se retrouva au cachot pour avoir mangé du lard en carême, – ce dont il tira un poème très amusant qui fit notre joie en classe de quatrième –, mais aussi à quelques bouchers… Même le plus populaire de nos rois, Henri iv, n’hésita pas à édicter carrément la peine de mort, prévue par le Parlement en 1595, contre les bouchers qui vendraient de la viande en carême – menace très politique visant, en fait, ses anciens coreligionnaires protestants, qui rejetaient alors cette pratique catholique…
Alexandre Dumas, dans son Dictionnaire de cuisine, saura trouver des mots assassins à ce sujet : « Quand le clergé fut devenu riche et puissant, son influence fit rendre sur l’abstinence les lois les plus rigoureuses, et tandis qu’il contentait sa sensualité en rompant l’uniformité des viandes par les poissons les plus exquis, que son insatiable cupidité entassait l’or en vendant des dispenses aux riches, le misérable qui n’avait pas d’or pour racheter son malheureux péché était pendu pour avoir mangé de la viande une fois en carême ; le boucher qui en avait vendu était fouetté et mis au carcan. » Pauvre garçon ! Il est vrai qu’il y eut de nombreux aménagements : Anne de Bretagne avait obtenu de racheter, par des aumônes, le droit de manger sur ses terres du beurre en carême, usage qui fut pratiqué aussi en Normandie – et finança la célèbre Tour de Beurre de la cathédrale de Rouen…
Cependant, le carême ne laissait pas aux bouchers de l’Ancien Régime comme seule alternative la prison ou le chômage car, parmi les poissons autorisés, se trouvaient, curieusement, quelques oiseaux…
Alors que les baleines et autres mammifères marins étaient interdits, pas en tant que tels, mais parce que leur chair présentait tous les caractères du « gras », (chair rouge, lard, graisse fondue), à l’inverse, des volatiles aquatiques, nourris de poissons, étaient admis dans la catégorie du maigre. Sans parler du castor, animal amphibie, fort prisé des moines… Qui était chair et qui était poisson ?
Comment s’y retrouver ?
On trouve dans les Mémoires de Madame Campan la solution à ce problème qui se posa à l’une des filles de Louis XV : « Madame Victoire n’était pas insensible à la bonne chère, mais elle avait les scrupules les plus religieux sur les plats qu’elle pouvait manger en temps de pénitence. Je la vis un jour très tourmentée de ses doutes sur un oiseau d’eau qu’on lui servait souvent pendant le carême. Il s’agissait de décider irrévocablement si cet oiseau était maigre ou gras. Elle consulta un évêque qui se trouvait à son dîner : le prélat prit aussitôt le son de voix positif, l’attitude grave d’un juge en dernier ressort. Il répondit à la princesse qu’il avait été décidé qu’en un semblable doute, après avoir faire cuire l’oiseau, il fallait le piquer sur un plat d’argent très froid : que si le jus de l’animal se figeait dans l’espace d’un quart d’heure, l’animal était réputé gras ; que si le jus restait en huile, on pouvait le manger en tout temps sans inquiétude. Madame Victoire fit faire aussitôt l’épreuve, le jus ne se figea point ; ce fut une joie pour la princesse qui aimait beaucoup cette espèce de gibier. »
Très curieusement, c’est exactement la même technique, tirée du bulletin d’une paroisse famélique de Ménilmontant que Léon Bloy, éberlué, recopie, pendant le carême de mars 1910, dans son Journal : « Sous le nom de viande, il faut entendre la chair de tous les animaux à sang chaud qui naissent et vivent sur la terre. Pour les oiseaux aquatiques qui vivent moitié dans l’air et moitié dans l’eau, on n’admet généralement, les jours d’abstinence, que ceux dont le jus en refroidissant ne se coagule pas et reste huileux !!! [sic] » Après ces trois points d’exclamation, Bloy ajoute les noms de toutes ces bestioles, une trentaine, du vanneau huppé au canard morillon, et cet admirateur de Napoléon commente d’un : « Ô Cambronne ! …
Après cette liste de victuailles autorisées par la pénitence moderne, ce serait un blasphème de penser seulement à Dieu, mais je demande à tous les astres, silencieux témoins de l’hypocrisie humaine, si jamais on s’est foutu des pauvres comme ça ! »
Et Léon Bloy était fort catholique…
L’absurdité d’avoir rétabli des lois de pureté et d’impureté alimentaires particulièrement grotesques dans une religion qui n’était pas censée en comporter, l’hypocrisie qu’il pouvait y avoir à considérer un plateau de fruits de mer, un homard grillé ou un bar au sel comme des plats de pénitence, et la perte du sens originel de ce geste, qui consistait à se priver pour faire aumône aux pauvres, trouvèrent un écho à Rome dans les bouillonnements du dernier concile Vatican II, après lequel, en 1966, le pape Paul vi publia une Constitution apostolique sur la Pénitence (Poenitemini), qui modifia les règles élaborées pour le carême.
Les catholiques romains entre les âges de dix-huit et cinquante-neuf ans sont tenus de jeûner le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint, et de s’abstenir de viande, mais les seuls vendredis de carême. L’abstinence est élargie à de nombreux aliments, dont le jus de viande, et le choix laissé à chacun de choisir de quoi il se priverait, et aux évêques locaux les œuvres de charité ou de piété à entreprendre pour leur communauté pendant ce temps-là.
Quand je suis allée en Californie, au printemps dernier, les catholiques avaient décidé, comme sacrifice de carême, de trier leurs ordures ménagères…
Une vraie révolution !
http://laregledujeu.org/2011/11/10/7689/le-christ-un-nouveau-regime/

/image%2F0991062%2F20191125%2Fob_e0f916_thumbnail-img-8110.jpg)
/image%2F0991062%2F20180321%2Fob_e92b85_20161025-172451.jpg)










/https%3A%2F%2Fwww.rts.ch%2F2014%2F04%2F09%2F11%2F53%2F5760294.image%2F16x9%2Fscale%2Fwidth%2F640)













/http%3A%2F%2Fi1.sndcdn.com%2Fartworks-000241489879-picqcl-t500x500.jpg)