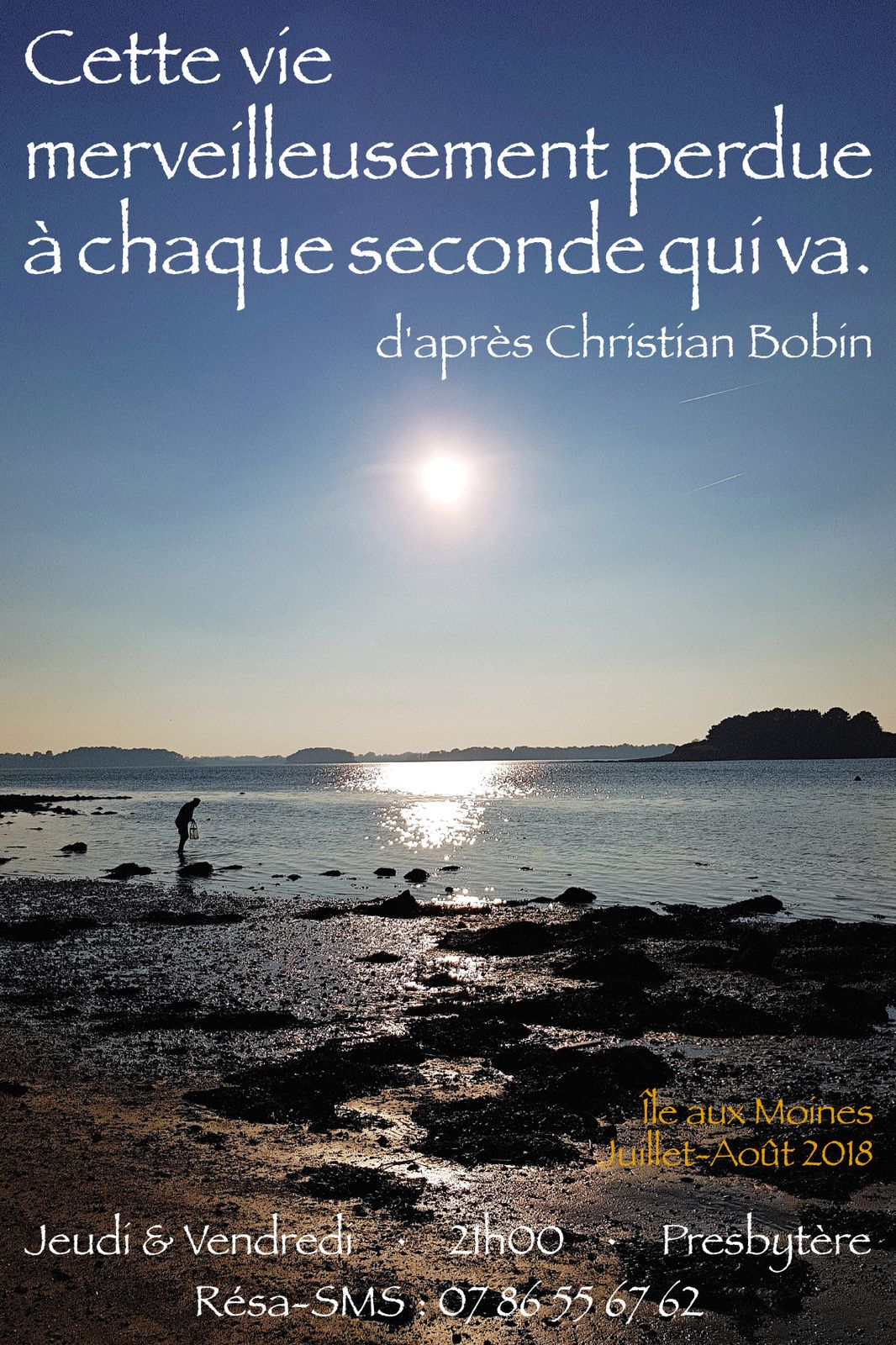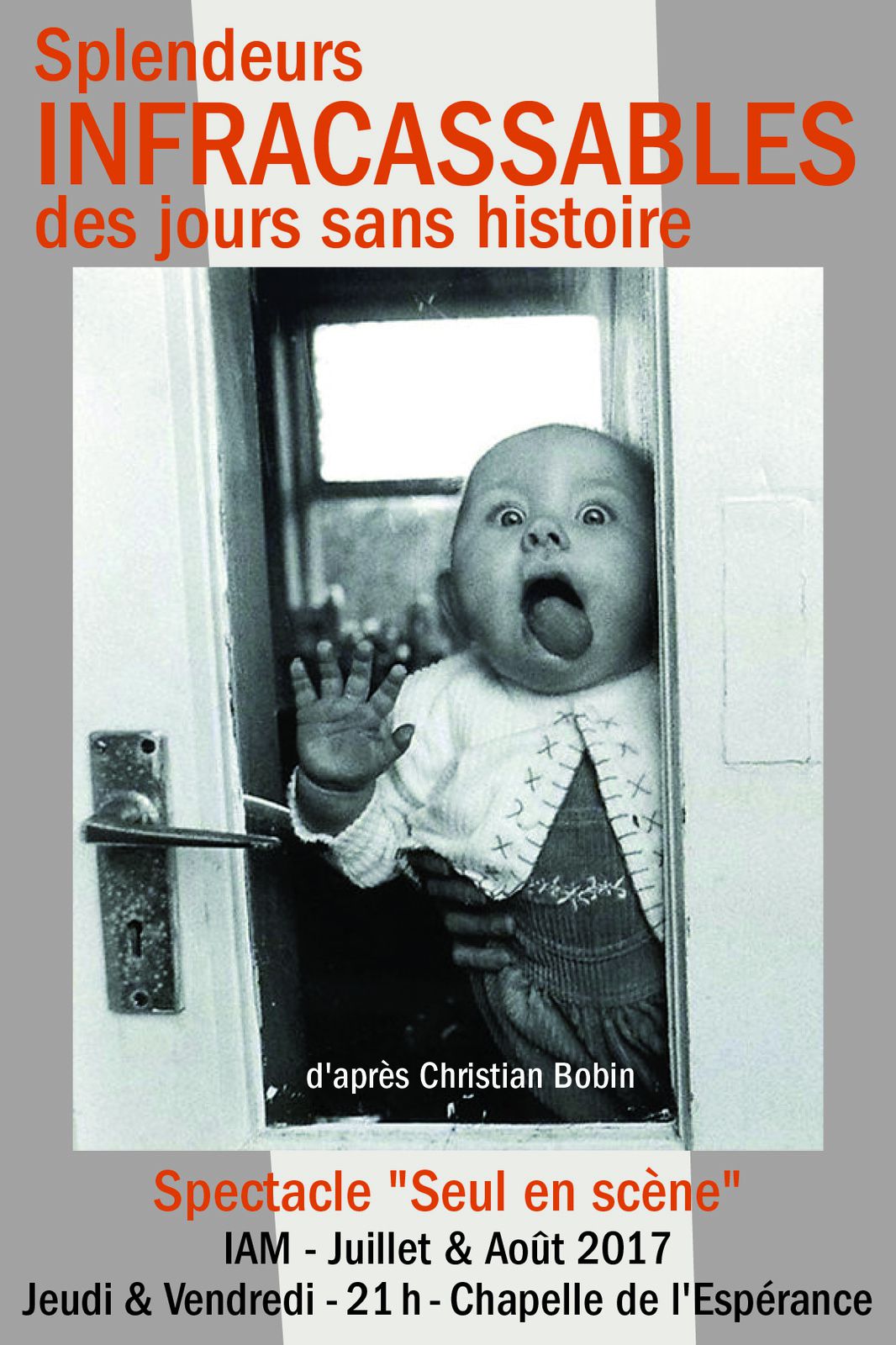Il faut contourner Le Creusot et, au-delà des étangs, emprunter un étroit chemin entre les arbres. La maison basse aux volets bleus se cache dans une clairière ourlée de foin. Sur la table de la terrasse, du café et une brioche. Sandales aux pieds et rire clair aux lèvres, Christian Bobin nous reçoit chez lui. Autant dire au bout du monde.
Vous êtes vraiment à l'écart ici. Depuis quand vivez-vous là?
Mes infirmités sont nombreuses et l’une d’elles, c’est que les calendriers brûlent dans ma tête, les dates se mélangent. Je suis resté jusqu’à trente ans chez mes parents et j'ai habité ensuite dans un logement à côté, avenue de Gaulle, jusqu’à trente-trois ans à peu près. Après, j’ai émigré du Creusot au Creusot dans une rue qui s’appelait Traversière où je me suis laissé tutoyer par un tilleul qui était devant la fenêtre. Puis, avec mon amie [l'écrivain Lydie Dattas], on est venu ici. Cela fait six ou sept ans qu’on est là, dans la forêt. C’est à dix minutes du Creusot. Ce qui nous a décidés, avant même la maison, c’est le chemin.
Quand on cherche, ce n’est pas…
Oui, j’aurais dû vous le dire. Il ne faut pas se fier au nom du village où je me trouve. Ce sont les bizarreries de l’administration. Je suis comme en exil dans ma propre commune.
Vous dites que vous n’avez pas beaucoup voyagé, que vous êtes allé du Creusot au Creusot. Au fond, votre pays, c'est la page blanche?
Oui, de plus en plus. Mon pays c’est l’écriture. C’est un pays qui pourrait se comparer à la Terre promise. C'est-à-dire qu’on n’y arrive pas. Il existe et il n’existe pas. C’est un pays en apesanteur, un pays qu’on espère. Il est passé et à venir. Il est beaucoup plus à venir que passé d’ailleurs. Je n’ai pas de nostalgie.
Mais quand vous dites "Je me souviens du 12 mai 1944" à propos de Jünger (1). C’est quand même le passé…
Non, ce n’est pas le passé à ce moment-là. Quand je lis un livre qui me touche, la personne n’est pas morte. Elle est là, assise à table, voyez. Hier, je lisais un poète russe qui s’appelle Mandelstam. Chaque poète a sa singularité de même que chaque champignon a sa forme, sa couleur. Il y a des variétés innombrables et toutes ne sont pas répertoriées. La spécificité de Mandelstam, qui est sans doute le plus grand poète russe et qui est mort dans un camp sibérien en 1938, c’est que ses poèmes arrivent à attraper quelque chose que je croyais inattrapable. À savoir l’air que l’on respire. Il qualifie cette chose invisible qui passe entre les gens, qui est secrètement teintée par l’air du temps, les atomes de l’air. Ses poèmes sont extrêmement respirants pour le lecteur. Quand je lisais, il était sur la chaise, là. Il était à votre place.
On a bien fait, alors, de ne pas venir hier...
(Rires) On aurait mis un couvert et une tasse de plus. Il y a de la place pour tout le monde. J’attends des amis gitans, mon amie va les accueillir.
Quand vous lisez Mandelstam, c'est en traduction?
Oui, je ne connais pas le russe. Je prends plusieurs traductions. Évidemment, il y a une déperdition. Mais, comment dire, la parole poétique c’est la main dans le feu, c’est la main qui va chercher des morceaux du feu. Elle n’a pas le temps de se refroidir complètement quand elle nous arrive, même traduite. Donc, j’arrive à voir des brillances, des lueurs originelles. Cela dit, je me doute qu'un Russe qui ne connaîtrait que sa propre langue perdrait beaucoup de choses en lisant Rimbaud. Je regarde plusieurs traductions. Certaines sont un peu ampoulées. Certaines qui veulent aller dans le poétique poétique... Ce qui est la définition de l’horreur. Et il y en a d’autres, je sens qu’il y a quelque chose de libre, de vivant qui passe. J’arrive à voir, à travers l’interprète, le fantôme qu’il y a derrière lui, fantôme ô combien vivant.
Vous travaillez à quoi en ce moment?
Je travaille depuis quelques jours à un texte sur mon père. Il n’est plus là depuis 1999. Mais il n’y a pas la séparation. Je ne vis pas cette séparation entre les vivants et les morts ou, du moins, la démarcation ne se fait pas pour moi là où on la met, avec un peu de marbre et un peu d’oubli. Pas du tout. Jünger, Kierkegaard, Jean Grosjean sont des gens à jamais vivants. Ils ont frôlé quelque chose qui s’appelle l’esprit. Et le fait de l’avoir frôlé les a nimbés, protégés à jamais, a protégé leurs paroles et leurs livres. Ils sont à jamais vivants. Pour peu que nous, nous consentions à être vivants, ils le sont. Dès qu’on ouvre leurs livres, si on sort de nos routines, ces vivants absolus nous parlent.
A travers nous ?
C’est plus fort que ça. Il y a des gens qui sont d’aujourd’hui… Quand je prends le train - je ne veux pas faire de généralités mais je suis obligé de radicaliser pour faire voir - quand je vois des hommes d’affaires dans le train, je vois de plus en plus des visages qui diminuent dans l’humain. C’est comme si on enlevait une pellicule du visage. Le terrible, c’est que ce sont les gens eux-mêmes qui enlèvent l’humain de leur visage. Ils enlèvent l’humain comme on enlevait les masques jadis. Mais le problème c’est que derrière il n’y a plus rien. Il y a quelqu’un de très correct, de très poli, de lisse et qui a sur sa chair un peu blette des reflets bleutés d’électronique. Parfois, un contemporain me sera dix mille fois plus loin que Ronsard ou quelques autres.
Mais nous parlions de votre père...
Mon père, il est omniprésent. Il continue même de faire son travail d’éducateur en moi. J’ai été engendré par un soleil. Je suis comme un fils du soleil. Mon père était un homme simple et profond. Il avait l’intelligence la plus belle, celle qui vient de l’instinct et du cœur. Il était ouvrier, ensuite il a enseigné le dessin technique dans les usines Schneider. Ça, c’est sa fonction sociale. L’essentiel, j’aurais du mal à le dire mais c’est une confiance irraisonnable et merveilleuse dans la vie, qu’il m’a transmise, pas par les mots mais simplement parce que je l’ai vu faire.
Il lisait vos livres ?
Oui.
Et alors, vous en parliez ?
Ah, c’était beau. C’était beau parce que vers la fin, par exemple, quand cette maladie a posé sa main sur son épaule…
Alzheimer…
Oui. Comme souvent dans ce genre de maladie, on ne voit pas tout de suite ce qu’il se passe. On sent, on entend des choses un peu étranges, on voit des choses un peu particulières. Mon père a lu La folle allure (2), une histoire qui se passe dans un cirque en partie. J’ai appris qu’après avoir lu le livre, il s’est tourné vers ma mère et lui a dit : "Mais qu’est-ce qu’il raconte Christian, on n’a pas grandi dans un cirque!". Il avait pris le récit, une histoire inventée, pour une histoire réelle. C’est assez joli d’ailleurs. Autre chose m’a étonné à propos de cette maladie. Elle est beaucoup plus profonde et étrange qu’on ne le dit. Dans les premiers temps - ce n’est qu’après que je m’en suis rendu compte -, mon père marquait un étonnement de plus en plus vif sur tout. Il était étonné, de cet étonnement qui est pour moi la racine même de la poésie. Il est possible que la poésie qui est pour moi la santé absolue soit comme une sorte de maladie mais une maladie lumineuse. Mon père allait faire ses courses dans les endroits toujours les mêmes, auprès des mêmes commerçants, traversant les mêmes rues, et tout d’un coup il revenait à la maison et disait: "Je ne comprends pas, tout est neuf. Je regarde, et partout où je regarde c’est la première fois. Les arbres, les lieux, tout est neuf". J’ai trouvé ça émerveillant. Après coup, j’ai compris que le bateau du cerveau avait commencé à rompre les amarres… De mon père, je pourrais parler infiniment.
Et de votre mère ?
Elle était un peu plus énigmatique.
Elle était centenaire lors de son décès...
Oui. Elle est morte en mars de l’an dernier. Elle n’était pas très loin de sa cent-unième année.
Vous en parlez moins dans vos livres.
Je peux vous faire une réponse là-dessus. Jünger, qui est un écrivain que j’aime beaucoup, on lui a dit: "Mais vous ne parlez jamais de votre mère". Il a rétorqué: "Est-ce qu’on parle de l’air que l’on respire?"
Que vous aimiez Jünger, ça peut étonner quand même. Peut-être pour ses derniers livres... Mais Orages d’acier (3), par exemple...
Quand j’aime quelqu’un, je ne fais pas de détail. Je le prends dans mes bras et je l’emporte à jamais. Je lui ouvre une petite chambre dans la maison rouge du cœur. Avec ses défauts, avec sa jeunesse, les choses imprécises, les choses maladroites, tout ça. Orages d’acier, c’est quelque chose qui me plaît aussi. Très jeune, Jünger a une sorte de bravoure, il est comme enivré. Il a écrit un livre qui est un drôle de livre: La guerre comme expérience intérieure(4). Il faut bien entendre le titre. C’est un livre un peu nietzschéen, un livre épris du combat. Avec le temps son esprit s’est adouci. Moi je le tiens pour un écrivain aussi grand que Montaigne. C’est un Montaigne du XXe siècle. Il a la même vertu que Montaigne. Quand j’ouvre un de ses livres - je pense notamment aux journaux parisiens -, quand il est dans Paris occupé, quand son esprit vagabonde comme il l’a toujours fait, il a un soin pour la matière, pour les gens, pour les nuages, pour les livres, le même soin profond, très humain. C’est le soldat le moins militariste que je connaisse. Et c’est l’homme le plus fraternel pour la vie fragile. Quand il croise la première femme portant une étoile jaune dans les rues de Paris, il lui fait un salut militaire. Ce salut qu’on ne rend qu’aux vainqueurs, il le donne d’instinct aux martyrs. Son livre Sur les falaises de marbre(5) est sans doute le livre anti-hitlérien, antitotalitaire le plus radical. Il a failli lui coûter cher. C’est un homme, s’il est ivre c’est de songes mais pas de sang. C’est un homme de merveilleuse, de très bonne compagnie. Croyez-moi car moi je me sens en paix. Sauf si je pense que le tissu de la vie est la guerre, mais pas la guerre qui se pratique en Syrie.
C'est-à-dire...
Le tissu de la vie est une confrontation. On peut dire que c’est une guerre paisible. C’est une confrontation sans cesse. Quelque chose ou quelqu’un vient à votre rencontre et vous avez affaire à cette chose, à cette personne. Il faut faire émerger quelque chose, si possible, de pur, de lumineux. Alors qu’une fleur ou un arbre qui vient à votre rencontre c’est peut-être plus facile, encore faut-il avoir les yeux pour le voir. L’éternel est un peu captif de ce monde. Il faut l’en arracher. C’est pour ça qu’il faut avoir quelque chose de guerrier. L’idéal serait d’avoir une âme contemplative et guerrière en même temps. Un guerrier contemplatif, si vous voulez. C’est ce que j’aimerais être.
Il y a un autre écrivain qui est très présent dans vos livres, c’est André Dhôtel. Comment a commencé ce compagnonnage?Qu’est-ce qui vous attire chez lui. De quoi vous parle-t-il ?
Je ne sais plus quand ses livres sont arrivés jusqu’à moi. Mais ce que je sais c’est que dès qu’ils sont arrivés ils ne sont plus jamais repartis. Et ils ont ramené tous leurs frères un à un. Ce qui me touche c’est son toucher de la vie, c’est la justesse profonde d’un homme qui fait que la grâce est à l’intérieur de la disgrâce. Pour le résumer, je dirais - et il est tout entier là-dedans -, qu’il a écrit, ça fait une demi-page, le plus beau texte de toute la littérature de tous les temps. Je peux vous le résumer, ce texte. Il commence par une question d’enfant, Dhôtel a la vertu de commencer par une question d’enfant que nous ne poserions pas, que nous ne saurions pas poser. Est-ce qu’on peut détester une fleur? Il commence par répondre oui. Et il parle des achillées, des fleurs qui sont des ombellifères. Il dit "Un jour j’ai vu une achillée qui était grise pâle, un blanc sale, et je ne l’ai pas aimée". Ensuite, il continue et dit: "Je suis allé dans un autre jardin un peu plus tard et j’ai vu des fleurs de cette sorte-là, d’autres achillées mais colorées. Et elles étaient éclatantes, magnifiques. Je les ai adorées". Ensuite, et c’est là où ce texte me bouleverse, il dit: "Je suis revenu vers la première, c'est-à-dire la souillon, la rejetée et je l’ai aimée d’amour". On sent même qu’il l’a aimée plus que les autres. Et ça, c’est tout à fait le mouvement de ses livres.
Vous l’avez rencontré ?
Malheureusement, non. Mais j'ai rencontré Jean Grosjean.
Et avec Grosjean vous parliez de Dhôtel ?
Un petit peu, oui.
Comment vous vous êtes rencontrés avec Grosjean. Par ses poèmes ?
C’est mon amie Lydie Dattas qui m’a présenté Jean Grosjean. En me le présentant, elle me présentait l’une des pensées les plus acérées sur ce monde et sur l’autre. L’autre monde qui est mélangé à celui-ci d’ailleurs. On peut même presque dire qu’il n’y a qu’un monde. Soit on le traverse en somnambule, soit on le traverse les yeux ouverts. Et ça change tout. Grosjean parlait beaucoup d’histoire. Il parlait de… Il parlait et sa présence redoublait et développait un autre discours que sa parole mais qui n’était pas contradictoire. Et sa présence est encore plus riche que sa parole. Sa présence silencieuse. Son visage était un manuscrit encore plus riche que ses livres.
Et ses poèmes?
C’est incroyable, ses poèmes. D’une simplicité qui fait penser qu’il n’y a rien tellement c’est parfait.
Il n’y a rien et il y a tout. Chez Dhôtel c’est un peu la même chose. C’est un fragment de miroir perdu dans un fossé…
Oui. C’est proche du Tao ce que Grosjean fait. C’est une sorte de taoïste qui traverse l’Évangile. C’est quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui me touche dans ses poèmes, c’est que leur auteur est un des rares hommes qui ait su faire entrer un brin d’herbe dans un livre sans que le brin d’herbe se fane. Il continue à vibrer à chaque lecture. C’est très délicat comme présence, comme tenue dans la langue.
C'est quoi une phrase parfaite? Vous en avez écrit?
J’ai une joie à rapprocher le langage de ce que mes yeux ont vu, à ramener le langage au plus proche de ce que mes yeux ont vu. Mais de là à dire que c’est parfait… Moi ce qui me plaît, ce qui me touche… Comment dire. Dans La grande vie, par exemple, j’aimerais que les choses me viennent de plus en plus comme "La lettre au petit merle" (6), voyez ? Et c’est un peu de la famille de L'Éloge du rien (7). J’aimerais quelque chose comme ça, qui vienne comme… Il y a un travail derrière. Mais en même temps, l’élan premier a amené les trois-quarts de la lettre, tout seul. Ça vient du vent. C’est le vent qui m’a apporté ça. J’ai juste eu l’intelligence, si c’en est une, d’attraper le papier qui volait et de le plaquer sur la table pour ensuite le mettre dans mon livre. C’est donné. Les choses heureuses sont données. Les choses parfaites, là j’en parle en tant que lecteur d’autres livres, sont aussi données. C’est le plus beau cadeau qui soit. Une phrase heureuse, c’est celle après laquelle vous n’avez plus à chercher. Ça s’appelle une clairière dans les contes de fées, c'est-à-dire, tout d’un coup, les ténèbres se sont en allées, ne serait-ce que pour un temps. C’est toujours pour un temps, pas plus.
Une lumière qui vous tombe dessus.
Voilà. C’est ce qu’on appelait jadis lorsque les rayons de soleil percent en oblique, une gloire. C’est ce que j’aimerais trouver comme lecteur, et éventuellement comme écrivain, dans le langage. Quelques rayons de soleil qui percent le langage comme ils le font avec le ciel naturel, et qui donnent naissance à ce qu’on appelle une gloire. Une gloire qui n’est la gloire de personne d’ailleurs. C’est ça qui est beau.
Comment vous écrivez, vous prenez des notes? Comment ça se passe?
J’ai mon ordinateur sur moi: c'est un feutre. Et du papier.
Le tracé est assez épais?
C’est une pâte. L’écriture est un domaine assez abstrait par lui-même. J’aime bien que ça garde quelque chose de concret. C’est un travail pictural pour moi. Ensuite, je fais porter mes pages au Creusot dans une boutique.
Pour qu'elles soient "tapées"?
Voilà. Je les fais saisir, je les corrige. Je n’ai pas internet pour l’instant. Je dis pour l’instant parce que bientôt j’y serai contraint.
Comment les mots viennent ?
C’est très simple. Si vous vous retournez… Mais vous ne le verrez pas d’ici. Il y a un églantier autour d’un arbre. Il y a quelque temps, je passe et je suis porteur d’un souci, d’une ombre. Tout d’un coup, je me sens comme interpellé par une fleur de l’églantier en raison de sa perfection. Et sa perfection, c’était sa mortalité. Elle était réussie et demain elle serait déchiquetée par le vent. Sa fragilité était celle d’une reine. Je me suis approché et j’ai regardé. J’ai vu le blanc du calice, les pétales formés et surtout le rose du pourtour. Et c’est marrant parce que je me suis relevé et je n’avais plus de souci, d’ombre. Ça m’a tellement touché que j’ai pensé que j’écrirais dessus. Ça vient comme ça l’écriture. Quand quelque chose ou quelqu’un m’interpelle. Ça vient du dehors, ça rentre en moi et c’est porteur de tellement de choses que pour les voir, ces choses, je suis obligé de les démêler. Écrire c’est les démêler. J’écris pour voir clair dans l’éblouissement que j’ai eu. Et paradoxalement de façon à ce que cet éblouissement arrive au lecteur ensuite. C'est-à-dire que la chose reste vivante. Il y a des perceptions qui sont mortifères, il y a des soins qui peuvent être inappropriés. Il ne faut pas évidemment que ce que vous avez vu soit sur la page comme un papillon transpercé par une épingle. Ce n’est pas intéressant. Pour moi, l’air doit passer entre les mots et entre les phrases. L’air doit rentrer dans le langage et le faire bouger un petit peu comme l’étoffe. Voilà. Alors, je ne prends pas de notes et je suis tellement touché que je pense que je vais écrire et peu importe si je ne le fais pas tout de suite. Ça peut être le lendemain, ça peut être une semaine après. L’impression continue de donner son timbre à l’intérieur de moi. Je continue à l’entendre. Si j’attends trop, les choses vont se diluer, se perdre mais pendant quelques jours, je sais que, à n’importe quel moment, je peux me mettre là et la chose va revenir. Mais je n’ai pas de plan, surtout pas, pas d’idée préconçue. Je veux juste transmettre quelque chose qui m’a traversé. Ce qui m'intéresse, c'est de transmettre un orage mais avec ses lueurs beaucoup plus qu’avec ses grondements. Si vous voulez, le feutre ça devient un sismographe. Ça transmet - idéalement car ça ne fait pas toujours ça - les tremblements de l’âme. Les tremblements de l’émotion que vous avez eue.
Quand vos livres paraissent en poche, par exemple, vous les relisez ?
Non. Ça m’arrive de reprendre un livre mais pour très peu de temps, juste pour vérifier que je ne suis pas en train de retrouver la même image.
Et quand bien même...
Ce serait un peu gênant parce que je pense avec Grosjean - c’est une belle phrase de lui dans Clausewitz - que "le saint, le stratège et le poète ont le devoir de toujours surprendre". Je trouve que c’est vrai.
Est-ce qu’on peut vous définir comme un chercheur de merveilles ?
Non. Je ne suis pas chercheur. Je ne cherche pas.
À propos de ce beau texte sur Marylin: "Même dans l’enfer, et nous y sommes, il y a des merveilles" (8)...
C’est bien d’avoir relevé "et nous y sommes". Oui, c’est ça qui est étonnant. Nous vivons dans un enfer. La merveille est toujours à côté du terrible et parfois elle est dedans. Et si je mets plus l’accent sur l’une que sur l’autre, on va dire que c’est par courtoisie ou même par ce que je qualifierais d’élégance ou par désir d’élégance. Aujourd’hui, la coutume et la bien-pensance veulent que l’on insiste sur les ténèbres, et que, puisque tout est noir, on va rajouter une couche de noir. On va prendre une laque pour que ce soit bien plus solide. Notre monde est peut-être plus terrible qu’il n’a jamais été d’ailleurs. Mais je me dis: "Faisons le travail de celui qui va regarder, qui va trouver quelques lueurs au fond de cette cave". L’autre travail, qui est celui des fossoyeurs, ils sont tous candidats pour ça. Ils n’ont même pas assez de pelles et de pioches. Je préfère, par goût, pour des raisons même qui m’échappent, d’enfance, de tempérament, aller de ce côté-là. Mais je sais que l’autre côté existe, évidemment. Je creuse et quand je trouve quelque chose, c’est toujours sur un fond dur. Peut-être que si je n’avais pas eu cette ombre un peu forte sur mes épaules, je n’aurais pas vu cette lumière donnée par la fleur d’églantier.
C'est peut-être grâce à votre regard d'enfant. Vous êtes toujours en enfance ?
Alors écoutez... Tout à l’heure, j’ai cherché des photographies et je suis tombé sur ma tête de bébé. Ça m’embête un petit peu de le dire mais je n’ai pas beaucoup bougé (grand éclat de rire). J’ai vu une tête d’argile sur laquelle pouvaient se mettre toutes les émotions, un grand front, des yeux à la fois étonnés et inquiets. Je me suis dit: "Eh bien, je n’ai pas beaucoup avancé. ça m’a presque gêné" (grand rire). Oui, parce que si vous êtes un nouveau-né dans le monde, il va vous arriver des problèmes (rire).
Moi, je trouve que c’est une qualité. Par rapport à tous ceux qui pensent qu’ils vont faire tellement bouger, qu’ils sont devenus des seigneurs et des rois…
L'enfance est partout dans vos livres, l'amour aussi. Il est dévalué? Votre but c’est quoi, lui redonner sa pureté ?
Sa force, sa vigueur.
On vous l’a reproché parfois...
Oui. Mais ce n’est pas grave. Là-dessus, sur les critiques qui peuvent être très féroces, qui vont parfois très loin parce que ce sont des combats de boxe. On se paye la personne. Ça, c’est éternel. Freud disait: "Quand vous rencontrez de la résistance, c’est le signe que vous avez bien travaillé". Donc je n’ai pas trop mal travaillé parce que parfois je rencontre des résistances très fortes.
La psychanalyse vous intéresse? Vous citez Freud.
Tous les hommes qui ont cherché à réfléchir m’intéressent sans que j’épouse leur cause. Je n’ai pas suivi de psychanalyse, je n’en suivrai pas.
L’écriture est une psychanalyse.
C’est plutôt un dévoilement du monde que de soi. Curieusement, je m’enferme pour sortir. C'est-à-dire, j’écris donc je m’enferme à ce moment là, mais c’est pour sortir, de moi déjà. C’est pour prendre l’air. Moi qui ne voyage jamais, j’écris pour prendre l’air.
Vous ne voyagez pas, vous paraissez être quelqu’un qui est coupé du monde…
Non. Pourquoi? Je parais coupé du monde?
Vous suivez l'actualité?
Un peu oui. Il n’y a pas de jour où je ne lise pas de journaux. C’est peut-être une maladresse qui se trouve dans mon langage mais il faut distinguer le monde et les gens. J’aime les gens et je n’aime pas le monde. Et c’est parce que j’aime les gens que je n’aime pas le monde. C’est ce que le monde fait des gens que je n’aime pas. Donc ce qu’il se passe m’intéresse, bien sûr.
On a pensé à vous au moment de la désignation du nouveau pape. François est dans la droite ligne du Très-bas (9)?
Oui. De François d’Assises, en tout cas.
Vous l’avez regardé comment, ce pape ?
Je l’ai trouvé magnifique. J’ai vu la cérémonie après son élection. Je l’ai vu s’avancer sur ce balcon et j’ai entendu la simplicité de ses mots... Et j’ai vu aussi qu’il a réussi ce tour de force d’imposer le silence à tous les médias pendant une minute à peu près. Voilà un dompteur de lions. J’aime beaucoup cet homme. J’aime sa… Il a une sorte de radicalité bonhomme. C’est un faux simple.
On a dit qu’il était le disciple de François d’Assise. Vous pensez qu’il le mérite?
Ça, c’est le temps…
Vous qui avez bien connu François d’Assise. D'ailleurs, il est peut-être venu s’asseoir ici. Ou alors il viendra demain…
(Rire). Oui, il y a du passage, ici! Il y a du monde! (Rire). Qu'il le mérite? C’est le temps qui révèle les gens. Pour ce pape, on verra.
Est-ce qu’il y a des jeunes écrivains actuels que vous suivez particulièrement ?
Non. Pas vraiment. Je lis peu de choses d’aujourd’hui.
Ceux dont on parle, qui ont des prix…
Non. Je n’ai pas d’appétit pour ça. Je lis beaucoup de poésie. La poésie fait son propre ménage. La poésie fait son propre prix. C'est-à-dire que vous pouvez faire illusion aujourd’hui avec un roman parce que vous aurez pour vous la force, le culot de l’histoire. Vous ferez illusion pendant quelque temps. Mais un poème, c’est comme une fleur. Si ça ne tient pas dans l’eau, ça fane tout de suite. Comme les hortensias que vous m'avez apportés et qui ont l’air d’avoir bien supporté le voyage. On verra.
Propos recueillis par Didier POBEL et Bernard REVEL
----
(1) Dans le dernier ouvrage publié par Christian Bobin, La grande vie, op. cit.
(2) C. Bobin, La folle allure, Paris, Gallimard, 1995.
(3) E. Jünger, Orages d'acier, Paris, Le livre de poche, 2002.
(4) E. Jünger, La guerre comme expérience intérieure, Paris, Christian Bourgois, 2008
(5) E. Jünger, Sur les falaises de marbre, Paris, Gallimard, 1979.
(6) Dans C. Bobin, "L'empereur du Japon", La grande vie, op. cit.
(7) C. Bobin, Eloge du rien, Paris, Fata Morgana, 1990
(8) C. Bobin, La grande vie, op. cit.
(9) C. Bobin, Le très bas, Paris, Gallimard, coll. "L'un et l'autre", 1992.

/image%2F0991062%2F20191125%2Fob_e0f916_thumbnail-img-8110.jpg)
/image%2F0991062%2F20180321%2Fob_e92b85_20161025-172451.jpg)




/http%3A%2F%2Fdb.radioline.fr%2Fcovers%2F32481%2Flogo64.png)