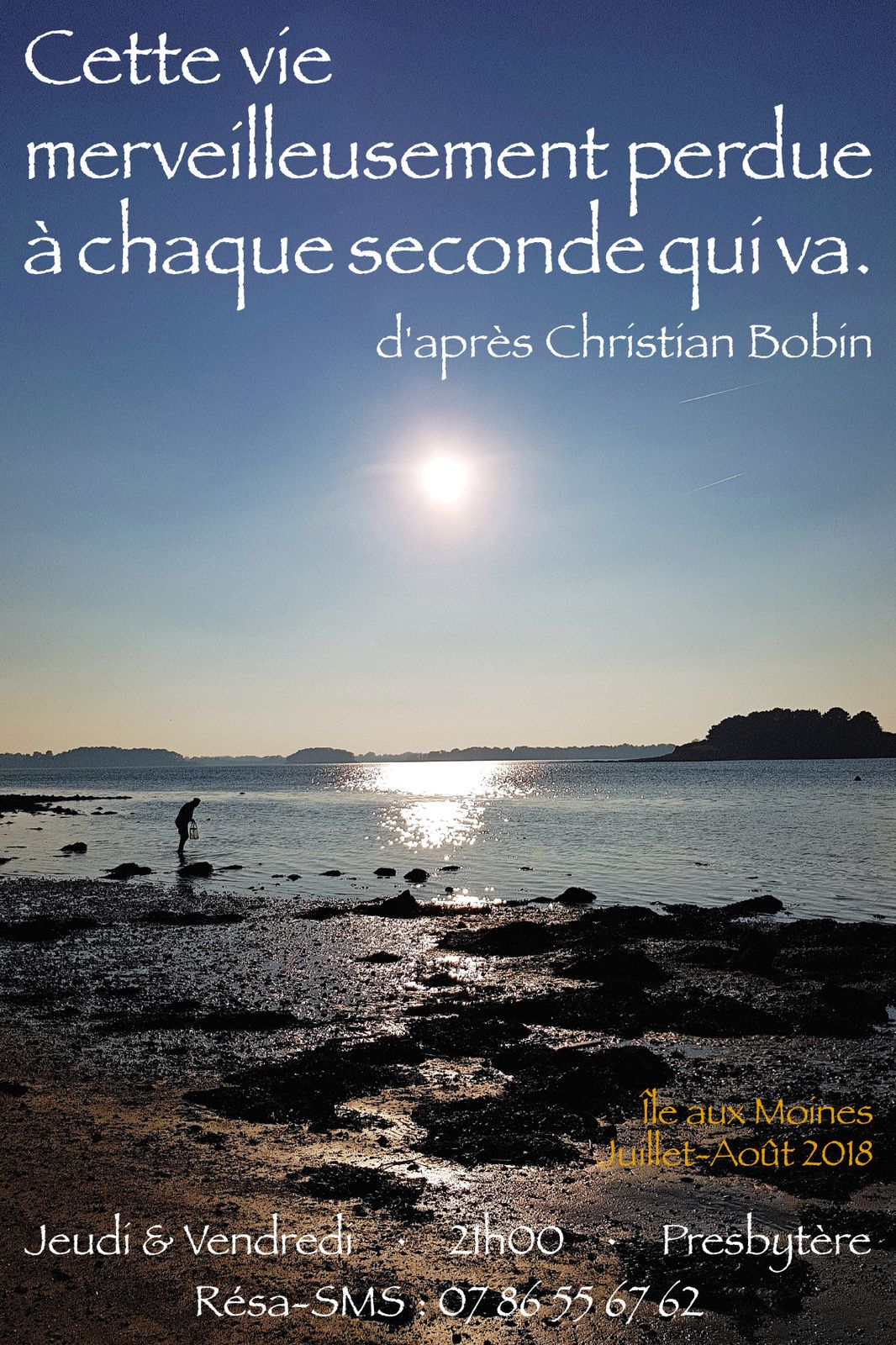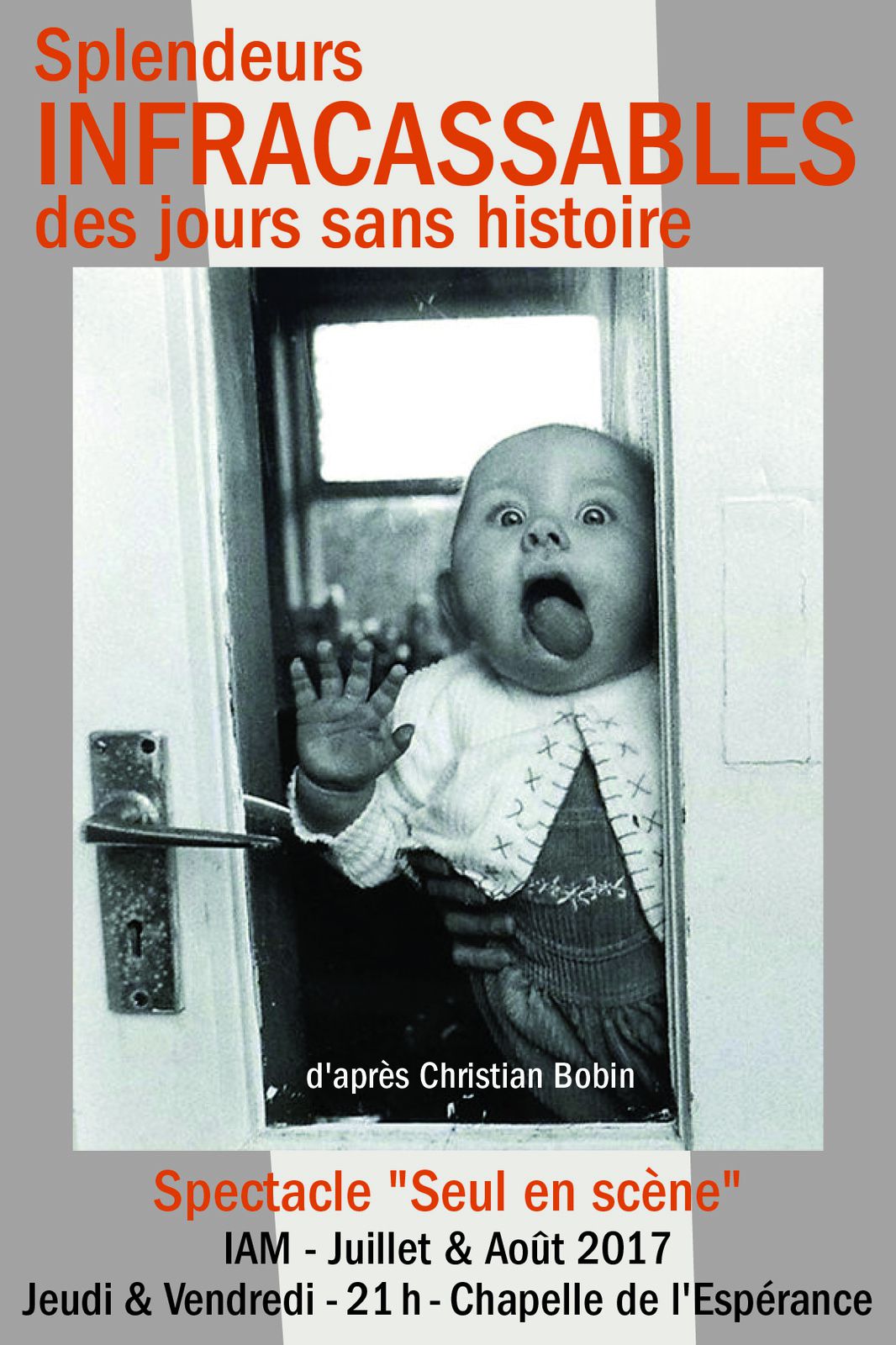Notre âge est las ... il est blasé sur l’inattendu..
Messieurs,
En m’accordant vos suffrages, vous contraignez un amant de la grand’route à s’arrêter ; votre Compagnie, créée pour fixer le langage, fixera cette fois l’écrivain. En même temps qu’un honneur dont je mesure l’étendue, c’est un extrême bonheur que de remonter tant de siècles. Cette alternance de couronnements et de funérailles auxquelles succèdent de nouveaux sacres académiques, prend la majesté d’une loi biologique. J’y satisfais un besoin de continuité qui hanta toujours une vie pleine d’accidents. Cette célèbre Coupole est un abri contre le changement : au terme d’une existence où rien ne cessa de bouger, je vais goûter les bienfaits de la stabilité. Que j’en ai vus de cœurs intermittents, de géographies élastiques, de situations fluides, de fortunes fondantes, de mœurs chancelantes, de monnaies à éclipses, de vérités contradictoires, toutes définitives ! Notre âge est las des farces et attrapes du Destin ; il est blasé sur l’inattendu. Je m’habitue mal à des rapports humains de plus en plus inharmoniques et contentieux, à travers des dialogues qui ne sont plus que deux monologues, où la logique et l’irrationnel, où Descartes et Lautréamont, nous sollicitent en même temps ; on nous fait cadeau de la vitesse, laquelle engendre le sur-place ; les voitures deviennent des maisons, et les maisons, des caravanes ; le bout du monde n’existe pas plus que le bout de nos embarras ; le lendemain n’est jamais celui qu’on attendait. Les étudiants deviennent examinateurs et, au théâtre, voilà les spectateurs qui montent sur la scène et coupent la parole aux acteurs. Aujourd’hui, parmi les écrivains, qui accepterait de « s’assembler sous une autorité unique », comme Richelieu le demandait à Boisrobert ? À la Sorbonne, ne criait-on pas hier encore : « Richelieu, no, Guevara, si ! » (L’ombre du Cardinal serait surprise d’entendre encore parler espagnol en France, plus de trois siècles après la prise de Corbie).
La jeunesse exige des comptes d’hoirie, avant l’héritage. Ces adolescents, je voudrais les chérir, mais je me sens infirme devant eux ; je ne sais où placer une affection qu’ils récusent ; c’est déjà difficile d’aimer qui vous aime, mais comment tendre les bras à qui ne veut pas être aimé ? Le seul bien qu’ils attendent de moi, c’est que je m’en aille ; qu’ils me laissent seulement m’éloigner d’eux en prenant ma part de leur peine. Que dire à des orphelins qui sont, en même temps, des parricides ? Ils nous demandent quel sera l’avenir de la jeunesse ; comment leur répondre que l’avenir de la jeunesse, c’est la vieillesse ?
L’état de vif est un état précaire ; est-ce pour cela que les morts me paraissent souvent si neufs ? Ils m’affirment leur présence, avec leur autorité muette. Aussi voudrais-je, par une invocation liminaire, me les rendre aujourd’hui propices en vous demandant, Messieurs, de m’accompagner jusqu’à leur cendre ; ils forment « ce grand ensemble de l’histoire du monde qui (disait Gœthe) nous délivre des absurdités du moment ».
Cet itinéraire infernal nous amènera d’abord à la rencontre d’une époque bien plus hasardeuse que la nôtre, celle qui présida à la naissance de votre Compagnie. Louis XIII ; c’était le moment où la France asséchait ses marécages, endiguait ses rivières débordantes avec l’aide de ses amis hollandais (car elle n’avait pas encore commis la faute de se les mettre à dos). Ce besoin de terre ferme, cette digue, voilà l’Académie française ; elle aussi lutta contre l’inondation des barbarismes et de ces néologismes qui empâtent de leur pédanterie la langue du XVIe. C’est par une remarquable dessication du français que s’annoncèrent les premiers bienfaits de la nouvelle institution, par une concentration extraordinaire du style, soit tout le contraire de cet éclatement de l’homme que prônent nos actuels contestataires, éclatement des formes, des couleurs et des mots.
Quelle joie de me trouver aujourd’hui, ici même, dans cet autre opéra fabuleux que nous à légué Mazarin. Apothéose de la grande époque Louis XIII ! Avant 1900, dans ma jeunesse, il n’y en avait que pour Louis XIII. Les romantiques, avec Marion de Lorme et Cinq Mars, avaient créé l’image d’un Louis XIII à peu près imbécile. Tout à coup vint la réhabilitation : le Richelieu d’Hanotaux, le Louis Xlll de Battifol, les Grandes Frondeuses de Victor Cousin. Avec les Trois Mousquetaires, Mademoiselle de Maupin ou le Capitaine Fracasse notre imagination juvénile nous jetait dans une cohue de cardinaux à poignard et de duchesses travesties en cavaliers bottés ; le Louis XIII, revanche de ceux que le Louis XIV étouffe de ses splendeurs, qui préfèrent les plats d’étain à la vaisselle d’argent, et le cul-de-jatte à sa belle épouse. J’ai été élevé dans la passion du Louis XIII, de son panache espagnol couvrant les guenilles de Callot. Je revois encore les affiches de Lautrec, sur les palissades de mon chemin écolier, celles du cabaret du Chat noir, où Rodolphe Salis et Bruant portaient la cape de Milady ; je revois la mouche, à la lèvre dédaigneuse de Robert de Montesquiou, quant aux feutres à larges bords, style « Ronde de nuit » ils devaient se perpétuer jusqu’à Léon Blum et jusqu’à Paul Souday, ce Franz Hals du journal Le Temps (journal du soir qui, pour Marcel Proust, était le journal du matin). C’était l’heure de Cyrano. Cyrano, roi de mon enfance ! « Quoi ! » disait mon père surprenant son fils, ivre d’évasion et d’aventures, en train de se plonger dans l’Histoire comique des États de la lune et du soleil, ou dans quelque autre de ces voyages en Utopie chers à l’époque, « quoi, tu verrais descendre du ciel, au bout de quelque corde perdue dans les nuages, un fauteuil prêt à t’emporter vers la lune, et tu ne balancerais pas à t’y asseoir ? ». Moi, tremblant de peur et de gloire, n’imaginant pas qu’un bien plus beau fauteuil me serait un jour offert, je répondais : oui, sans hésiter.
À Colbert, couleuvre encore lovée dans l’ombre, nous préférions l’écureuil Fouquet, son rival malheureux ; les infortunes de Fouquet nous firent aimer Pellisson, son admirable défenseur, Pellisson, ce grand historien de votre Compagnie, qui nous a fait revivre cette curieuse époque que les premiers « académistes »– ceux de 1629 à 1635 – nommaient « l’âge d’or » ; l’Académie naissante, pas encore protégée, et qui finalement, consentit à l’être (je cite Petit de Julleville) « non sans quelque chagrin de voir finir ainsi son heureuse obscurité », était uniquement une société d’écrivains, où chacun s’ingéniait à tracer des allées dans le maquis des mots, à en fixer l’ordre, à inventer la phrase courte, le style coupé, à se libérer linguistiquement de Rome et de la Grèce, ces mères abusives du français de la Renaissance. « Il faut plus d’esprit pour se passer d’un mot que pour l’introduire » a dit Paul Valéry ; Giraudoux ajoutait : « J’aime le français quand il est pauvre. »
Lorsque Je parcours des yeux la liste de mes prédécesseurs à ce onzième fauteuil, j’y trouve dix-sept noms ; les uns sont encore connus ; beaucoup, oubliés. Je les accepte dans leur diversité ; je me sens partie d’une composition dessinée par cet artiste qui travaille à l’envers de la trame : le Temps.
Le premier à s’asseoir ici fut Philippe Habert, poète de trente-deux ans : il apportait à la toute nouvelle assemblée un poème au titre touchant : le Temple de la Mort. Habert se définit lui-même, avec mélancolie :
Une âme à qui les cieux ont déclaré la guerre.
Il célébrait sa défunte maîtresse dans ce vers ravissant :
Amour de qui les feux m’ont été si cuisants
avant d’aller, peu après, au siège d’Emery, en Hainaut, se faire écraser par un pan de muraille.
Le second titulaire, le plus remarquable de cette ordonnance, répondait au nom magnifique d’Esprit. On voyait Jacques Esprit en ce petit salon de Port-Royal où la marquise de Sablé faisait retraite. La Rochefoucauld l’estimait ; ensemble, ils rabotaient et polissaient des sentences ; dans une lettre à Jacques Esprit, le duc va jusqu’à lui parler de « leurs » maximes. Les réflexions d’Esprit sur la Fausseté des valeurs humaines datent de 1642 ; bien qu’elles n’aient été imprimées qu’une vingtaine d’années plus tard, elles préfigurent peut-être celles du duc ; pour l’un et pour l’autre, l’intérêt mène le monde ; la vertu n’est qu’une horloge où chaque rouage s’engrène sur l’égoïsme. Peut-être Esprit a-t-il fourni le fond des Maximes ; mais qu’est le fond, sans la forme, et qu’est la forme sans la brièveté ? La Rochefoucauld, sublime avare du style, a lésiné sur chacun de ses mots, comme s’ils lui coûtaient une fortune ; ses sentences étaient, pour ces centres d’opposition à Mazarin que furent les ruelles, ce que les graffiti d’aujourd’hui sont pour les rues. L’art de La Rochefoucauld marque en outre la supériorité de l’homme d’un seul livre ; il faut du talent pour faire des livres, mais pour n’en faire qu’un, il faut du génie.
(…)
Les morts ont des admirateurs, mais rarement des amis ; (…)
Messieurs, notre promenade aux Champs-Élysées se termine. Je crois n’avoir laissé inhonorée la cendre d’aucun de mes héros. Après avoir parcouru cet illustre charnier, je sens ces morts grandir, familiers, comme des personnages de roman, comme des saints du calendrier. Me voici presque leur compagnon, et je ne le regrette pas ; rappelons-nous ce mot de Joubert : « Le soir de la vie apporte avec soi sa lampe. »
Paul Morand, extraits du discours de réception à l'académie française. 20 mars 1969.

/image%2F0991062%2F20191125%2Fob_e0f916_thumbnail-img-8110.jpg)
/image%2F0991062%2F20180321%2Fob_e92b85_20161025-172451.jpg)



/image%2F0991062%2F20200702%2Fob_6a6a8f_104926712-3034354023314055-53292763978.jpg)
/image%2F0991062%2F20200623%2Fob_0b4107_103284793-3003893993026725-10000344087.jpg)
/image%2F0991062%2F20200511%2Fob_7beb5e_92028763-859434617872162-8739230245074.jpg)
/image%2F0991062%2F20200509%2Fob_7878b9_96215208-668587720587952-4616074547290.jpg)