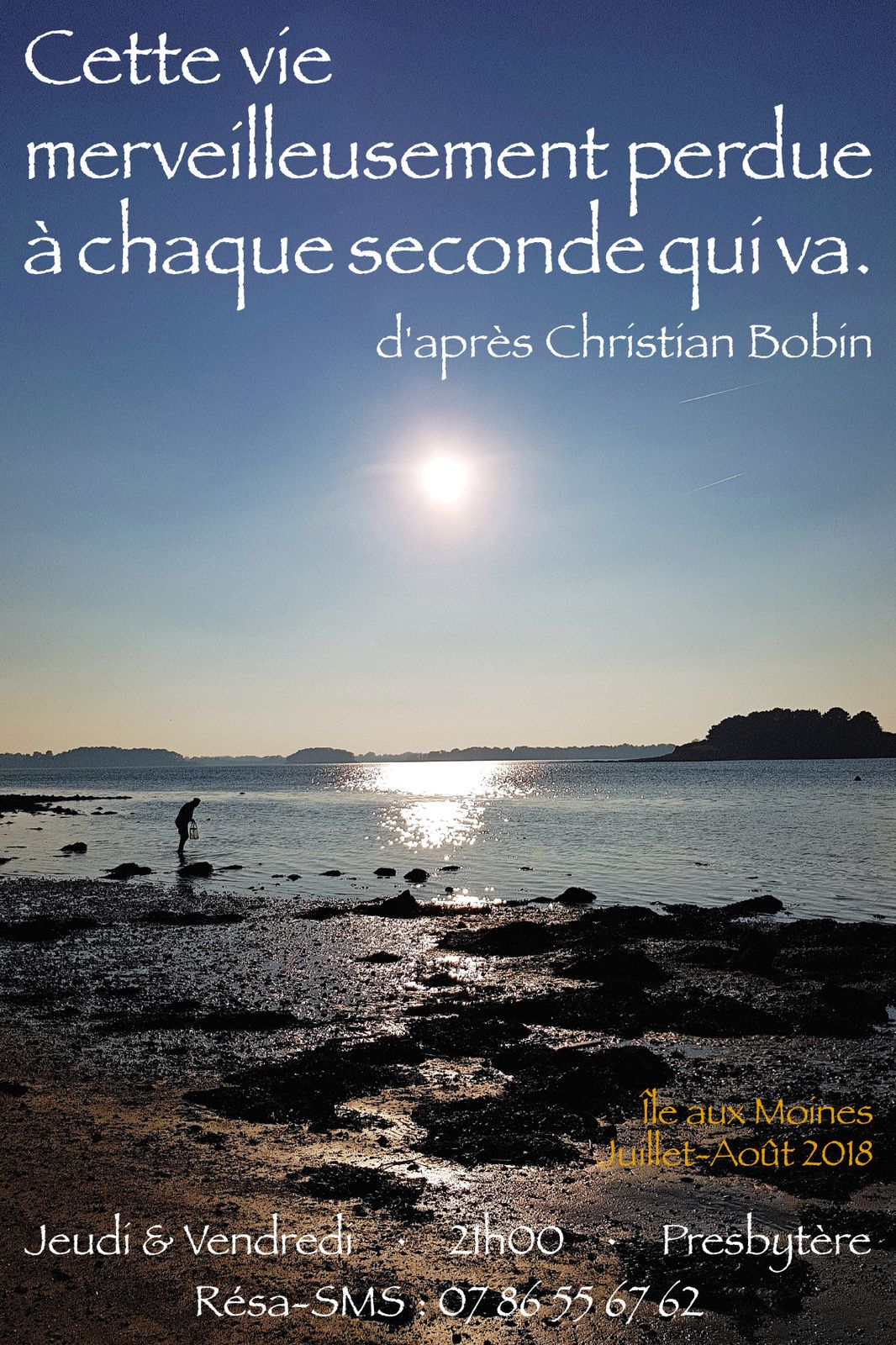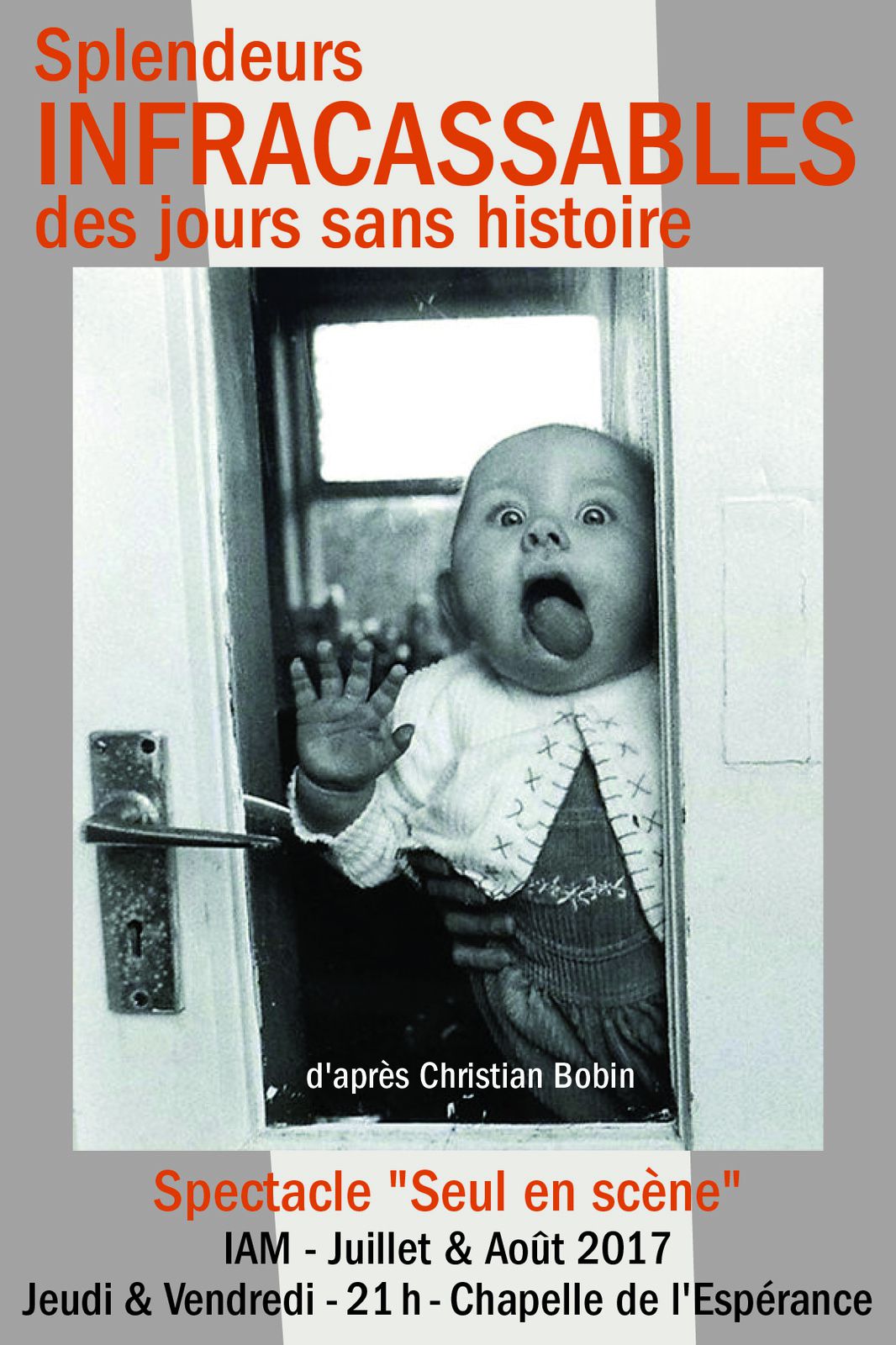Cet enfant-là, donné, c'est ce que l'on attend toute la vie...
Il marche. Sans arrêt il marche. Il va ici et puis là. Il passe sa vie sur quelque soixante kilomètres de long, trente de large. Et il marche. Sans arrêt. On dirait que le repos lui est interdit. Ce qu’on sait de lui, on le tient d’un livre.
Avec l’oreille un peu plus fine, nous pourrions nous passer de ce livre et recevoir de ses nouvelles en écoutant le chant des particules de sable, soulevées par ses pieds nus.
Rien ne se remet de son passage et son passage n’en finit pas. Ils sont d’abord quatre à écrire sur lui. Ils ont, quand ils écrivent, soixante ans de retard sur l’événement de son passage. Soixante ans au moins. Nous en avons beaucoup plus, deux mille.
Tout ce qui peut être dit sur cet homme est en retard sur lui. Il garde une foulée d’avance et sa parole est comme lui, sans cesse en mouvement, sans fin dans le mouvement de tout donner d’elle-même. Deux mille ans après lui, c’est comme soixante. Il vient de passer et les jardins d’Israël frémissent encore de son passage, comme après une bombe, les ondes brûlantes d’un souffle. Il va tête nue. La mort, le vent, l’injure, il reçoit tout de face, sans jamais ralentir son pas.
A croire que ce qui le tourmente n’est rien en regard de ce qu’il espère.
A croire que la mort n’est guère plus qu’un vent de sable.
A croire que vivre est comme il marche... sans fin
L’humain est ce qui va ainsi, tête nue, dans la recherche jamais interrompue de ce qui est plus grand que soi. Et le premier venu est plus grand que nous: c’est une des choses que dit cet homme. C’est l’unique chose qu’il cherche à nous faire entrer dans nos têtes lourdes. Le premier venu est plus grand que nous : il faut détacher chaque mot de cette phrase et le mâcher, le remâcher. La vérité, ça se mange. Voir l’autre dans sa noblesse de solitude, dans la beauté perdue de ses jours. Le regarder dans le mouvement de venir, dans la confiance à cette venue. C’est ce qu’il s’épuise à nous dire, l’homme qui marche: ne me regardez pas, moi. Regardez le premier venu et ça suffira, et ça devrait suffire. Il va droit à la porte de l’humain. Il attend que cette porte s’ouvre. La porte de l’humain, c’est le visage. Voir face à face, seul à seul, un à un.
Dans les camps de concentration, les nazis interdisaient aux déportés de les regarder dans les yeux sous peine de mort immédiate. Celui dont je n’accueille plus le visage---et pour l’accueillir, il faut que je lave mon propre visage---celui-là, je le vide de son humanité et je m’en vide moi-même. Il est juif par sa mère, juif par son père, éternellement juif par cette façon d’aller partout sans trouver nulle part un abri, merveilleusement juif par son amour enfantin des devinettes---comme l’oiseau qui interroge par son chant et reçoit pour toute réponse une pierre et chante encore, même mort chante, encore, encore, encore, bien après que la pierre qui l’a tué est redevenue friable, poussière, silence, moins que silence, rien, et toujours cette vibration du chant pur dans le rien manifesté du monde.
La mort est économe, la vie est dépensière. Il ne parle que de la vie, avec ses mots à elle: il saisit des morceaux de la terre, les assemble dans sa parole, et c’est le ciel qui apparaît, un ciel avec des arbres qui volent, des agneaux qui dansent et des poissons qui brûlent, un ciel infréquentable, peuplé de prostituées, de fous et de noceurs, d’enfants qui éclatent de rire et de femmes qui ne rentrent plus à la maison, tellement de monde oublié par le monde et fêté là, tout de suite, maintenant, sur la terre autant qu’au ciel.
C’est une pesanteur des sociétés marchandes et toutes les sociétés sont marchandes, toutes ont quelque chose à vendre que de penser les gens comme des choses, que de distinguer les choses suivant leur rareté, et les hommes suivant leur puissance. Lui, il a ce coeur d’enfant de ne rien savoir des distinctions. Le vertueux et le voyou, le mendiant et le prince, il s’adresse à tous de la même voix limpide, comme s’il n’y avait ni vertueux, ni voyou, ni mendiant, ni prince, mais seulement, à chaque fois, deux vivants face à face, et la parole dans le milieu des deux, qui va, qui vient.
Ce qu’il dit est éclairé par des verbes pauvres; prenez, écoutez, venez, partez, recevez, allez. Il ne parle pas pour attirer sur lui une poussière d’amour. Ce qu’il veut, ce n’est pas pour lui qu’il le veut. Ce qu’il veut, c’est que nous nous supportions de vivre ensemble. Il ne dit pas: aimez-moi. Il dit: aimez-vous. Il y a un abîme entre ces deux paroles. Il est d’un côté de l’abîme et nous restons de l’autre. C’est peut-être le seul homme qui ait jamais vraiment parlé, brisé les liens de la parole et de la séduction, de l’amour et de la plainte. C'est un homme qui va de la louange à la désaffection et de la désaffection à la mort, toujours allant, toujours marchant. Il ne fait pas de l’indifférence une vertu.
Christian Bobin

/image%2F0991062%2F20191125%2Fob_e0f916_thumbnail-img-8110.jpg)
/image%2F0991062%2F20180321%2Fob_e92b85_20161025-172451.jpg)



/image%2F0991062%2F20200822%2Fob_26838c_103432551-3020508958031895-18248335162.jpg)
/image%2F0991062%2F20200727%2Fob_6597ff_109736013-3120975084651948-82715973277.jpg)
/image%2F0991062%2F20200709%2Fob_4cd547_106549233-10223652208631725-2420382051.jpg)
/image%2F0991062%2F20200630%2Fob_3b1e11_105833566-703399193773471-133428443742.jpg)